Aramon fables et souvenirs
Michel Jarrié
ARAMON
Fables et Souvenirs
Editions Anamnèse
© Michel Jarrié - 2015 ISBN 978-2-955248300
Tous droits de traduction, reproduction et adaptation réservés pour tous les pays.
Anamnèse/Passeurs de mémoires - 11 rue des Sentiers - 77540 Courpalay
Note de l’auteur
Les fables et les souvenirs présentés dans cet ouvrage
ont été dictés par ma mémoire. Quelques-uns m’ont été aimablement rapportés par des Aramonais.
Mon propos était de témoigner d’un art de vivre oublié
et de rendre hommage aux modestes héros du quotidien
qui furent (et sont encore parfois) l’âme d’Aramon.
Si vous constatez quelques omissions ou approximations,
je vous prie de m’en excuser et de m’en informer.
Je ne manquerai pas de les corriger dans la prochaine édition.
Sommaire
Cahier photos, pages I à VIII
. 1 .
Aramon
A quelques lieues d’Avignon et de Nîmes, il est un village niché au bord du Rhône, longtemps réputé comme un port accueillant aux navigateurs et marchands du fleuve, qui réussit à traverser les siècles, tant bien que mal, au gré des caprices de la nature et des soubresauts de l’histoire du Languedoc et de la Provence.
Il était une fois mon Aramon, au sortir de la Guerre mondiale (la deuxième du nom). Il est juste de dire que ce petit pays avait moins souffert de l’occupant que bien d’autres. Les Aramonais retrouvaient petit à petit goût à la vie, d’autant qu’on était censé avoir gagné. Le pont suspendu détruit par les alliés compliquait bien la tâche, mais on allait le remplacer par le bac et vaille que vaille, après des années de disette, il était bon de voir le quotidien s’améliorer jour après jour.
Rue de Nîmes, la confrérie des vanniers s’était résignée et dans le petit port ensablé, il n’y aurait plus de grand bateau amarré, leur temps était bien révolu. Mais pour la plupart d’entre nous, la vie reprenait son cours d’avant : les chaisières avaient résisté et ce travail à domicile améliorait encore la marmite, chacun retrouvait ses modestes joies quotidiennes, les épiceries et les petits commerces abondaient avec des étals de mieux en mieux achalandés. Les cartes d’alimentation, les tickets de pain, tout le monde par la force des choses s’en accommodait convaincu que demain serait meilleur qu’aujourd’hui.
A nouveau, le boulanger travaillait une farine de blé au lieu de maïs. Mais faute d’électricité, il passait beaucoup de temps à rentrer des fagots de bois pour alimenter le four. L’eau ne parvenant plus au robinet, chaque soir on voyait un incessant cortège de seaux d’eau puisés à l’arrière du Café Sardou.
Les métiers de la terre rythmaient encore les jours avec les petits matins chargés du bruit de sabots des chevaux tirant leur jardinière. Les terrasses des cafés, accueillantes et conviviales, entretenaient les rumeurs et la bonne humeur de la population. Outre la pétanque, les jeux de cartes, la pêche et la chasse, à l’exception des quelques animations patentées, surtout les samedis et dimanches (le cinéma Savoyan et chez Guiguitte), les distractions n’étaient pas légion, on s’en contentait. Le bonheur était simple comme un verre de pastis.
Peu à peu, le « progrès » pointa le bout de son nez. De gros changements, il y en eut, à commencer par l’aménagement des rives du Rhône, l’implantation d’une centrale électrique et de laboratoires pharmaceutiques. Ces innovations bouleversèrent l’ordonnance locale, transformant des fils d’agriculteurs en techniciens de tout poil, provoquant l’arrivée de nouvelles populations et de nouvelles habitudes. Adieu le pas paisible du percheron, bonjour la rumeur du tracteur et le vrombissement des moteurs – saluons l’avènement de l’électroménager qui a bien soulagé les mères de famille à la peine. La radio et la télévision se sont imposées. Reconnaissons que nous les avons adoptées sans grande résistance, et même avec délice, négligeant les choses du passé et les plaisirs de la conversation, inconscients de tout ce que cela impliquerait. C’était un temps où l’on n’hésitait pas à accueillir les visiteurs illustres ou pas, avec une grande bannière proclamant : « Honneur aux étrangers ».
Toute vague étant faite pour partir et plus tard revenir (comme la mode), à l’orée de ce XXIe siècle, on a vu la foire de la Saint-Martin reprendre vigueur et accueillir des milliers de visiteurs, les marchés et vide-greniers se sont multipliés et attirent irrésistiblement de plus en plus de foules, tous milieux et toutes générations confondus. Que viennent-ils y chercher ? Pourquoi cette nostalgie des vieilleries ? Loin de moi l’idée de jouer les vieux grognons. Bien au contraire. Je ne dirai jamais « c’était mieux avant » parce que ce n’est pas vrai. C’était différent, autrement, mais avec un bon sens et un supplément d’âme que nous avons, semble-t-il, égarés en chemin.
Dans les pages qui suivent, je me contente en toute humilité de faire ressurgir çà et là, les personnages qui ont émerveillé mon enfance, celle d’un petit Aramonais né dans l’entre-deux-guerres, dans un village plein d’esprit, de fantaisie et d’humanité. J’ai ouï-dire que le célèbre Yvan Audouart avait organisé une veillée afin de nous « chiper » de quoi noircir quelques pages. L’a-t-il fait ? Je l’ignore.
A 80 bougies, je peux me permettre de ranimer la flamme que je porte en moi depuis tant d’années et vous inviter à la partager. Revivons ensemble ce joyeux passé, retrouvons ces personnages savoureux qui avaient tous un point commun : la simplicité, la malice et la poésie. Ils ont vécu avec la nature, les saisons, les drames et les joies d’un joli petit village du Midi, loin de toute idée de grandeur et de richesse (à méditer).
. 2 .
Pitot, Planet et alentour
Aramon, plus le temps passe et plus j’y reviens. Mes déambulations passent toujours par la rue Pitot où mes parents tenaient une boulangerie-pâtisserie et où, immanquablement, ressurgissent des sensations et des images du passé.
Cette rue porte le nom d’un enfant du pays, ingénieux inventeur1 d’un tube du même nom qui fut plus qu’un tube de l’été puisque trois siècles après sa conception, il équipe tous les avions. On doit également à Monsieur Pitot l’adduction d’eau de Montpellier et la borne visible dans le passage de la Saunerie.
La rue Pitot était modeste, certes, mais terriblement vivante et joyeuse. Les enfants et les chiens y déambulaient sans risques, les ménagères préparaient la boumiane sur le rebord de la fenêtre tout en conversant avec les voisines, les odeurs de frichtis et de pain chaud se répandaient dans toutes les maisons, l’heure de la sieste était sacrée, celle de la belote aussi. Rivalité rimait avec solidarité.
Plan résumé du quartier Pitot-Planet
Ainsi, dans les années 1945-50, à Aramon comme dans beaucoup de villages, chez les commerçants le troc était de mise. En particulier dans les épiceries. Un tel s’y rendait avec une banaste de légumes ou de fruits et les troquait contre du sucre, de l’huile, du riz, etc. Les termes de l’échange étaient consignés dans un petit carnet. Et de temps en temps, l’épicière et son client faisaient le point. Si le client éprouvait des difficulté (intempéries, récoltes abimées, problème temporaire de santé ou de famille), à de rares exceptions près, la commerçante acceptait de patienter, elle faisait confiance.
Mais avant d’évoquer les souvenirs, les fables et les acteurs les plus pittoresques, je dois planter le décor, en partant de la belle porte de Montfrin (côté Planet).
Au début de la rue, se faisaient face deux boucheries : au n°1, la famille Accoto (qui cédera la place au populaire coiffeur Alain Carrière, maire de Théziers) ; au n°2, Zé Baume qui se révéla un brillant avant-centre de l’équipe de football locale, l’Etoile sportive aramonaise. Au n°3, se trouvait l’épicerie-mercerie de Madame Gleize, d’origine bagnolaise. Les sœurs Jourdan, chaisières, demeuraient au n°4. Le rez-de-chaussée de la belle maison à encorbellement, n°5, a abrité la retraite du cordonnier Girard.
Attardons-nous place de l’Eglise : notre Saint-Pancrace est certes moins imposante que son homonyme, la gare internationale de Londres, mais aucun Aramonais ne voudrait l’échanger. L’ancien Hôtel de Forton (12e/17e s.) abritait la mairie, il est aujourd’hui occupé par la bibliothèque municipale. Juste à côté, habitait Joanin Martin, dit le Pot, appariteur du village (scribe, messager, etc.) et redoutable pointeur de boules. Au n°6, se trouvait l’arrière du Bar des Sports et au n°10 un accès au Café Sardou. Ces issues étaient souvent empruntées par certains Aramonais prenant la fuite pour échapper au savon qu’une épouse revêche s’apprêtait à leur servir au su et au vu de tous. Du côté de la porte Posquière, attenants à l’Eglise, il y avait la cure et l’atelier de Joseph Capeau (fils d’un illustre conteur local), ébéniste réputé pour ses « boîtes en sapin ».
Un jour, le curé Vialat, avisant Marcel Dell qui passait par là pour rejoindre le quai, lui dit : « Ma sœur Cécile fait son fagot de bois vers le sous-marin. Appelle-là pour qu’elle revienne ». Et l’on voit le brave et maladroit Marcel mettre ses mains en portevoix et crier très fort : « Cécile ! Y a ton mari qui te demande ! »
Retournons dans la rue Pitot : au n°7 se trouvent un bel ensemble architectural et le départ de la rue de Laudun au milieu de laquelle se dressent les vestiges de l’Hôtel de Laudun (17e s.) Dans mon enfance, ce bâtiment avait moins fière allure. Il abritait un Espagnol, Villa Tarsana, réfugié de la Guerre d’Espagne qui survivait en réparant les chambres à air des vélos. Heureusement, on aperçoit encore la gargouille d’inspiration vénitienne qui servait de cible à nos lancers de cailloux, jeunes ignorants que nous étions de sa valeur historique et esthétique.
Empruntons la rue Voltaire, au n°10, demeuraient Ninette et Fanny chargées de veiller sur mes frères et moi-même tandis que nos parents travaillaient.
Nous retrouvons la rue Pitot, au niveau de l’entrée latérale de l’Eglise Saint Pancrace. Au n°6 se trouvait Prosper Baume (et sa viande esstra) qui malgré son quintal était un élégant partenaire de valse à trois temps. Sur le côté de la maison Pitot (n°7), les Gauthier vendaient fruits et légumes dans l’escalier de leur logement. Au n°8, contrairement aux apparences, les sœurs Sage ne vendaient rien. Le boulanger Albiol se trouvait au n°9. Fifine, Emma et leur maman tenaient l’épicerie Granel au n°10, réputée pour son Roquefort de petit producteur, débité sous cloche, un nectar. En face, il y avait le pâtissier Doulcier (n°11) qui secondait mon père au fournil. Un jour, pour le taquiner, nous avions bricolé un poste de radio et nous faisant passer pour Radio Nîmes, nous diffusions « La minute culinaire », une émission qui donnait des recettes toutes plus farfelues les unes que les autres. Prenant la chose au sérieux, le père Doulcier hurlait : « Vous les entendez ces grands couillons qui se foutent de la gueule du monde, et en plus, ils rigolent. Je vais écrire au directeur de la station ». Au n°12, on admirait la belle maison des Cardinaux, habitée par les Cavène, devant laquelle papotaient Valentin et Gaëtan avec son allure de Popeye. Le n°13 était animé par le maître charcutier Lacroix qui opérait pour les Beaume.
A ce niveau-là, s’ouvre la rue des Cardinaux, avec tout au bout les remparts sud du château. Dans ma jeunesse, cet ensemble était un champ de ruines où poussaient les figuiers et un terrain de jeu pour les gamins du quartier, indifférents au risque de recevoir un pan de mur sur la tête. Rendons grâce à tous ceux qui ont entrepris de restaurer les vieilles et belles pierres de ce quartier.
Rue Pitot, on atteint le n°16 où se trouvaient la famille Jarrié et sa boulangerie (1935-1970). Cette placette se nomme place des Fours parce que s’y trouvait jadis le four banal du village. Au n°18 officiait Camille Faucher, un ancien de la marine, réparateurs de vélos et de mobylettes. Sa voisine (n°20) était Rosette, chaisière. Le n°22 fut un temps, l’adresse du coiffeur Joachim Lloret, lequel succédait à Jean Girard, cordonnier et releveur de compteurs d’électricité. Au n°26 était la maison de Giboulet, le garde-barrière et ses manières à la Bourvil, « Où es-tu giboulée ? Ta maison a accouché d’une berline ! »
Coté opposé, entre la rue des Cardinaux et la place de Choisity, il y avait jadis une enfilade de maisons modestes, avec des courettes et des ébauches de jardinets où demeurèrent Marie-Jeanne Guillermet, dite la Sourde, la mère Labatud, les Rosiers, Marie-Jeanne la Roubaïre. Ces demeures ont été remplacées par une grande bâtisse contemporaine dont le style architectural, heureusement, n’offense pas les hôtels particuliers voisins (16e-18e s.)
Nous arrivons à la Saunerie par laquelle s’écoulaient les eaux usées et les eaux pluviales avant de se jeter dans le fleuve (à un endroit très poissonneux). Une vanne, commandée depuis le quai, contrôlait leurs débits suivant la hauteur du Rhône. Enfants, nous empruntions ce passage. Pendant les périodes de restrictions, les maisons qui surplombaient cette voie étaient dotées de petits poulaillers aériens, pour améliorer l’ordinaire.
Poursuivons notre périple dans la rue Pitot. Au n°28 se trouvait l’arrière de la maison de Juliette Bonnet. Au 1er étage résidait le père Faune, un papé très fier de sa bonbonne d’huile d’olive… Un jour, deux garnements furent portés disparus. En fait, ils s’étaient faufilés dans la maison de Faune, ils mirent tout en l’air et ayant déniché la pharmacie eurent l’idée saugrenue de vider suppositoires, cachets et potions dans la bonbonne. Leur forfait accompli, ils reparurent comme deux anges, sans se douter que les parents et voisins angoissés fouillaient les bords du Rhône. Au n°32, se trouvait la mercerie de Suzanne Lamouroux, veuve d’Edouard (1918), qui éleva seule ses garçons Hubert et Fernand. A sa mort, en 1947, la boutique fut reprise par ma tante Jeannette Rosier. La famille Dell animait le primeur du n°34, elle fut remplacée par la famille Beridot. A côté vivaient les Deydon. Les vestiges de l’Hôtel Saint-Jean sont encore visibles, pour le plaisir des amateurs d’histoire. Au n°44, on trouvait la maison de Maître Julian (aujourd’hui restaurant les Oliviers) et au n°48, le célébrissime bazar Buyas.
Cette exploration de la rue Pitôt s’achève par la porte d’Avignon, la tour du Bréchet et l’Hôtel de Choisity. Dans les années 1943-44, celui-ci fut le quartier général des Allemands qui laissèrent les lieux encore plus délabrés qu’à leur arrivée.
Et maintenant, place aux acteurs.
Soir d’été
Petit à petit, les mamés d’abord, les familles ensuite, sortent les chaises sur le seuil et, peu à peu, la conversation prend forme : on commente tous les faits divers, on commence doucement puis à force de débattre, on hausse le ton, on se dispute parfois, jusqu’au moment où quelqu’un dit :
« Chut, y a Giboulet qui dort ».
- Ca craint pas, je l’ai vu partir à la barrière, route de Théziers et sa mère est sourde comme un pot.
- A propos, on dit qu’il fait la conversation avec une pie.
- Ah bon. Qu’il lui apprenne à lire, comme ça elle saura l’Histoire de France, elle verra qu’elle n’est pas la seule à être bête !
- Attention, la pie est peut-être bête, mais elle n’est pas folle ».
Et ainsi de suite, ça continue jusqu’au moment où la fraîcheur et la fatigue incitent les uns et les autres à partir dormir. D’ici quelques heures, recommencera la ronde des chevaux avec leur jardinière, il faudra se lever tôt pour ramasser fruits et légumes, car le marché du Planet ouvre à onze heures – pas plus tôt ni plus tard. L’appariteur, Joanin Martin dit le Pot, donnera le signal avec son sifflet, à l’heure juste – car le règlement c’est le règlement.
Les chaises de Rosette
Au n°20 de la rue Pitot, la bonne Rosette rempaillait les chaises, parfois « assistée » d’un non-voyant qui jouait du pipeau pour récolter quelques piécettes. Aux beaux jours, il lui arrivait de travailler toutes portes et fenêtres ouvertes et de tchatcher avec les passants.
La petite nièce du boulanger voisin, en vacances à Aramon et qui jouait dans la rue comme tous les enfants du village, fut intriguée par les chaises aux sièges percés empilées sur le seuil de la rempailleuse. Curieuse en diable, elle demanda à son oncle
le pourquoi de la chose. Celui-ci, malicieux, répondit : « C’est un secret ». Rien de tel pour titiller l’imagination d’une gamine. Comme elle insistait pour en savoir plus, il lui glissa à l’oreille : « C’est qu’ici les dames ont une dent au derrière qui ronge
la paille ». Devant l’incrédulité de la fillette, le boulanger renchérit : « Si tu lui demandes gentiment, peut-être qu’elle te la montrera ». Je vous laisse imaginer la suite… Et l’hilarité du quartier. Rosette, qui connaissait bien son blagueur de voisin, s’exclama : « C’est pas possible de raconter des choses comme ça aux enfants ! » Et ce n’était pas la dernière farce qu’elle dut subir.
Marie-Jeanne
Voici venir Marie-Jeanne (ni sourde ni aveugle celle-là) avec sa brouette alourdie par sa récolte du jour, cachée sous une bâche, à cause du soleil sans doute… Elle a un secret : elle obtient les plus beaux fruits et légumes du village sans avoir besoin de donner un coup de bêche ni de répandre un grain d’engrais. Sans faire un effort. Serait-ce une adepte du bio avant l’heure ? Pas sûr. Car elle a la curieuse manie de faire sa cueillette à l’heure où les autres jardiniers et maraîchers sont en train de déjeuner ou de faire la sieste. Elle y a gagné le surnom de la Roubaïre.
Sacré Pierrot
La fête votive ou « fête des vœux et des promesses » est une tradition méridionale par laquelle, jadis, les habitants honoraient le Saint de leur village afin de s’attirer les bonnes grâces du ciel pour les moissons ou les vendanges. C’était l’occasion de festivités et de ripailles, le plus souvent en septembre.
Il y a quelques décennies, la jeunesse participant à ces fêtes se contentait de divertissements gratuits, non polluants et peu bruyants, tels la course en sac, le mât de cocagne, le lancer de noyaux, le tir à la corde, etc. Parmi tous ces jeux, le plus populaire était le concours de grimaces. Les gamins se pressaient pour y participer (certains s’étant entraînés toute l’année) et les membres du jury avaient du mal à les départager.
En 1945 (ou 46 ?) cependant, un participant l’emporta à l’unanimité et avec une mention spéciale du jury : Pierrot. Pourquoi ? Comment ?
Souvent un peu d’imagination suffit : le jeune Pierrot avait parmi ses proches un « artiste », Joseph, qui savait manier le pinceau. Ils eurent tous deux l’idée de peindre sur le postérieur de notre héros, un visage : deux yeux, un nez, des oreilles et une bouche. Le jour du concours, Pierrot se présenta dans la file des concurrents et quand le moment de sa prestation arriva, il se retourna et baissa sa culotte… Eclat de rire général ! D’autant qu’il avait introduit une petite pipe dans le seul endroit possible. Tout le monde applaudit et Pierrot fut la vedette du jour.
Noël
Petite incursion dans les années 1970, un 24 décembre, à la messe de minuit. Résonne dans ma mémoire une kyrielle de sons émouvants, les chants fredonnés par la chorale de Mademoiselle Fonzes avec des timbres de voix familiers : Marcelle, Etiennette, Edmond et bien d’autres. La voix, aussi, de Pierre Arnaud dans sa courte homélie. Petites merveilles du passé. Quel dommage qu’un stylo magique ne puisse porter les sons jusqu’à vos oreilles !
Au sortir de l’Eglise, côté Planet, on est surpris par la voix du Ténorino Noël Brun, le bien nommé, et par son répertoire particulier dont son « Minuit bourgeois » plus que leste, suivi de la description anatomique des filles du pays, quartier par quartier, et pour clore son récital, une chanson exotique, « Hawaï », avec Paul Bonis au sifflet. Notre Noël eut une fin singulière : une chute fatale au bas des escaliers d’un mas de Dève à l’issue d’un dernier tour de chant. Par bonheur, ses amis l’avaient enregistré sur un magnétophone (une performance pour l’époque), ils se cotisèrent pour produire un petit disque que nombre de familles ont conservé. Un souvenir émouvant, hommage à tous ceux qui ont bercé notre enfance avec leur joie de vivre et leur simplicité. Et ne me dites pas que les gens heureux n’ont pas d’histoires, les nôtres en avaient des tas, plus où moins gaies, graves ou douloureuses.
Noël, c’était aussi le temps où nos mères se réunissaient pour confectionner ensemble des centaines d’oreillettes parfumées à la fleur d’oranger qui débordaient des banastes et nous régalaient.
Josef
Durant les années d’occupation, mon père, boulanger, eut bien des difficultés à faire tourner la boutique et à subvenir aux besoins de sa famille. Les matières premières étaient rationnées, sinon inexistantes. Il ne fut pas seulement privé de farine. Un jour, un jeune officier allemand réquisitionna son fournil. Impossible de protester. Chaque après-midi, avec mes frères, on voyait débarquer des soldats les bras chargés de tous les ingrédients qui nous manquaient tant (beurre, sucre, etc.) Et sitôt le travail de préparation et de cuisson achevé, on voyait les paniers pleins de pains et de viennoiseries repartir dans l’autre sens. Nous étions très surveillés.
Mais, je dois parler du pâtissier qui nous était imposé. Il s’appelait Josef, il était Autrichien. En fin de journée, avant de rejoindre ses camarades, il cachait entre deux planches à pain quelques douceurs à notre intention. Il avait de l’humour et quand il était seul avec nous, il lui arrivait de lisser une mèche de cheveux sur son front, de placer son peigne sous son nez en guise de moustache et de tendre le bras pour remercier Adolf de lui offrir de « belles vacances ». Ainsi ai-je appris qu’il existait des nuances entre le tout blanc et le tout noir.
Marceau
Voici un Marseillais « pur jus », à la fois plombier et éternel assoiffé (surtout dès qu’il franchissait le seuil du café), qui a laissé une trace dans la mémoire de ses concitoyens. C’était dans les années 1950, la conversation revenait souvent sur les sinistres années de l’Occupation (quand la ligne de démarcation fut franchie, 1943-1944).
Marceau avait une façon particulière de raconter « sa résistance » qui, disait-il, l’avait obligé à se planquer à Aramon. Je le cite : « Quand les fridolins2 sont arrivés au Vieux Port, j’étais à la tête de la plus grande plomberie du pays. Je vois encore le premier Prussien franchir la porte de mon bureau. C’était un tout jeune lieutenant. Quand il m’a parlé ou plutôt aboyé un ordre, ah le pauvre petit, je ne sais pas ce qui m’a pris, même que j’ai eu du regret après… Toujours est-il que, durant la nuit, j’ai transporté ce qu’il en restait au large des Goudes3. Inutile de vous dire que je n’ai pas traîné. Et après ? Où aller ? J’ai cherché, en commençant par la lettre A, et là, comme un éclair, j’ai pensé : ma moitié a une cousine germaine à Aramon. Alors, ni une ni deux, j’ai laissé toute mon entreprise derrière moi, et pour cause. J’ai tout recommencé à zéro ici. Bien sûr, la guerre étant finie, ma femme m’a dit « Qué fazen ? (que fait-on) ». J’ai réfléchi : recommencer là-bas ? C’est que j’atteins le demi-siècle. Et puis ici, je me suis fait de vrais amis, je coule une vie tout plan-plan, le Ricard y est aussi bon que sur la Canebière. C’est vrai, de temps en temps, j’ai un peu le mal du pays… Bah ! Quelques pastis plus tard, j’y pense même plus. »
Le bazar Buyas
N°48, trois coups de pied sur le paillasson et nous pénétrons dans l’illustre bazar d’Aramon. Nous sommes accueillis par trois dames : maman Buyas et ses filles Paulette et Renée. La première surprise vient de l’abondance de marchandises, surtout au sortir de guerre : draps, couvertures, chemisettes, chaussures, mouchoirs, jouets, etc. Tout ce qu’il faut pour se vêtir de pied en cap et la maison avec. Mais à peine a-t-on le temps de se remettre de cette surprise que le spectacle bien huilé commence : vous aviez besoin d’une ceinture, sitôt le choix fait, Paulette dit : « Tè, regarde, ce pantalon irait bien avec », et Renée poursuit : « Surtout avec cette veste. Que tu es beau là-dedans ! » Ainsi pris en tenailles et l’affaire conclue, madame mère vous attend à la caisse avec son gros mètre de drapier à côté d’elle : « Voilà, ça te fera tant (de francs), c’est bien parce que c’est toi ».
Finies vos emplettes, vous prenez le chemin de la sortie. Mais pas question de s’en tirer comme ça, il faut faire un brin de causette et là, stupéfaction, il n’y a pas une célébrité, chanteur ou homme politique que ces dames n’aient connue intimement : « Tu te rappelles maman quand tu le tenais sur tes genoux ? » Et la mère, redressant son buste, sortait sa tirade : « Eh oui, eh oui, un grand acteur, le nombre de fois qu’enfant il passait ici, là, dans le jardinet. »
Vous parvenez enfin à la porte de la boutique, mais avant de pouvoir l’ouvrir, Paulette vous glisse : « Vous savez, Doumergue le président était voisin avec maman, même qu’un jour il l’a demandée en mariage, mais ne dites rien à maman, elle a horreur qu’on en parle ! » Elle concluait : « Ce soir on se couchera bonne heure, hier au souper il y avait Marcel qui nous a tenu la patte jusqu’à point d’heure ». Vous répliquez : « Quel Marcel ? », « Boussac4 pardi ! »
Petite parenthèse : au moment de Noël, chaque soir, une fillette chétive, munie de son pot au lait, s’arrêtait devant le Bazar et s’extasiait de toutes les poupées exposées en vitrine. Puis elle se rendait chez la mère Guillon pour remplir son pot, et sur le chemin du retour, recommençait son manège, le nez littéralement collé contre la vitre. Une fois partie, restait une auréole de buée qui rendait la vitrine encore plus belle.
Les Buyas avaient une jeune voisine, Babette. J’ignore si ces dames l’avaient formée au commerce et à leurs délires, toujours est-il que Babette devint vendeuse aux Dames de France en Avignon. Lors d’une opération commerciale consacrée au Japon, elle fut déguisée en geisha et y connut un grand succès. Elle détenait, disait-elle, un secret qu’elle confiait d’ailleurs volontiers à qui insistait pour l’entendre : elle était la fiancée secrète de Luis Mariano. Ce qu’il en advint, je n’en sais trop rien.
Un jour de printemps, séjournant au Pays basque, je déjeunais avec André et Guy, des amis basco-béarnais. Le repas ayant été aussi copieux que savoureux, au sortir de table nous avons eu besoin de faire quelques pas. Comme nous étions à Arcangues, nous avons rendu visite au grand Luis qui repose humblement au cimetière. Tandis que mes amis fredonnaient quelques airs d’opérette bien connus, je vis une frêle petite dame aux cheveux blancs, enserrée dans un kimono, qui disposait des fleurs dans un vase posé sur un carré de gazon japonais, à l’ombre d’un cerisier en fleur.
Joachim le Figaro
Joachim Lloret coupait les cheveux en quatre au n°22 rue Pitot. Au bout de quelques années, las de travailler seul, il laissa tomber le coupe-chou pour animer le Café des sports du Planet où régnait une tout autre atmosphère. Un jour, ne se sentant pas très bien, il consulta le bon docteur Granet. Dans son café, ses fidèles clients, inquiets, attendaient son retour en trinquant à sa santé. Quand il revint, on entendit un :
« Et alors ? »
- Eh ben, il m’a dit de faire attention à la charcuterie, de manger moins de sucre et de gras, de freiner sur la bagatelle, vu mon âge… »
L’un des clients osa la question fatidique :
- « Et le pastis, tu lui en as parlé du pastis ? »
Joachim répondit avec flegme :
- « Bien sûr que je lui en parlé du pastis. »
A nouveau, retentit un : « Et alors ? »
- « Il m’a regardé droit dans les yeux et m’a répondu : “Le pastis ? Mais vous voulez rire !” (L’assistance émit un énorme ouf de soulagement). Allez, c’est la tournée du patron et un double ! »
Des histoires de « Figaro », il y en eut beaucoup d’autres. Avant-guerre, les anciens avaient pour habitude de se rendre deux fois par semaine chez Perrin ou chez Saint-Michel pour se faire tailler la barbe et la moustache. Ils s’y rendaient un par un, au fil des heures, mais repartaient tous en même temps, souvent à la fermeture de la boutique. C’est qu’à l’époque, barbiers et coiffeurs tenaient salon, au sens propre du terme : chacun pouvait y trouver une chaise et participer au « débat » alimenté par les histoires, les blagues et le passage en revue de tout ce qui animait le pays. Tout le monde en prenait pour son grade. Mieux qu’à la télévision.
Les dames n'étaient pas en reste, mais ça se déroulait chez Gilette aux Bourgades ou chez Annette au Planet. Y remplir son panier à provisions prenait autant de temps qu’une séance chez le coiffeur. La conversation durait jusqu’à ce que tous les petits et grands événements locaux aient été commentés. Les clientes préparaient la « biasse » la veille, dès fois que la séance se prolonge plus que prévu.
Sardou
Oui, Aramon eut son Sardou, un limonadier. Il tenait le Sardou, un café qu’il animait avec autorité. D’une stature imposante, avec un nez en forme de morille, il se promenait derrière son comptoir comme un bateleur de fête foraine. Il avait quelques relations, en particulier Darcelys, artiste marseillais très populaire qui, de temps à autre, venait lui rendre visite pour le plus grand bonheur de la clientèle.
Sa réputation était telle que longtemps après sa disparition, lorsque Fernand Sardou, mari de Jackie et père de Michel, passa l’arme à gauche, quantité d’Aramonais présentèrent leurs condoléances à Josy, la petite fille du limonadier. Persuadés qu’ils étaient de proches parents. En fait, le vrai patronyme de notre Sardou local était Hugues. Josy, bien sûr les détrompa et en eut quelques remords en se disant : « Finalement, j’aurais dû les laisser croire. Les Aramonais auraient eu la fierté de penser que la célèbre dynastie des Sardou avait des racines au village. » La légende est parfois si jolie qu’on a envie d’y croire.
Pannot
Pannot est le patronyme d’un Aramonais réputé pour être très distrait. Ses copains de belote ne manquaient pas d’en profiter pour tricher : « Pannot, c’est encore à toi de distribuer les cartes ». Et le brave Pannot, ayant oublié la marche du jeu s’exécutait et recommençait, et ainsi de suite.
Au point que quelques décennies plus tard, dans les parties de cartes aramonaises, quand un joueur est sollicité pour distribuer les cartes, il se rebiffe : « Je ne suis pas Pannot, moi ! »
Au Planet
Proche de l’Eglise, de l’ancienne mairie et du fleuve, cette esplanade était notre agora, au sens propre du terme : un lieu de rassemblement, de débat, de résistance ou de réjouissance pour toutes les générations.
A l’emplacement de l’actuel Pub 16 vivotait la brave Léa, veuve (la grande aventure de son mari était d’avoir connu le siège de Sébastopol). Avec vaillance, modestie et dignité, elle veillait sur une mini supérette sombre et odorante où s’entassaient comestibles, mercerie, droguerie et où l’on avait une chance de dénicher l’impossible. Eté comme hiver, sur son fourneau alimenté par les fagots de bois qu’elle ramassait au bord du Rhône, mijotait un pauvre fricot de légumes et d’aromates cueillis dans les garrigues. Jamais on l’entendit se plaindre de son sort.
Les Docks vauclusiens se trouvaient au niveau de l’actuelle pharmacie. Cette épicerie fut animée de « main de maître » par Louisette puis sa fille Annette5 jusqu’en 1975. Ouverte sept jours sur sept à des horaires (impensables de nos jours) variant suivant les saisons et les besoins. Dès 6 h, avant de partir travailler aux champs, on pouvait s’y procurer de quoi préparer le casse-croûte. A 20 h passé, Annette accueillait encore des clients. C’était un précieux lieu de vie, d’échange et d’humanité. Chaque commission était assortie de recettes, de conseils et de nouvelles fraîches sur les uns et les autres. On avait alors la sagesse de prendre son temps au lieu de lui courir après. Quand Annette décida de fermer boutique le dimanche après-midi, cela déclencha une tempête dans les esprits des habitués : on les privait de quelques heures de liberté, de palabre et de plaisir. Mais Annette y gagnait quelques heures d’un repos bien mérité après des décennies de services.
L’animation du Planet tenait aussi à deux débits de tabac tenus par Gounet dit Bobèche et Moureau dit Nénin. Les dimanches et les jours de fête, c’était le triomphe des cafés : Sorbier, Lloret, Cavène, Moureau, Sardou, etc.
Pour la fête votive, les cafetiers déployaient leurs terrasses où s’attardait toute la population locale. L’esplanade accueillait de modestes manèges, un stand de tir, des marchands de chichis ou berlingots et un jeu de roulette (encore en vigueur dans certains villages) interdit aux moins de 21 ans, où le gain d’argent était (en principe) prohibé et remplacé par des victuailles et autres bricoles. Même les gendarmes s’y adonnaient en oubliant de sermonner les mineurs qui jouaient à leur côté. Le clou de la fête, attendu par toute la jeunesse, était le bal animé par Aldo Cecchini et son orchestre. Garçons et filles se livraient à des parades, rituels jeux de séduction et de conquête, ils dansaient sous le regard hautement vigilant des mamies, des mères et des tantes. Il fallait déployer des ruses de Sioux pour entraîner une jeunette sous un porche ombragé et échanger avec elle des poutouns de débutant. Au risque d’alerter les chaperons et de voir la fille sermonnée en public, ramenée tout de go au logis familial, privée de sortie pendant quelques jours.
Sur les quais
Quelle chance d’habiter sur le quai, surtout entre les Arènes et le Planet, les maisons ont le ventre au soleil à l’abri du mistral et, pour la plupart, un jardinet en contrebas. Saluons d’abord Gilette et sa sœur, un clin d’œil aux Buyas. Deydon se trouve juste à côté. Suit la maison de l’ami Noël Brun et, peu après, la splendide demeure de Juliette Bonnet et de son capitaine de père. On atteint le bureau des Postes, puis on est surpris par le bruit de plombs de chasse qui tombent sur le carrelage de la maison suivante, chez les Colombi.
On aperçoit le receveur Pommier prenant le soleil en compagnie de Renée la standardiste sur le seuil des Postes Télégraphes et Téléphones. Dans les années 1950, rares étaient les maisons équipées d’un téléphone. Pour communiquer à distance, il fallait passer par les PTT où l’on recevait aussi des appels au su et au vu de tous. Les intéressés étaient prévenus à
la bonne franquette. Ainsi, pouvait-on entendre : « Joséphine, ta petite te demande ». On voyait aussitôt la destinataire accourir toute affaire cessante, en pantoufles, avec son tablier ou un torchon à la main. Toutes les communications passaient par la standardiste, Renée, laquelle était de ce fait la mieux renseignée sur la vie du pays et de ses habitants. Un jour, Robert, en train de discuter avec sa cousine Marcelle, lui dit : « Je te rappellerai plus tard, car je crois qu’on nous écoute ». On entendit alors Renée s’écrier, indignée : « Oh ça, c’est pas vrai ! ». Notre brave standardiste continua d’accomplir sa tâche jusqu’à ce qu’un nouveau système de télécommunication l’empêche d’intercepter les conversations.
Vénézuéla
Un Aramonais d’origine ibérique eut un gros différent avec un petit notable du pays. Il avait le sens de l’honneur et vécut cette mésaventure comme un affront, une humiliation. Comme il avait le sang chaud, il réagit en donnant un violent coup de dents sur l’appendice nasal du notable.
Ce dernier déposa plainte. Il y eut un procès et un jugement accablant pour « l’agresseur », pourtant personnage sympathique et apprécié de tous. Ecœuré par la justice française, notre Aramonais d’adoption décida de s’expatrier au Vénézuela, à San Rafael di Oritouco.
Le jour du départ, le voilà avec famille, armes et bagages, sur les quais de la gare d’Aramon. Une grande partie de la population, émue et triste, avait fait le déplacement. La locomotive entra en gare, notre compatriote monta à bord du train avec tout son barda, sous les vivats de la foule agitant des mouchoirs mouillés de larmes jusqu’à ce que le train démarre et disparaisse dans le tunnel.
De retour à la maison, j’ai regardé dans mon livre de géographie, la carte de l’Amérique. C’est ainsi que j’appris où se trouvait le Vénézuéla. Mais, à mon grand regret, je ne réussis pas à localiser San Rafael di Oritouco. Ce nom de bourgade inconnue et le destin de cet Aramonais expatrié me firent longtemps rêver.
Quelques années plus tard, je me remémorais cet épisode avec Toto Tamagna, chef de gare : « Ô pôvre, m’en parle pas. Si je m’en souviens ? Quand le quai s’est vidé, les gens avaient tellement pleuré, qu’une heure après il était encore tout mouillé, comme s’il avait plu ! »
Déjeuners sur l’herbe
La tradition des repas champêtres les lundis de Pâques et de Pentecôte existe encore, mais de nos jours, les moments de festivité ou de détente sont si nombreux qu’ils n’ont plus la même saveur.
J’ai eu en main des photos en noir et blanc d’une qualité si exceptionnelle, que seul un photographe professionnel a pu les saisir. Elles datent des années 1925-1930 et témoignent de ces jours de relâche et d’évasion, chers au cœur des vieux Aramonais : le pique-nique de Pâques au Pont du Gard, et la grande sortie de Pentecôte à l’abbaye de Frigolet.
Ces photos montrent deux assemblées en habits du dimanche, assises ou semi-couchées, autour de lumineuses nappes blanches étendues sur le sol. Sur les nappes : vins légers et mousseux, carthagène, pâtés de saison, fougasses, pain de campagne, fromages du pays et gigot d’agneau aillé et froid.
La coutume voulait que les hommes et les femmes soient séparés : d’un côté, des gaillards moustachus arborant casquettes ou canotiers, l’un d’entre eux, un « incongru », porte un pantalon de golf ; de l’autre, le groupe des dames, coquettes coiffées à la garçonne. Parmi elles, je reconnus Madeleine.
Un nouvel habitant d’Aramon avait été surpris de cette « séparation » et croyait que les mâles locaux étaient des rustres. Il s’en confia à une Aramonaise : « Je ne comprends pas, au siècle où nous sommes, que vous acceptiez d’être mises à l’écart, sans vous révolter !
- Nous révolter nous ? Pensez donc ! Si vous aviez à supporter ces grands couillons comme on les supporte toute l’année, vous seriez bien content de ne pas les avoir sur le dos. Au moins, deux jours par an, on n’a pas à les servir. On est ravies de se retrouver entre copines, de raconter des bêtises et de rigoler. »
Ces rendez-vous se préparaient à l’avance et le scénario était toujours le même. On en parlait, on se répartissait les tâches, on s’organisait et on y allait, à pied, à cheval, en voiture. En ces temps de durs labeurs, c’était un jour très attendu, un jour de répit, de liberté, de plaisirs, augurant le retour de l’été. On se retrouvait entre amis, en famille, entre cousins venus d’autres villages.
Au Pont du Gard, on s’installait sur les grèves, sur les pentes rocheuses, à l’ombre des chênes ou des platanes. C’était notre façon de rendre hommage à ce monument de l’histoire de l’humanité que le monde entier nous envie – avec toujours la même admiration et les mêmes interrogations face à l’exploit des bâtisseurs de l’Antiquité. A ses pieds, nombre d’idylles ont pris racine.
Inutile de préciser que « l’industrialisation » du site a tué cette tradition du lundi de Pâques et que beaucoup de Gardois ont renoncé à le fréquenter.
Les chèvres sauvages
Quelques nemrods aramonais, las de voir défiler perdrix et garennes entre les herbes hautes sans réussir à les « parfumer » de quelques plombs, eurent l’idée géniale d’introduire quelques chèvres brouteuses dans la cambrousse afin de faire « table rase » de cette végétation, de dégager la vue. Ceci, aussi, dans l’intérêt des chasseurs vieillissants ou « distraits », pour leur éviter de confondre la meute de toutous à poil roux avec des renards.
L’herbe abondante fut tellement au goût de la poignée de caprins lâchés dans la nature que les boucs honorèrent les femelles plus que de raison, engendrant ainsi une très nombreuse descendance. Tout eut été pour le mieux dans le meilleur des mondes, si le troupeau débordant des limites de son territoire ne s’était baladé le soir dans les vignes d’un auguste propriétaire pour se gaver de feuilles et de fruits. Ce vigneron piqua une grosse colère et l’affaire prit une sérieuse tournure quand le Préfet du Gard, invoquant des risques sanitaires, ordonna au Maire de régler le problème. L’élu fit la sourde oreille, les chasseurs firent profil bas, c’est que pour eux la situation était doublement avantageuse : outre le gibier, ils récupéraient les chevreaux pour en faire bonne chère.
Les promeneurs et leurs enfants avaient alors grand plaisir à voir les biquettes gambader en liberté sur les petites cimes. On raconta qu’un chamois avait rejoint la troupe. Hélas, pour un être humain, la liberté est à la fois ce à quoi il aspire le plus et ce qu’il supporte le moins… Surtout chez l’autre, quel qu’il soit. Alors, ceux qui avaient permis à ces braves bêtes de proliférer s’employèrent à les parquer sur un terrain clôturé. Fin de l’histoire.
J’ose espérer que, dans ces collines désormais inanimées et désolées, quelques chèvres et boucs rebelles et peu farouches surgissent et enchantent les randonneurs.
. 3 .
Rendez-vous au Sénat
Dans les années 1930-1960, les cafés regorgeaient de bons vivants, compagnons du comptoir et de la terrasse. Il était alors de bon ton de se rendre au bistrot le samedi et le dimanche. Mais ne pas se rendre au café durant la semaine ne signifiait pas s’abstenir de boire. La rumeur locale prétend que la consommation d’eau des Aramonais atteignait un seuil maximal durant la fête votive. On pourrait penser, à juste titre, que cela tenait à l’usage des toilettes, plus fréquent en ces jours d’affluence de populations issues des villages environnants. Que nenni, cet excédent de consommation était dû simplement à l’abondance d’eau délicatement versée sur le pastis, pour ne pas le noyer. La preuve : à la veille de cette fête, on voyait défiler des camions chargés de bonbonnes et de lourdes caisses, qui approvisionnaient les cafés en bouteilles de sirop. « Pourquoi du sirop ? » demandez-vous. La réponse tient en trois mots : perroquet, tomate, mauresque.
Il est un endroit sur le quai, en haut du Planet, contre la maison Laguerre, où les anciens avaient coutume de se réunir pour réchauffer leurs vieux os et ré enchanter leur monde. C’était notre « arbre à palabre » local, surnommé le Sénat. Assis, debout ou accoudé à un muret à l’abri du mistral, entre deux bouffées de Gauloises et quelques considérations sur la météo du jour, on y engageait des joutes verbales sans fin, à dire vrai : des tartarinades. C’était à qui mentait (ou inventait) le mieux.
Ainsi par une orageuse journée, Monsieur Jullian, homme distingué demeurant à proximité du lieu de réunion des sénateurs, saisit une conversation où les uns et les autres pariaient sur la distance qui les séparait du point de chute du tonnerre. Jullian intervint alors : « Ignorentus, ignorentum, ignorenta, il suffit de compter les secondes qui séparent l’éclair du coup de tonnerre et de les multiplier par 3,14116 pour trouver la distance au mètre près ». Sur ce, content de l’effet provoqué, il s’éloigna.
A ma connaissance, le champion des conteurs toutes catégories fut le sieur Cappeau, natif de Roquemaure et devenu Aramonais dans des circonstances rocambolesques (j’y reviendrai dans les pages qui suivent).
Le père Combes
Son challenger, comme on dit, était le père Combes qui, arrivant de la route de Montfrin, le vélo à la main, hors d’usage, déclara : « J’arrive de la coopérative agricole, ils ont mis du mou de raisin partout, c’était si glissant que je ne tenais plus sur le vélo. J’ai mis pied à terre le temps qu’ils nettoient. Et au moment de remonter sur la selle, j’ai vu une énorme guêpe sur mon
pneu arrière. Je l’ai chassée, mais elle s’est vengée : pschitt, crevaison… Je suis en retard, je vous quitte, car ma bourgeoise ne transige pas avec l’heure. »
Tout le monde respectait la règle du jeu, c’est-à-dire prenait chaque histoire pour argent comptant et souvent surenchérissait. Malheur au « pseudo-Aramonais » qui se permettait d’émettre le moindre doute quant à la véracité des faits.
Dans la troupe des « conteurs » originaux, on trouvait aussi Louis Violet, Ancelin, Denis Martin et son comparse Issan. Je me souviens de ces derniers vagabondant dans les rues la nuit en braillant un « Nuit de Chine, nuit câline, ô nuit d’amour, nuit de caresse, ô nuit d’ivresse » qui troublait le sommeil de la population. En fait de Chine, nos deux compères connaissaient surtout le fleuve jaune au parfum d’anisette. Issan partit le premier. La nuit suivant son enterrement, Denis Martin se rendit sur sa tombe et cria : « Issan leva té (Issan lève toi !) ».
Louis Violet
Malgré son air débonnaire, Louis Violet était une vraie terreur pour tout ce qui portait plumes et fourrures. Je le revois avec son éternelle vareuse de chasse et la poche arrière bien garnie, sa casquette vissée sur le crâne et ses petites lunettes cerclées qui lui donnaient un air de notaire. Ce vieux garçon endurci était un chasseur acharné qui goûtait à tous les gibiers rapportés : agasses, corbeaux, blaireaux, petits rongeurs, etc. D’une voix traînante,
il disait : « La nuit, je me réveille pour voir si je dors et j’étends ma main dans le lit pour voir si à mes côtés ne s’y trouve pas une des belles filles que j’ai lorgnées au Planet ». Dans sa jeunesse,
il aurait animé les bals, comme percussionniste, en compagnie de Champetier, surnommé le Professeur, qui jouait du saxophone (son père serait le fondateur des Enfants d’Aramon, groupe folklorique qui se produit encore à travers la contrée).
Ancelin, Ponteau, Sage
Quant à Ancelin, sa maison jouxtait notre école. En automne, avec mes camarades d’études, nous nous faisions un plaisir de lui chaparder ses jujubes. Il nous poursuivait, en vain, tandis qu’en fuyant nous chantions : « Ancelin, la canne à la main, la pipe à la bouche, le roi des babouches ».
En passant chez les Compagnons d’Emmaüs alors basés à Aramon, je dénichai une petite huile sur bois représentant un clair de lune sur le Gardon, signé Ancelin. Je me rendis au Sénat pour saluer l’Ancelin local, je lui racontai ma trouvaille, alors
il me dit, histoire de se faire mousser devant ses collègues : « Dis-leur que mon oncle de Comps était un grand peintre ».
Ce que je fis.
La troupe des anciens comptait aussi Maurice Ponteau.
Il n’était pas très gâté par Dame Nature, c’était un solitaire, employé comme « technicien au sol » et réputé travailleur consciencieux. On était habitué à le voir seul, modeste. Mais un jour, il revint de Marseille avec une compagne. Lors d’une fête votive, on découvrit qu’il dansait à la perfection. En particulier les valses.
Saluons également le Père Sage qui accompagna nombre d’Aramonais jusqu’à leur dernière demeure avec son corbillard et sa mule. Alors qu’il prenait « livraison » d’un homme qui avait trop longtemps séjourné dans le Rhône, la mule prit soudain le mors aux dents et détala à travers le village avec son attelage.
On la vit passer au galop avec le Père Sage et toute la maréchaussée à ses trousses.
Cappeau
Evoquons enfin Cappeau, le phénomène Cappeau. Un brave homme, facteur de son état qui, sitôt son travail achevé, initiait ses semblables à la poésie fantastique. Avec une passion, une conviction et une mauvaise foi inébranlables. Son lyrisme à l’aune de son imagination était sans limites : un brin d’herbe se transformait en prairie, un arbre solitaire devenait une forêt. Tout était disproportionné. On peut dire qu’il voyait « large et haut ».
Ce natif de Roquemaure (petite cité du Gard qui engendra un autre Cappeau, l’auteur du « Minuit chrétien ») prétendait posséder une vaste terre dans son pays natal. Ce à quoi les sénateurs répliquaient : « Et pourquoi avec une terre pareille tu l’as déserté, ton pays ? » Notre conteur, impassible, répondait que des circonstances indépendantes de sa volonté l’avait conduit à Aramon et il ne se faisait guère prier pour les conter : « Qui ne connaît pas le Rhône, fleuve impétueux, pressé qu’il est de se verser dans la Méditerranée, afin de troquer sa robe grisâtre contre une parure d’azur, c’est lui qui détient en ses mains toute ma destinée ». Face au scepticisme de l’auditoire, il renchérit : « Vous voulez des précisions, eh bien voilà : ayant hérité de cette terre de mon oncle Placide, je m’en désintéressais. Jusqu’au jour où par un pur hasard surgit de terre un cerisier. Il grandit très vite et en une paire d’années, il devint gigantesque. Si gigantesque, que le Mistral préférait le contourner. Heureusement, il était au milieu du terrain, ça m’a évité des problèmes avec le voisinage. Il produisit rapidement beaucoup de fruits. Quand il fleurissait, toutes les abeilles du département venaient le butiner. Le bruit du bourdonnement était tel, que même ceux qui habitaient de l’autre côté du Rhône s’en inquiétaient. Tous les apiculteurs de la contrée déposèrent leurs ruches sur mon terrain. Il y en avait tant et tant qu’on pouvait à peine poser les pieds au sol. Quand arriva le temps des cerises, le volume à ramasser était tel que j’ai dû faire intervenir le Génie d’Avignon – ravi d’avoir ainsi des fruits gratuits. La main-d’œuvre locale ne suffisait pas pour assurer la récolte, j’ai fait venir des ramasseurs d’un peu partout. Comme souvent, ils ne parlaient que leur patois, pour leur donner des ordres, j’ai fait venir deux clairons pour sonner l’heure des repas et les temps de repos. Les gens du village ne s’en plaignaient pas, toute cette agitation, c’était bon pour leur commerce. Et il n’y avait pas une grange, pas un hangar, qui ne soit transformé en dortoir… Et puis commencèrent les ennuis, comme mes millions de grosses burlats étaient d’un bon rapport quantité/qualité/prix, elles ont intéressé les grossistes, elles ont envahi le marché. Et les paysans du coin commencèrent à faire la tête m’accusant de concurrence déloyale.
Très vite, les amis d’hier devinrent des ennemis et décidèrent de se venger. Observant que les étourneaux aimaient se reposer dans mon cerisier aux larges et accueillantes branches, et profitant du jour où je faisais le marché, ils l’ont enduit de glu des racines jusqu’au faîte, sans oublier une brindille. Comme j’étais rentré à la maison à la nuit tombée, ce n’est qu’au petit matin que j’ai découvert le désastre : des milliers et des milliers de volatiles aux pattes engluées essayant de prendre leur envol. Je vous dis pas le vacarme… La force de ces petits oiseaux est inimaginable. Une à une les racines ont cédé et il s’est alors produit l’impensable : l’arbre fut arraché du sol, déclenchant un grand souffle d’air, comme une tornade, laissant un trou béant dans le sol grand comme un lac, et je l’ai vu s’élever, oui s’élever et s’envoler. Vous imaginez, cet arbre immense, ce cerisier géant dans les airs. A un moment, il a même masqué le soleil, comme une éclipse.
Quelle histoire ! J’étais tellement choqué que je me suis effondré. Les semaines qui suivirent, je ne voulais plus regarder ma terre, déprimé, j’en ai perdu le goût du pastis. Quelqu’un m’a dit qu’on avait vu l’arbre franchir les Pyrénées. Puis la saison des pluies est arrivée, le Rhône a débordé et comblé l’énorme trou laissé par le cerisier. C’était devenu un étang qui faisait la joie des pêcheurs de carpes. Quelques mois plus tard, Auguste, le chef de gare de Roquemaure est passé me voir : « Ho, Cappeau, il y a des wagons pour toi qui encombrent mes rails, passe donc les débarrasser ». Ne comprenant pas de quoi il me parlait, je me suis rendu sur place. Sur une voie de garage étaient stationnés deux wagons en provenance d’Espagne, une livraison à mon nom et qui plus est, franco de port. A l’intérieur, une cargaison de bois, des petits rondins de cerisier. J’ai demandé au pauvre Aristide de vider les wagons avec sa carriole à bras et de garder les bûches. Il lui fallut deux semaines. Et ce couillon eut une idée de génie. Comme tout se sait dans les villages, toutes les familles au courant ont voulu en posséder un morceau, comme relique d’une histoire miraculeuse. Aristide les a vendus tellement bien qu’il a pu s’offrir le vieux château et m’a acheté mon pré transformé en étang de pêche.
Le temps passant, j’avais toujours le moral au plus bas. Aristide m’offrit de travailler pour lui. Il ne me fit pas de cadeau. Je travaillais pire qu’une bête, à remuer la terre, à m’occuper des blés. Un jour d’été, par une chaleur effroyable, l’orage menaçait, un orage bien noir qui risquait de noyer la récolte. Je redoublais d’efforts, j’étais seul sur l’aire à battre le grain avec mon fléau, je tapais, je tapais, je tapais aussi vite et aussi fort que possible. Je ruisselais de sueur, une sueur grise de poussières. Deux éclairs, trois roulements de tonnerre et la pluie s’est abattue sur moi, que dis-je la pluie : le déluge. Oui le déluge. Très vite, le fleuve a débordé, si vite qu’il m’a happé. J’étais dans un tel état de fatigue et de détresse que je n’ai pas résisté, je me suis laissé porter par les flots, les tourbillons, j’ai perdu connaissance. Quand j’ai retrouvé mes esprits, le fleuve m’avait déposé sur une rive. J’ai mis pied à terre, j’ai fait quelques pas et j’ai vu une pancarte marquée Aramon. Et là, la providence, la chance est arrivée : le facteur de ce village, surnommé le Timbré ne pouvait plus accomplir sa tâche. Il n’était pas méchant, mais il se prenait pour une cigale et restait parfois des heures accroché aux branches d’olivier au lieu de distribuer le courrier. On le mit à la retraite anticipée. Je proposai mes services. Et voilà le pourquoi de la chose »6.
Le cabot du garde-barrière
Notre conteur en chef nous a également légué l’histoire qui suit. Si surréaliste qu’elle est encore colportée dans les vieilles familles aramonaises.
Jamais de mémoire d’éléphant, le vent du sud chargé de sable n’avait soufflé avec une aussi grande force, au point que tous les arbres couchés du nord au sud d’un coup se redressèrent. Des jours pareils, nul ne sortait à l’exception des employés du service public, des hommes et des femmes de devoir, dont notre facteur Cappeau et sa bicyclette. Bref, c’était un temps à ne pas mettre un chien dehors et pourtant, il y en eut un, dehors :
le vieux cabot de la garde-barrière sur la route qui monte à Dève.
Cappeau devait livrer un courrier à Dève, et avec ce temps, ce n’était pas évident. Il prit donc la route, cette route qui monte. En atteignant la voie ferrée, il mit pied à terre pour la traverser, salua brièvement le vieux chien de la garde-barrière, puis il entreprit l’ascension du col de Dève et il pédala, pédala, en danseuse, en constante recherche d’équilibre pour se maintenir sur sa bicyclette. Arrivé au sommet de la côte et regardant machinalement le pédalier, il constata que la chaîne avait disparu ! Bigre ! Il mit pied à terre et chercha tout autour de lui, sur la chaussée, dans le fossé. Il fit quelques pas en arrière : toujours rien. Alors, il rebroussa chemin jusqu’au garde-barrière et là, il retrouva la chaîne égarée, luisante, comme neuve, en train de sortir maillon par maillon du cul du chien bigleux qui l’avait confondue avec un chapelet de saucisses et dévoré toute crue.
Joute verbale
Cappeau était bien le champion des conteurs (ou menteurs, comme on voudra). Mais les vieux habitués du Sénat éprouvaient parfois un peu d’ennui face à cette suprématie. Et, comme à l’école où l’on aime bien quand le premier de la classe fait une bourde et perd son auréole, les sénateurs aimaient bien qu’un tel ou un tel bataille pour dominer le débat et faire vaciller le roitelet.
Ainsi, il s’en trouva un qui faillit lui ravir la place. C’était par une fin d’après-midi de juillet, il faisait lourd et humide, une vraie chaleur tropicale. Sur le quai, du côté des Arènes, nos sénateurs bavardaient à propos de l’Afrique. A ce sujet, Louis le Bègue, ancien zouave au Maroc, faisait office d’expert :
« Vous, vous, me, me, croirez si, si, vous voulez… Un, un, jououour dans dans le Sud ma ma rocain, on on était dans dans le trrr…train et à à un un mo moment, il y y avait une telle quan-quantité de de cri criquets que que le trrr…ain n’avançait pluuuuus, il pa pa patinait. »
Les sénateurs se regardèrent les uns et les autres, pas fâchés que le Louis soit en mesure de clouer le bec à Cappeau, avec une histoire que personne n’était en mesure de vérifier et qui, de plus, avait des chances d’être vraie.
Piqué au vif, notre facteur roquemaurois prétexta une course à faire et s’éloigna – en fait, il avait besoin de réfléchir. Quelques minutes plus tard, de retour au Sénat, il dit à Louis : « Je conviens que ton histoire de criquets est bien. Mais elle est un peu courte ». Et à la manière d’un tribun de village, il annonça : « Vous le savez peut-être, dans ma jeunesse j’étais chef enfant de chœur. A ce titre, tous les dimanches, je tirais la grosse cloche pour annoncer les vêpres. Un jour où il faisait un temps pire qu’aujourd’hui, j’ai fait comme d’habitude, mais il n’y a pas eu de tintement, pas de son. Seulement un bourdonnement bizarre. Alors, je suis monté à l’échelle pour voir ce qui se passait dans le clocher. Plus je grimpais, plus il y avait de moustiques. Arrivé tout en haut, je compris pourquoi : le battant était enveloppé d’une couche de moustiques si épaisse qu’elle l’empêchait de frapper la cloche ».
Crocodilus Pétancus
J’ai sous les yeux une photo datant de 1900, représentant des Aramonais, un dimanche après-midi, en train de s’adonner à leur loisir favori, le jeu de boules. La scène se déroule bien sûr aux Arènes. A l’époque, le temps consacré au travail empiétait souvent le dimanche. Les moments de détente étaient rares et d’autant plus précieux. Le progrès est passé par là, aujourd’hui tout est inversé, on peut dire grosso modo que nos pétanqueurs d’aujourd’hui consacrent autant d’heures au travail que les anciens en consacraient aux loisirs, et inversement autant d’heures aux loisirs que les anciens passaient à travailler. Mais y éprouvent-ils autant de plaisir ?
Cette photo d’un dimanche du passé me rappelle qu’il y a fort longtemps le jeu de boules des Arènes était clôturé par d’imposantes haies d’épineux pratiquement infranchissables. Ainsi, toute boule qui, par maladresse, partait dans la haie était considérée comme perdue. Dire combien il y en avait, personne ne savait. De guerre lasse, nos sportifs décidèrent de détruire ces satanés épineux. Sitôt dit, sitôt fait, et à leur grande surprise, ils découvrirent une énorme bête reposant, raide morte, sur un tas de limailles, le ventre en l’air boursouflé comme si on lui avait fait des ventouses. On supposa que son estomac était plein des boules disparues. De plus, en bout de queue, une grosseur moindre, de la taille d’un cochonnet, faisait office de bouchon. On présuma que cette obstruction était à l’origine du décès de l’animal. Emus par cette découverte extraordinaire, les pétanqueurs décidèrent de l’empailler, de le baptiser « crocodilus pétancus » et de l’exposer au Planet. Ce qui fut fait, pour la plus grande joie des enfants du village, jusqu’à ce que, par un été de grande sècheresse, l’empaillé disparut dans la nuit.
Longtemps après, on découvrit qu’un paysan de la Palun, à court de paille avait dérobé la bête afin de la vider. En fait, c’est son épouse qui le trahit, en faisant son marché, toute fiérote avec un énorme sac à provisions en peau de crocodile… Moralité : on est toujours trahi par les siens !
Coup de main
Cette historiette est due à Jeanne Rosier (1880-1972) qui a mémorisé ses souvenirs par écrit, en provençal, dans les années 1950. En espérant que notre traduction ne l’aura pas trop dénaturée (titre original : « Quel bougre »)
C’était au mois de juillet, il faisait un cagnard à faire tomber la queue d’un âne. Comme à son habitude, le docteur Jullian prenait une absinthe au Café de Paris, sur le cours, à Tarascon. En compagnie de ses amis Bernard et Marius. Mais l’absinthe ne calmait pas la soif. Alors Bernard commanda un citron pressé. On lui apporta un citron coupé en deux et un verre d’eau. En le pressant, il n’en sortit qu’un petit travers de doigt. Marius qui avait l’habitude de faire du jus de pêche, à son tour esquicha le citron, mais n’en tira qu’un filet. Alors il tendit le fruit à Jullian : « Essaye donc, toi qui sais faire pisser le sang de tes patients ». Mais le docteur n’eut pas plus de succès.
Un monsieur, un étranger, les regardait faire depuis une table voisine, il s’approcha, prit le citron, le pressa et en fit sortir une demi-bouteille ! Moralité : l’inconnu sait souvent ce que nous ignorons et avons besoin de savoir.
Besingogne en Agenais
De tout temps, les Aramonais ont manifesté un goût pour le voyage à pied, à cheval, en voiture, en bateau, en train ou dans les airs – on dénombre même parmi eux, Zé, un sous-marinier. Sans oublier ceux qui voyagent dans leur tête (spécialité de nos sénateurs).
Rendons-nous deux siècles plus tôt sur les terres du Comte Gondrand de Bésingogne, propriétaire d’une vaste étendue de vergers uniquement plantée de pruniers. En ce temps-là, une foule de manants se pressait pour cueillir les prunes (et souvent pour des prunes). Aussitôt la récolte terminée, il était de tradition que les ramasseurs, peu ou pas payés, protestent contre leur condition en défilant la nuit, éclairés de lanternes et de torches, bras tendus, paumes en l’air, avec le majeur fermement dressé vers les cieux. Cette procession avait été baptisée la dinloubaba (patois local intraduisible). Gondrand de Bésingogne prenait de plus en plus mal la chose, d’autant que le cortège s’arrêtait sous les murs de son château. Un jour, plus irrité que d’habitude, il imposa au clergé et aux notables de déclarer ce défilé illégal. Ceci ajouté au reste, les ramasseurs prirent fort mal la chose et firent la Révolution, le Comte perdit la tête et les vergers changèrent de mains.
Les années qui suivirent, les récoltes furent de moins en moins abondantes, les nouveaux propriétaires des pruniers n’eurent pas la largesse escomptée, mais la procession put reprendre. La gestuelle des protestataires devint si populaire que même des arbres l’ont adoptée (voir photo).
De nos jours, bien que cette coutume soit tombée en désuétude, on peut encore voir çà et là des individus mécontents dresser un majeur vers ciel – d’aucuns prétendent que c’est génétique. Alors, si vous observez ce phénomène, ne vous inquiétez pas, il s’agit simplement d’un descendant des cueilleurs de prunes du Comte de Besingogne en Agenais.
Le pouce et le manchot
Nos sénateurs, en bons « pistachiers » qu’ils étaient, observaient sans vergogne toute jupe ou robe qui passait (exceptée la soutane du curé Vialat). Comme des girouettes, leurs cous s’étiraient et oscillaient en même temps, dans la même direction, suivant la trajectoire de la passante. Et une fois la « proie » hors de vue, les têtes reprenaient leur position initiale et les commentaires fusaient. Où qu’ils se trouvent aujourd’hui, certains de ces reluqueurs de village doivent regretter de ne pas avoir, de leur vivant, connu la mode des mini-jupes.
Un jour, une jeune maman passait par le Sénat, en tenant par la main sa petite fille qui suçait goulûment son pouce. Elle la réprimanda : « A force de le sucer, tu vas l’user ».
Entendant cela, un sénateur eut un éclair de génie. Il exhiba la manche de sa veste, vide d’un bras laissé à Verdun et dit à la petiote : « Ta mère a raison, quand j’étais petit, j’ai commencé comme toi et regarde le résultat ». Terrorisée, la gamine se mit à hurler si fort qu’on l’entendit de l’autre côté du Rhône. A-t-elle cessé de sucer son pouce ? Sans doute.
Les crabes géants
Ces histoires « extraordinaires » surgissaient de l’esprit de braves gens, au gré des petits et grands événements. Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges.
Ainsi, un jour de grosse chaleur, agacés par un groupe d’enfants qui couraient bruyamment à travers les ruelles, les vieux du Sénat les interpellent :
« Oh les jeunes ! Venez par ici. » Les petits s’approchent du banc des vieux : « Vous les avez vus ? » demande l’un des sages.
- Quoi ? Quoi ? répliquent les gamins piqués au vif, car la curiosité, c’est bien connu, est aussi une qualité de la jeunesse.
- Les crabes, répondit le sage.
- Quels crabes ?
- Dans le Rhône.
- Pffeuu, les crabes, c’est au Grau-du-Roi, dans la mer. Ya pas de crabe dans le Rhône, répondit un garçonnet sûr de lui.
- Alors, c’est que vous les avez pas vus.
- C’est sûr, ils ne les ont pas vus, parce qu’ils n’ont pas bien regardé, renchérit un autre sage.
- C’est des crabes communistes, dit le premier. Ils sont arrivés par la mer et ils rongent les rives du Rhône. Mais comme vous en avez jamais vus, vous savez pas ce que c’est, vous pouvez pas savoir.
- Surtout des crabes communistes géants, répliqua son compère.
- C’est vrai qu’il faut bien regarder pour les voir… »
Aussitôt, la bande de gamins s’enfuit à toutes jambes en direction des quais (là où il leur arrivait parfois de voir des castors aventuriers qui visitaient le bas des digues). Pendant de longues minutes, ils regardent les rives du fleuve, scrutent le paysage, il y en a même un qui se risque à crier : « Là, là, j’en ai vu un, dans le trou d’eau, il est énorme ! » Et un autre qui veut faire son intéressant : « Moi aussi, je l’ai vu, je l’ai vu, il est tout rouge ».
En fait, il y avait vraiment quelque chose à voir : les énormes pelleteuses qui s’agitaient au bord du Rhône pour la canalisation du fleuve. Nous étions également dans les années de « péril rouge » dites de Guerre froide.
Vous l’aurez compris, à Aramon, l’imagination était contagieuse. Sans doute y eut-il d’autres sénateurs et d’autres fables que j’ai oubliés ou ignorés et dont le souvenir égaye encore la conversation de quelques Aramonais. Je serais heureux de les entendre.
is et des peines de la jeunesse en pleine croissance.ci passe par là. patients et tenaces les Aramonais. �����������������������
. 4 .
Histoires d’eaux et de pêcheurs
Le fleuve-roi
Vous le présenter est inutile, tout le monde sait de qui
il s’agit : un fleuve puissant qui dévale de la Suisse jusqu’à
la Camargue.
Le Rhône fut une source de prospérité durant des siècles : sans lui, il n’y aurait pas eu d’Aramon ni de port pour commercer les produits de nos campagnes avec les bateliers et la célèbre Foire de Beaucaire. Ni de roseaux ni de poissons ni d’histoires de pêche miraculeuse à raconter aux enfants. Le Rhône fut aussi source de misères : l’Histoire du village est parsemée de nombreuses crues, d’inondations, d’incendies aussi. On peut dire qu’ils sont patients et tenaces les Aramonais. Que de courage et de détermination, il leur fallut pour surmonter les désastres et reconstruire. Toujours. Comme s’ils puisaient leur énergie vitale dans la puissance du fleuve.
L’ami Denis m’a confié son souvenir d’une coutume contrariée par le fleuve : chaque 11 novembre, tous les écoliers défilaient à travers le village, avec des fleurs à la main. Ils se rendaient en haut du Planet, au pied du monument aux morts pour y déposer leurs bouquets. Ces fleurs demeuraient là pendant des jours et des jours, elles fanaient doucement. Excepté en 1935, le Rhône envahit la ville et le lendemain du 11 novembre, les Aramonais assistèrent au défilé des fleurs entraînées par le courant.
Le pont qui reliait Aramon aux terres de Provence, longtemps espéré, enfin bâti en 1900, fut détruit le 15 août 1944 par un « essaim » de bombardiers (un seul aurait suffi, mais les pilotes ont loupé la cible – la faute à l’escarbille dans l’œil ou au verre de trop). Ainsi pour gagner l’autre rive pendant les trois décennies qui suivirent, les habitants d’Aramon durent emprunter un antique bac. A ce propos : ayons une pensée reconnaissante pour les vieux « loups de mer », les bateliers Gabriello, Simon, Labattut, Anthaume et Malandran. Grâce à ces « professeurs » mariniers, on peut affirmer que tous les Aramonais passèrent leur bac avec succès.
De nos jours, pour les vieilles familles dites « de souche », il y a deux Rhône : celui « d’avant » et celui « d’à présent ». Celui qui compte, celui qui est dans leurs gènes et dans leurs cœurs, c’est celui d’avant. Celui qu’on leur a « volé » en canalisant le fleuve et en fermant leur quai aux péniches et aux chalands.
Allez, suivez-moi, je vous emmène dans les îles. Non pas en bateau (quoique), mais à pied.
La Gardette
A l’heure de la sieste, je me tourne et me retourne vainement dans mon lit dans l’espoir de trouver le sommeil. J’ai mis les volets en cabale pour filtrer la lumière. Il règne un « grasillas » épuisant. Dans la rue, pas un bruit. Le village est plongé dans la torpeur. Seul un avion, au loin, y va de son ronronnement.
Enfin, sur le coup de 5 h, ma mère m’appelle : « Descends vite, ton père est prêt ». Je dévale l’escalier quatre à quatre et un instant plus tard me retrouve sur le porte-bagage du vélo de mon père, en route pour l’île du Marquis. Pierre, mon cousin bagnolais nous suit en courant comme un lévrier, il porte le fusil qui, le soir venu, fera un mauvais sort à un garenne imprudent. Nous saluons au passage les Maurin (fermiers du marquis) qui ont repris leur labeur et nous atteignons rapidement le bout de l’île, au lieu-dit la Gardette, au bord du grand Rhône.
Les pêcheurs y ont bâti une « fraisse » avec des piquets et des canisses afin de dévier le courant. Là, le poisson trouve un havre de repos, mais pas sans risque. Mon pêcheur de père sort sa canne, aligne les plombs, accroche l’asticot à l’hameçon et balance sa ligne dans l’eau. A chaque coup de sillon, il ferre et ramène une grosse ablette. Je suis chargé de ramasser les poissons dans l’herbe pour les glisser dans la musette. Entre deux prises, j’observe le ballet des martins-pêcheurs qui rapportent la pitance à leurs petits nichés dans des trous creusés à même la falaise. Ce n’est qu’à la tombée de la nuit que nous plions bagage. De retour à la maison, sitôt le repas avalé, me voilà à la rue pour retrouver les copains et mijoter quelques mauvais tours pour nous distraire.
La Palun
Partons au nord du village, au lieu-dit l’îlon avec ses « caisses » (sorte de retenues d’eau) aménagées pour alimenter le chenal et permettre par bas Rhône la navigation des bateaux. Nous arrivons en amont du pont bombardé en 1944, au pont « moderne », face au défunt moulin de Bassot,
A noter que Rhône et Gardon semaient certes, le désarroi, mais en se retirant, comme pour s’excuser, ils laissaient derrière eux une épaisse couche de limon fertilisant naturellement les sols. Le fleuve filait tout droit dédaignant Aramon, ne se servant du village que comme déversoir (humiliation suprême). Après crue, il défilait d’abord au plan d’eau, au bas du quai. Puis au lieu-dit l’îlot d’Alfred. Ensuite aux Agasses et au Sillard. Au passage, il nourrissait les poissons avec les résidus de l’abattoir. Il atteignait enfin l’île des Sandres où des « martières » (vannes) permettaient, le cas échéant, d’évacuer les eaux vers la Palun et de créer une zone de rétention. Il offrait ainsi un vaste étang provisoire avec des carpillons par milliers, permettant aux gamins de faire leurs premières armes de pêcheur. A condition d’être enduits de vinaigre pour échapper à l’agression des moustiques qui y étaient légion. Et les pères suivaient, eux, munis de fusils, escortés de chiens d’eau grâce auxquels ils avaient tôt fait de garnir les gibecières de râles, poules d’eau, canards sauvages et parfois bécassines.
Mais, depuis que le Rhône est endigué, la Palun est devenue une terre à céréales.
Le sous-marin
Il y avait une langue de sable redessinée par les eaux du fleuve, chaque fois que celui-ci sortait de son lit. Surnommée par les jeunes, le sous-marin, pour sa forme et parce qu’elle apparaissait-disparaissait au gré des crues et décrues. Terrain d’aventure, terrain de jeux et d’initiation, ce fut le théâtre des émois et des peines d’une jeunesse en pleine puberté. Ainsi les parties de cache-cache, d’abord innocentes, sans arrière-pensée ; puis virant en guérillas entre bandes rivales où les gamins s’affrontaient comme de jeunes loups pour devenir chef ; enfin « champ d’expérimentation » avec les premiers baisers salivés entrecoupés de serments d’amour éternel et de cours d’anatomie.
Les crues du fleuve qui menaçaient notre insubmersible étaient une grande source de curiosité. Soudain, on entendait : « Il arrive ! » Effectivement, un léger filet d’eau donnait l’alerte. Il se muait rapidement en ruisseau, puis en rivière. Le soir même, on trouvait des équipes de guetteurs constituées de volontaires qui parcouraient les digues, les renforçant si besoin, si possible, pour éviter que ça empire.
Par grande crue, nous regardions, impuissants, la montée des eaux qui avalaient les marches une à une, en vérifiant la hauteur, le niveau, à l’étiage. Et là, on garnissait les passages de batardeaux : deux planches épaisses coincées dans les crans, et entre, des sacs de sable. Il arrivait que l’on touche l’intrépide crue du bout des doigts, en se penchant du haut du quai.
La surveillance des bénévoles se déroulait nuit et jour, aussi longtemps que nécessaire, jusqu’à ce que le fleuve s’apaise. J’ai toujours été frappé par ce mélange de crainte et d’exaltation que l’on ressent lorsqu’on affronte un moment « peu ordinaire ». Précisons que chaque fois que l’on relevait les équipes de volontaires, ces derniers se voyaient offrir, à toutes heures, des saucisses et du vin blanc.
Le Papé et le gardon
Du côté de l’île du Marquis, le puissant Rhône avait débordé au-delà de son lit en une petite langue d’eau foisonnante de carpes et autres bestioles aquatiques. C’est là, dans ce plan d’eau, mi-étang, mi-lagune, qu’un « héminquouai »7 du coin, le Papé, se rendait chaque après-midi autant pour profiter de la quiétude des lieux que pour garnir sa musette. Il savait qu’un gardon de belle taille hantait les lieux et le narguait parfois en faisant retentir la clochette fixée au bout de sa ligne alors que notre brave homme s’était assoupi. Le poisson bondissait hors de l’eau puis disparaissait, parfois pendant des semaines. Un jour cependant, notre gardon plus téméraire qu’à l’accoutumée se fit hameçonner. Le papé, tout fiérot de sa prise était en train de le décrocher pour le glisser dans sa musette, quand soudain il songea : « Et demain, je ferai quoi ? » Alors, il libéra le poisson et le regarda s’échapper à travers flots, en son domaine.
Le lendemain, notre Papé revint sur les lieux. Et le gardon renouvela son manège. Notre homme prit soin de ne plus utiliser d’hameçon. Il se contenta d’attacher un ver au bout de sa ligne.
Il en fut ainsi chaque jour de chaque saison qui suivirent jusqu’à ce que notre Papé rende l’âme. Son voisin, connaissant ses habitudes et lui ayant juré de prendre la relève « au cas où », se rendit au plan d’eau avec sa canne à pêche et quelques vers de terre. Et là, arrivé sur les lieux, il vit l’énorme poisson flottant en surface, le ventre en l’air. L’homme décida de ramener la bête et, avec l’accord de la famille, l’on mit le Papé en terre en compagnie de son gardon.
Dans les semaines qui suivirent, il y eut un heureux événement : la naissance du premier arrière-petit-fils du Papé. Je me souviens très bien, c’était un 11 novembre, pour la Saint-Martin. Lassé de flemmarder dans son lit depuis une bonne décennie, le Rhône eut besoin de « se mettre au large », sans doute pour vérifier si Aramon était toujours à la même place, il déborda. Ce jour-là, carpes et brochets se planquèrent dans les fonds, sous les racines, car au cas où vous l’ignoreriez, ces poissons ont horreur que le fleuve les entraîne vers l’eau salée (question de goût ?) Quand le fleuve regagna son lit, les plans d’eau retrouvèrent leur quiétude, les poissons et autres faunes aquatiques proliférèrent à nouveau. Alors, qui sait ? L’arrière-petit-fils du Papé, devenu grand et à son tour passionné de pêche a peut-être trouvé son gardon.
L’île des Sandres dite « Massagaoute »
Petit retour en arrière, durant les années de l’Occupation. Mon père, le boulanger de la rue Pitot, n’ayant plus de farine et donc de pain à pétrir, se trouva en vacances forcées. Il décida de nous emmener faire du camping (ma mère, mes frères et moi) à l’île des Sandres située entre Aramon et Montfrin.
Pour accéder à l’île, on devait emprunter une barque afin de franchir la Laune. A nos yeux de gamins, cette traversée, c’était une vraie croisière.
Là, dans une ferme, demeuraient le père Arnaud, un cousin, et sa famille. Les bâtiments étaient assez vastes pour nous offrir un toit. Pour des enfants, à l’époque, l’endroit était paradisiaque, on pouvait gambader tout notre saoul. La nature s’offrait à nous dans ce qu’elle avait de plus « sauvage ». Les lapins épargnés par la pénurie de fusils (réquisitionnés pour cause de guerre) étaient légion. Quel bonheur, à la tombée du jour, de voir des portées de lapereaux courir dans l’herbe comme des fous ! Certains étaient orphelins – leurs parents s’étant fait piéger par les « collets » d’un jeune homme réfugié à la ferme pour échapper aux STO. Grâce à quoi, nos menus comportaient souvent du lapin en civet ou rôti en broche. En dépit des risques, les mères et tantes se rendaient de temps en temps au village pour en rapporter quelques denrées et nouvelles. Un soir, sur le chemin du retour, au niveau du petit pont, elles eurent droit à des salves de moustiques et à un vol en rase-motte d’avions militaires. Pour échapper aux uns comme aux autres, elles se jetèrent avec leurs bicyclettes sous le pont, en fait un fossé débordant de ronces… Elles en ressortirent avec de grosses égratignures de la tête aux pieds.
Avec mes frères et mes cousins, du haut de nos dix ans, tout était jeu et aventure. Nous n’avions pas conscience des dangers.
Cependant, un matin où nous étions au bord de l’eau, nous avons eu la frousse de notre vie. Une péniche allemande remontant le Rhône fut mitraillée et coulée par un avion qui vola au-dessus de nous, si proche que mon frangin qui était en train de satisfaire un besoin des plus naturels, abrégea et se mit à courir, cul nu, avec sa culotte au bas des jambes (cette image, vu les circonstances, est gravée à jamais dans mon esprit). Je vis alors le jeune homme réfugié à la ferme, se mettre à l’eau et nager vers la péniche. Peu lui importaient les blessés, les survivants, il fit plusieurs allers-retours, ramenant à chaque fois des bottes, une tenue kaki, des couteaux, des munitions, etc.
Peu après, il y eut une descente de miliciens. Ils fouillèrent de fond en comble le mas du père Arnaud. Qui ou quoi cherchaient-ils ? Je ne l’ai jamais su. Le seul recoin que les miliciens oublièrent de visiter fut le tiroir de la machine à coudre où le père Arnaud planquait un révolver. Ouf !
Ces événements incitèrent mes parents à nous ramener à la maison dont les caves voûtées aux murs épais leur semblaient plus sûres que l’île des Sandres et la ferme du cousin.
J’en ai gardé le souvenir de magnifiques vacances.
En août 1944, le pont fut détruit. Le bac prit du service.
La trêve des Agasses
Cadon (Cadoun) et Capelette, ainsi se nommaient nos deux personnages, des cultivateurs. Ils étaient voisins, rivaux et proches l’un de l’autre sans le savoir et surtout sans le vouloir. Depuis quand cela durait-il et pourquoi ? Je l’ignore.
Primo, leurs terrains mitoyens se trouvaient aux Agasses, à l’extérieur du Lévadon, et donc en première ligne quand le Gardon était en crue.
Deuzio, ils étaient très fâchés. Habiter à proximité l’un de l’autre nécessitait de leur part des ruses insensées pour s’éviter. Par exemple, s’ils travaillaient dans leurs champs, ils s’ingéniaient à se tenir aussi éloignés que possible l’un de l’autre en se tournant le dos. Ils faisaient mine de sarcler, pliés en deux, chacun regardant entre ses jambes ce que faisait l’autre. Si, cheminant à bord de leur jardinière, leurs véhicules se croisaient, ils tournaient la tête pour ne pas se voir et tiraient même sur les rênes pour éviter que leurs chevaux se regardent.
Dieu merci, il y a parfois de circonstances, des « cas de force majeure » qui s’imposent.
Une nuit, le tocsin se mit en branle, réveillant tous les habitants. Les Aramonais se réunirent au Planet et apprirent que le Gardon menaçait d’envahir les terres du quartier des Agasses.
Ils s’y rendirent au pas de course pour mettre à l’abri le matériel et protéger tout ce qui pouvait l’être. Et là, ô miracle, on vit Capelette et Cadon se tendre la main en disant à l’unisson à l’attention de tous : « On n’est plus fâchés ». Ils luttèrent côte à côte. Puis réfugiés sur la digue, ils regardèrent les eaux envahir leurs terres.
Il n’y avait plus rien à faire et la nuit n’était pas terminée. Chacun s’apprêtait à regagner ses pénates. Et là, au su et au vu de tous, Capelette et Cadon se serrèrent à nouveau la main en disant : « Bon, maintenant, on est à nouveau fâchés ». Alors je me demande : leurs descendants sont-ils encore fâchés ?
2002
Transportons-nous en 2002 qui fut pour le pays une année noire faite de deuils et de détresse. Ce maudit 9 septembre qui a vu le Gardon déferler en une grande vague profitant de l’état vétuste de la digue ouest – laquelle paraissait désuète (à 8 km de la rivière). Dès le lendemain, on assista à une autre vague, heureuse celle-là, qui eut pour nom Solidarité. Des légions de bénévoles vinrent au secours des Aramonais en bottes et treillis (pompiers de Brignoles, groupe d’intervention de Nogent-le-Rotrou, etc.).
Grâce au courage des habitants d’Aramon et aux aides reçues, 65 jours plus tard, relevant le défi, nos concitoyens offrirent aux visiteurs une belle foire de Saint-Martin, chargée d’émotion.
Il nous reste un petit miracle, La poupée de Charlotte, une chanson écrite et composée sur-le-champ par Gaëlle, une artiste aramo-lozérienne, qui démontra si besoin était que les chants les plus désespérés sont souvent les plus beaux.
. 5 .
Rayon farces (cruelles)
Combien de martelets, de sonnettes et de bâtons de soufre avons-nous agités pour nous distraire, semer la zizanie et troubler la tranquillité des papés et des mémés (que nous sommes à présent) ? Que de vergers chapardés pour assurer notre « quatre heures » ! Que de stupides blagues ou rivalités avons-nous fomentées envers de braves voisins souffre-douleurs ! Le passage au conseil de révision (où se décidait si nous étions aptes ou pas au service militaire) était une sorte d’apothéose, ce jour-là tous les mauvais coups étaient permis et nous troublions l’ordre public toute la nuit.
Mea culpa
Te souviens-tu, Gabrielle ? Tu nous pourchassais avec ton escoube et nous esquivions tes coups en une sorte de corrida improvisée sur le Planet avec force passes et véroniques. Plus tard, profitant de ton sommeil, nous avions muré ta porte avec des moellons et du ciment.
Tes voisins ne furent pas épargnés. Profitant de leur repos, nous déplacions tous les pots de fleurs des uns chez les autres et le lendemain, ils avaient bien des difficultés pour les récupérer sans se les disputer.
Demandons pardon à Totor Maigret pour toutes ces heures qu’il a dû consacrer à nous poursuivre dans le parc du château. Pardon également, au Garde Rouquette, dont le serin est mort de peur, affolé par nos beuglements de conscrits avinés et imbéciles.
Paquet cadeau
On ne peut passer sous silence le cruel et désagréable cadeau que nous avons fait à Marie-Jeanne la roubaïre. Nous étions en (grandes) vacances et cherchions bien sûr à nous distraire, le sujet le plus inspirant ce jour-là, ce fut elle. Connaissant ses habitudes, ses horaires et sa tendance à s’approprier le bien des autres, nous eûmes l’idée de confectionner un joli paquet à l’adresse de Monsieur Jules Martin, drapier, le Planet, Aramon. A l’intérieur, nous avions bien tassé de la fiente animale. A 14 h, en plein été, la rue Pitot était toujours déserte. L’un de nous fit le guet et sitôt notre « proie » en vue, le colis fut déposé devant sa porte. Elle arriva avec sa brouette et soudain, tel un chien de chasse, elle planta l’arrêt : ni une ni deux, elle fondit vers le paquet, le mit dans son tablier et entra précipitamment chez elle. La suite est facile à deviner : furibarde, elle ressortit et, dans la cour avoisinante, s’empara d’un balai et d’une pelle à charbon pour se débarrasser du cadeau. Même ma mère, pourtant peu portée à se moquer, était pliée en deux de rire.
Monsieur Ferrier
Heureux le temps de l’école communale. D’abord la maternelle, les balbutiements, des ronds, des carrés et des croix sur l’ardoise, des crayons de couleur, des jeux de cubes et de ballons... Puis l’école des grands, blouse obligatoire, encre violette, mappemonde et vieux tableau noir. Là nous attendait Monsieur Ferrier (assisté de son épouse pleine de douceur).
Il nous inculqua le sens de la discipline et le goût des études à coups de sabot. Comme le bougre avoisinait les deux mètres, sa pointure allait de pair, il chaussait au moins du 50 et on le sentait passer.
Monsieur Ferrier avait le goût de la musique et, outre l’enseignement des matières classiques, tenta de nous initier au chant choral. Au départ, ce fut très très laborieux (façon envol de colverts). Nous apprîmes le solfège et à force de persévérance et d’application, notre petite troupe réussit à chanter correctement et à se produire, de-ci de-là, à la demande. Je me souviens d’un « spectacle » à Marguerites – ce qui, pour nous, tenait de l’épopée. Nous exécutions (le mot est juste) un triomphal « Gloire immortelle de nos aïeux… Dirige nos pas… Dirige nos pas » (vers la sortie), sous les applaudissements des gens du coin, tout heureux en ces temps de guerre d’avoir pu échapper à leur train-train quotidien et oppressant.
Sur les injonctions des autorités de Vichy, le brave Ferrier fut contraint de nous apprendre le célèbre « Maréchal, nous voilà ». Mais notre maître dégrada le maréchal en général.
Je nous vois encore avec l’ignorance et l’inconscience de nos dix ans brailler dans la rue : « Général, les voilà ces p… qui trahissent la France, elles auront pour affront le ballon de la collaboration » précédant un groupe de pauvres filles, encadrées par de vaillants résistants de la dernière heure qui s’étaient improvisés « coiffeur » pour les punir. Le « péché » de ces jeunes femmes (avoir fait les yeux doux à quelques Teutons blonds) était bien léger au regard des atrocités et trahisons commises par d’autres et restées impunies. Finalement, elles furent européennes avant l’heure.
Faits d’armes
L’arrivée des Germaniques dans le sud de la France, je la vécus chez ma grand-mère, à Bagnols-sur-Cèze (précisément au n°22 route de Nîmes). Mon frère et moi avons accueilli les envahisseurs à grands coups de grimaces jusqu’à ce que notre grand-mère, paniquée, nous attrape par le col et nous enferme dans l’épicerie voisine (Mr Arnaud).
Mais l’épisode qui suit s’est déroulé en 1944, à Aramon, durant les grandes vacances.
Les Allemands qui occupaient notre coin devaient céder la place à une unité de l’Afrikakorps (je crois). Ils déménagèrent en laissant deux motards en faction chargés d’attendre et accueillir les remplaçants.
Notre joyeuse et turbulente bande de gamins qui n’avait rien de mieux à faire que d’observer les motocyclistes, remarqua qu’ils étaient ronds comme des queues de pelle et ronflaient comme « sonneur ». La fascination que les armes exercent sur les jeunes garçons est bien connue. L’un d’entre nous eut donc l’dée d’aller à l’arrière du (futur) Bar des Sports où étaient entreposées des caisses de munitions allemandes, entre autres des bandes de mitrailleuses et des grenades d’entraînement dites « en plâtre ».
L’accès à la cure étant à deux pas, la bande décida d’y transférer tout ce qu’elle pouvait. Je dois dire que nous n’étions pas peu fiers de cet acte héroïque et un peu fadas.
Le soir venu, Jeannot emporta quelques échantillons à son mas, route de Théziers, et aidé d’une paire de copains, les enterra au fond du jardin où normalement, il devrait y en avoir encore.
C’est là que nous nous sommes livrés à un nouveau jeu (qui changeait des parties de cache-cache) : le lancement de grenade à manche désamorcée !
Secret de famille
Dans les villages du Midi réputés pour leurs galéjades (voir Pagnol et Giono), même dans les années 1950, on demeurait muet quand il s’agissait du secret des sources, des grottes, des cachettes ou des terres fertiles. On le transmettait seulement de génération en génération. Beaucoup se sont perdus.
Antoine avait donc un secret de famille, mais pas de descendant à qui le léguer. Un jour, il se dit : « J’ai 65 ans, il faut que je le confie à quelqu’un ». Lors d’une partie de chasse avec Auguste, son ami d’enfance, il entraîna ce dernier près d’une masure sans toit, bouffée par le lierre, et lui dit :
« Tu vois cette ruine de mazet, nous l’avons dans la famille depuis la nuit des temps. Eh bien, il y a un secret, une richesse.
- Et c’est quoi cette richesse ?
- C’est tout bête : de l’eau, beaucoup d’eau. A l’intérieur, à 8 ou 10 mètres de profondeur. Mais je me fais vieux, j’ai pas envie de suer sang et eau ni de dépenser mes économies pour creuser… Mais quand même j’aurais bien aimé savoir ».
Auguste réfléchit un moment et dit à Antoine : « Tin faguès pas (ne t’en fais pas), j’ai peut-être une solution ».
Quelques jours plus tard, Auguste battait la campagne avec sa pétoire en compagnie d’un autre chasseur, Léon. Celui-ci, bâti comme un Hercule, était un personnage solitaire, réputé radin et cupide. Les deux compères atteignirent la masure sans toit pour faire une pause. Auguste dit :
- « Je vais te dire quelque chose, mais tu me promets de garder ça pour toi ?
- Bien sûr, répondit Léon.
- Eh bien voilà : ça s’est passé en 1944, j’étais dans le coin, je relevais mes collets quand j’ai entendu un bruit de moteur. C’était un camion allemand. Je me suis caché. Et j’ai vu une poignée de fridolins armés de pelles et de pioches, venir au milieu de cette masure et creuser pendant une paire d’heures. Puis, ils ont sorti du camion une grosse cantine et l’ont enterrée dans le trou. J’ai attendu qu’ils partent et je me suis dépêché de rentrer chez moi. Après la Libération, je suis revenu voir. Rien n’a bougé. Ils n’ont pas récupéré leur cantine. »
Auguste laissa passer quelques semaines, en cheminant de temps à autre du côté de la masure. Un jour, il constata que quelqu’un s’activait entre les quatre murs bouffés par le lierre : sur un tas de remblais se trouvaient pelle, pioche, seau et échelle de corde. Jour après jour, le tas de terre grossissait. Un matin, il y revint avec son ami Antoine, le propriétaire des lieux. Ce dernier découvrant Léon à pied d’œuvre s’exclama : « Tu fous quoi là ?!? Tu es chez moi ! »
Pris sur le vif, Léon ne sut que répondre, il bredouilla quelques mots, ramassa ses outils et disparut. Antoine fut soulagé, il venait de percer le secret dont il avait hérité et Auguste fut content d’avoir rendu service à son ami. Lors des parties de chasse suivantes, les deux compères prirent l’habitude de faire une pause au vieux mazet, le temps de savourer un pastis à l’eau de source.
Souvenirs cuisants
Au lendemain de la guerre, mon frère ainé et moi-même avions décidé qu’il était temps de faire nos premières « armes ». Nous avons emprunté une des carabines de notre père, bien sûr sans lui en demander l’autorisation. Nous avions un copain, Etienne, qui fabriquait des cartouches artisanales et les revendait à qui voulait. Nous en avons acheté une dizaine et, ainsi outillés, nous avons gagné notre terrain de chasse, à l’arrière de la chapelle Saint-Martin (aujourd’hui cimetière) où une colonie de pies animait les arbres.
Mon frère, m’imposant son droit d’aînesse s’empara de neuf cartouches avec lesquelles il « aspergea » l’arrière de la chapelle, sans faire une victime parmi les pies, je tiens à le préciser. Puis il me tendit généreusement l’arme et la cartouche restante sans me dire qu’elle lui avait paru « douteuse ». Et se plaça, dans mon dos, bien en arrière.
Innocent, benêt, j’appuyai sur la gâchette, entendis un grand bruit et me retrouvai tout étourdi avec la carabine en deux morceaux dans les bras (Dieu merci, sans autre dommage) et ruminant en moi-même : « Cette fois-ci, Caïn a loupé son coup ! »
Les choses en seraient restées là, si nous n’étions pas tombés nez à nez avec l’auteur de nos jours revenant de chasser le gibier d’eau à La Palun.
Je n’ai pas compté combien de coups nous avons reçus. Je me souviens que nous sommes rentrés à la maison au pas de course, avec la carabine réduite en une dizaine de morceaux et l’échine plus que douloureuse. Et au lit sans dîner.
Rassurez-vous, je n’en ai jamais voulu à mon aîné. Et pourtant…
Le marin de Domazan
Ce matin-là, le fils du forgeron de Domazan avait le cœur en joie. Il venait de décrocher son premier rendez-vous ! Pour le soir même. Dans l’impasse à Guigne, sous la frondaison des glycines. Dire que la journée lui parut longue, c’est un euphémisme, il bouillonnait d’impatience.
Le soir venu, notre gaillard songeant aux minutes à venir avec délice se fit propre et beau. Ce qu’il ne savait pas, le pôvre, c’est que la belle qu’il croyait avoir séduite n’était en fait qu’une perfide complice de ses soi-disant amis. Passons rapidement sur les faits : notre héros fou de désir, enlaça la créature peu farouche et, s’aventurant à explorer les parties intimes, fut stupéfait de trouver une protubérance en lieu et place d’un puits d’amour. La pseudo-belle se dégagea dans un éclat de rire, à l’unisson de la bande de sacripants qui observaient la scène.
Le lendemain, notre jeune forgeron, blessé et honteux se terra chez lui, le soufflet de sa forge émit de longs et profonds soupirs au diapason de sa peine. Inutile de préciser que sa mésaventure avait fait le tour du village. Les jours suivants, on apprit qu’il s’était engagé dans la marine.
Quand à la belle traîtresse, le plaisir de cette blague fut bien éphémère, elle fut qualifiée de garce et mise à l’index. Rongée par le remords, on ne la vit plus dans aucune fête. On raconte même qu’un soir, elle se rendit chez les parents du marin, mais rien ne filtra de cette entrevue.
Le temps passa.
Marseille avait mis sa robe grise pour accueillir un bateau à l’accostage, une pluie fine et triste accompagnait l’arrivée d’une escouade de pompons rouges. Le fils du forgeron était parmi eux. Et dans la foule des familles qui se pressaient sur le quai, se tenait la traîtresse repentante et trempée autant de larmes que de pluie : « Je te demande pardon » dit-elle au jeune homme.
Alors, à Domazan comme ailleurs, les choses ont changé. Le fils du forgeron, l’ancien marin, a remplacé la forge par un garage agricole devant lequel sont alignés des tracteurs rutilants. L’ancienne « traîtresse », elle, est à l’intérieur, derrière la vitre du bureau et participe à la bonne marche des affaires.
Au village, on les surnomme poutoun et poutoune (ce qui en patois local signifie « un baiser ») parce que ces deux-là, fous amoureux, ne peuvent se croiser sans s’embrasser.
Romain
Au registre des farces un peu cruelles, on peut citer la fâcheuse aventure que subit le membre d’une bande de garçons et filles. Pour l’honneur de la malheureuse victime, je travestis son nom et dans ces pages, le nomme Romain.
C’était pendant l’Occupation, il y avait beaucoup d’interdits et de contraintes dont le couvre-feu. Les rues étaient sombres, les vitres extérieures des maisons étaient peintes en bleu nuit afin de ne pas attirer l’attention des avions de chasse et les jeunes se distrayaient comme ils pouvaient. Que faire de ses soirées, sinon s’adonner au « sport national » qu’est la belote.
Au sein de la bande se trouvait notre brave Romain qui, manque de chance, était affublé d’une forte myopie et d’une horrible paire de lunettes. Bref, c’était notre souffre-douleur.
Un soir, notre Romain s’était assoupi, ses copains éteignirent toutes les lumières et simulèrent une partie de carte dans l’obscurité, criant « Belote et rebelote ». Notre myope
se réveilla en sursaut, affolé et cria : « Ca y est, les copains je suis aveugle ! » jusqu’à ce qu’une âme charitable actionne l’interrupteur.
Ses soi-disant copains ne s’arrêtèrent pas là. Quelque temps plus tard, par un beau dimanche d’été, ils partirent dès l’aube, à bicyclette, pour se rendre au Grau-du-Roi. Fallait-il en avoir du jarret pour se lancer dans un tel périple ? C’est dans ce petit port de pêche qu’ils firent la connaissance d’Aglaë, une Avignonnaise en vacances chez une cousine. Tous les garçons lui tournaient autour. Mais Aglaë remarqua Romain, timide et complexé, qui restait à l’écart. Elle eut quelques mots de gentillesse pour lui. Le jeune homme en fut tout remué. Et lorsque la belle regagna la Cité des papes, Romain nourrit l’espoir de la revoir, ce qui n’avait pas échappé à ses comparses.
Un jour se présenta le facteur Cappeau avec une lettre : « Romain, c’est pour toi, la lettre vient d’Avignon ».
Lorsque le week-end suivant, la bande se retrouva pour préparer la sortie du dimanche au bord de la mer, Romain leur dit : « Ce sera sans moi, je ne suis pas libre », sans donner de détails.
Quand ils revinrent du Grau-du-Roi, pas de trace de Romain, chacun rentra chez soi. Sauf que sur les 2 heures du matin, l’un deux fut réveillé par la mère de notre myope qui frappait aux volets : « René, René, Romain n’est pas rentré, tu sais où il est ? ». René répondit qu’il l’ignorait. Affolée, la pauvre femme tourna et vira dans tout le village quand, alors que le jour pointait le bout du nez, elle vit apparaître son fils, titubant, pâle et épuisé.
Romain resta alité plusieurs jours et il fallut, dit-on, deux litres de foie de morue pour le remettre sur pied. Quand il réapparut, ce fut pour accueillir le facteur Cappeau qui lui tendit une missive : « Romain, c’est pour toi, une nouvelle lettre d’Avignon ».
Le samedi suivant, se répéta le même scénario : Romain n’était pas libre pour accompagner ses camarades au bord de la mer. Et il revint à pas d’heure, aussi escagassé, accueilli par sa mère tous sens dessus dessous, paniquée.
L’apothicaire Malige répara les dégâts, tant bien que mal, à grand coup de potion énergisante. Il n’y eut plus de nouvelle escapade mystérieuse et épuisante et cet épisode tomba dans l’oubli.
Les années passèrent, chacun fit sa vie. Cependant, un ancien de la bande me livra la clé du mystère : « Les deux lettres, c’est moi qui les ai écrites, même que j’ai conservé les doubles ». Intrigué, je demandai à les lire.
« Tu sais, me répondit-il, tu es le premier et le dernier à qui je les montre ». Alors je vous les livre telles quelles :
- première lettre :
« Mon cher Romain,
Vous dire mon émotion quand vous m’avez donné votre adresse. Nous reverrons-nous ? Vous savez ma famille est très stricte aussi c’est en cachette que j’écris cette lettre. Les dimanches, pas question de sortir seule, je vais pique-niquer en famille au “…” (là un mot manifestement gommé). J’aimerais tant vous y entrevoir. En attendant, je vous dépose un baiser pudique sur le front, Aglaë ».
- deuxième lettre :
« Mon très cher Romain,
Je me sens de plus en plus épiée. C’est dans une église que j’écris cette lettre, grand-mère ayant été indisposée, à la dernière minute, nous avons reporté le pique-nique. Mais, dimanche prochain, avec ou sans mémé, nous irons où vous savez, je tremble à l’idée de vous revoir. Avec deux baisers un peu moins pudiques, dans le cou. Votre Aglaë ».
Me retournant vers le coupable je lui demandai :
« C’est toi qui as gommé le lieu du rendez-vous ?
- Ben oui.
- Et pourquoi ?
- C’est que j’ai un peu honte.
- Alors, c’était où ?
- Au sommet du Mont Ventoux ! »
. 6 .
Les copains d’abord
Dève
Dans les garrigues environnantes, se trouvait un lieu d’aventures et de merveilles où, tout gosse, nous escortions nos pères à l’ouverture de la chasse, chacun chargé de sa gibecière afin de « récolter » les lapins qui, épargnés pendant les années de guerre, faute de fusils, s’étaient multipliés et gambadaient partout.
A Dève, le point de départ de la battue était le mas de Denis Jouve ; il n’était pas rare qu’un lapin étourdi observe notre arrivée et nos préparatifs pendant lesquels on trinquait à la réussite de l’entreprise, histoire de nous mettre en jambes. Passons pudiquement sur la nature du breuvage.
Le plus surprenant dans ce lieu de réunion était une épaisse table de bois avec des trous tout autour et dans chacun de ces trous un verre à pied – sans pied. Ces verres avaient tellement servi qu’il n’y avait aucune chance de voir le jour à travers. C’est là que je découvris l’efficacité de l’alcool en tant que désinfectant.
Sur cette table trônait aussi une grosse bonbonne qui finit malencontreusement sa vie sous les plombs d’un chasseur impatient d’en découdre avec le gibier et qui chargea son arme un peu trop tôt !
Rares étaient les chasseurs « étrangers » qui se joignaient à notre groupe, car comme chacun sait, les chasseurs, pêcheurs et ramasseurs de champignons gardent « le secret des lieux ».
Outre mon père, il y avait donc Denis Jouve et son frère dit Renard, René Champetier et Accoto le boucher originaire de Marseille, personnage singulier qui avait l’habitude d’épauler son fusil, de suivre l’animal et une fois le lapin à l’abri disait solennellement : « A passa » (il est passé). Là, je compris qu’une âme sensible pouvait se nicher partout, même chez un boucher.
Tout ceci nous ramène inévitablement vers Cappeau qui, revenant bredouille de l’île du Marquis désarma son fusil au moment même où détalait un lapin. Bien que l’arme fut vide, il épaula la bête : « Si j’avais su… », dit-il en appuyant sur la gâchette. Mais pan ! La bête tomba raide morte. Quand on vous dit qu’on est jamais assez prudent.
Nous revenions de ces équipées, occis sous la charge, avec dans les jambes les nombreux kilomètres vallonnés, mais nous étions fiers et heureux.
Depuis la retraite, c’est souvent que je reviens revisiter ces lieux du côté de Dève. Ma saison préférée est l’automne. La température est clémente et les couleurs magnifiques. Bien sûr, rencontrer un Jeannot lapin est devenu chose rare, mais, n’ayant jamais chassé, peu m’importe.
Le sentier initial a été bouleversé, on n’y trouve plus trace de ces coquillages incrustés dans la roche, témoignages de charivari d’une autre ère. Arrivé au Plan de Doume, je retrouve l’emplacement de la cabane des chasseurs avec la stèle à Dudule, devant la capitelle.
Dudule
S’il est un de mes contemporains qui, malheureusement, nous a quittés bien trop tôt, mais a laissé trace, c’est bien l’ami Dudule, le bâtisseur de capitelles.
Fils de Lucien Durand, agriculteur, mais peu enclin au rude travail de la terre, Dudule refusa le métier de son père pour embrasser la carrière de facteur, à l’instar du célèbre Cappeau (éminent membre du sénat local).
Jadis, le métier voulait que tout postulant aux PTT (Postes Télégraphes et Téléphones) fasse ses premières armes à Paris, avec sa sacoche et sa bicyclette. Dudule se rendit donc dans la capitale, une ville pleine de surprises pour un jeune méridional. La plus curieuse fut sans nul doute le jour où, place de l’Etoile, attendant que le bâton de l’agent de service lui ouvre la voie, il le reconnut : c’était son copain Héral. Les deux Aramonais, amis de jeunesse, tombèrent dans les bras l’un de l’autre, au mépris de la foule et de la circulation. Une rencontre inespérée. Comme cela relevait du miracle, leur première réaction fut d’aller rendre grâce à Notre-Dame de Paris, mais vu qu’ils n’avaient plus remis les pieds dans une église depuis leur communion, ils avaient oublié leurs prières… Ils jugèrent plus honnête de se replier vers le café du coin pour fêter l’événement, à coup de « jaunes » jusqu’à tard dans la nuit.
Dudule avait le mal du pays. Quand il apprit que la commune recherchait un garde municipal, il renonça à sa carrière de facteur parisien, il postula au concours de recrutement et réussit, pour le plus grand bonheur de ses concitoyens. Sa connaissance du terrain fit merveille, même le préfet ne pouvait se déplacer sur les terres aramonaises sans exiger sa présence. Il était au courant de tout, oui de tout.
Un jour qu’il conversait avec la marquise d’Aramon, il lui rappela qu’un certain Georges D., un bon paroissien (façon Bourvil) avait profané la chapelle du marquis à Saint-Martin. La marquise fut surprise, car à l’époque de cet incident, Dudule n’était pas encore de ce monde. Sûr de lui, notre garde municipal lui répondit : « Marquise, sachez que nous dans la police, on sait tout, même si on ne dit rien ». Un comble pour un Aramonais !
La réputation de notre homme dépassa les limites du pays. Je me souviens qu’à Montfrin, lors d’une course de toros à la cocarde, pour encourager les razeteurs à commettre des exploits, on offrait de l’argent ou autre, le speaker annonça : « Cinq euros de plus de la part du garde Dudule », puis ajouta : « Partout où passe Dudule, la délinquance recule ».
Il faut également évoquer sa passion pour son chien Kiki, un caniche. Dudule avait remisé dans son réfrigérateur une truffe donnée par un copain. Son chien passa la nuit suivante à gémir, le nez collé contre la porte du frigo. Dudule, perspicace, en déduisit que son chien avait un talent de rabassier hors pair. Ce qui se confirma. Convaincu que Kiki était le meilleur chien truffier de la région, il le fit participer à un concours, à Uzès. Lorsque les professionnels virent arriver ce « ridicule caniche », ils s’esclaffèrent. Mais quelques heures plus tard, ce fut Dudule qui brandit la coupe du vainqueur.
Dudule adorait et gâtait son Kiki. Au marché de Fournès où il se rendait pour vendre le produit des abricotiers hérités de son père, il prenait un malin plaisir à s’attabler pour grignoter un morceau de pain arrosé de vin rouge, puis sous le regard indigné des clients, il plaçait Kiki sur une chaise avec une serviette autour du cou et lui découpait un énorme steak.
Un jour, il m’invita à découvrir « sa grotte » entre Dève et le Plan de Doume. S’y trouvait en effet une honnête cavité d’une dizaine de mètres de profondeur, mais qui n’avait rien de remarquable à mes yeux. J’ai fait semblant de m’émerveiller – on ne pouvait pas décevoir un ami comme Dudule (inutile de chercher cette grotte, les travaux pour le TGV l’ont réduite à néant).
Quant aux capitelles, avec ses copains, ils en passèrent du temps et de la sueur à charrier les pierres et à les assembler pour les reconstruire, sans parler de celles qu’ils édifièrent à leur façon, avec pour seule récompense de solides petits déjeuners bien arrosés comme il se doit. Mais là où Dudule manifestait son grand cœur, c’était au moment de Noël, quand il accueillait les petits enfants de maternelle dans sa capitelle du bout de la Palun, décorée en crèche, il surgissait avec sa veste de berger et son grand chapeau, les bras chargés de friandises, avec des gamins ravis comme on ne peut pas l’être.
Je le revois, vers le boulodrome, en plein hiver, en train de trier ses pissenlits en attendant les joueurs de belote, il me dit sur le ton de la confidence : « Je prépare un livre sur mes souvenirs ».
Dudule, comme tu es parti là-haut sans en avoir eu le temps, eh bien ce chapitre, c’est le tien.
A peire qué rode
Restons encore un instant avec lui.
Dudule effectuait sa tournée de surveillance quand il fut abordé par un néo-Aramonais (retraité parisien qui avait choisi Aramon comme lieu de retraite), la conversation s’engagea :
« Pardon, monsieur le garde, je suis à la recherche de la pierre qui tourne. On prétend qu’elle tourne sur elle-même tous les ans. Je vous avoue que je suis très sceptique.
- Ah bon. Si vous voulez, je peux vous y conduire, comme ça vous vous rendrez compte par vous-même » répliqua Dudule très sérieux. Et il conduisit ce monsieur au lieu-dit.
Il s’agissait d’un abri constitué d’une grosse pierre plate réputée pour tourner sur elle-même une fois par an : « Voilà. C’est là que les bergers se réfugient quand le temps devient mauvais. Même que c’est eux qui ont été les premiers à observer la chose » dit Dudule, toujours aussi sérieusement.
Notre parisien n’était toujours pas convaincu, mais voulut en avoir le cœur net et procéda de façon « scientifique ». Plusieurs jours d’affilée, toujours à la même heure, il retourna sur les lieux et constata : la pierre ne bougeait pas d’un millimètre.
Peu après, il croisa notre Dudule et fier de lui, énonça sa conclusion :
« Monsieur le garde, votre histoire de pierre qui tourne est l’œuvre d’un petit plaisantin.
Nullement impressionné, Dudule répliqua :
- Que je m’en veux, mais que je m’en veux… J’avais oublié de vous dire l’essentiel !
- Ah. Et c’est quoi l’essentiel ?
- Elle tourne que la nuit. »
L’histoire ne dit pas si notre retraité eut le courage de recommencer ses expériences.
Armand
Dans les années 1950, le prénommé Armand, encore adolescent, épaulait son père au travail de la terre. C’était un rêveur, un naïf, qui aurait été sans doute plus heureux dans la peau d’un Pétrarque ou d’un Ronsard. A la fois bucolique et romantique, Armand était un amoureux de la nature, des fleurs, de la poésie et tout autant des jeunes filles qui animaient ses rêves.
Sa première « vraie » aventure fut avec une « fille de la ville » qui avait été sensible à ce gentil garçon « pas comme les autres ». On pouvait le voir tous les après-midi, attendant sa belle au sortir du collège de la rue Joseph Vernet d’Avignon. Main dans la main, les tourtereaux se promenaient au bord de Durance où ils échangeaient serments et baisers.
Fin lettré, notre éphèbe avait cependant un défaut : il était un piètre danseur. Un soir de fête votive au village, durant le bal, la « fille de la ville » lassée de voir son ami maladroit et dépourvu du sens du rythme lui écraser les pieds, accepta l’invitation d’un élégant valseur. Désarmé, impuissant, Armand assista à la scène. Ce fut son premier chagrin d’amour. Et de quelque temps, on ne le vit plus.
Bien sûr, « la fille de la ville » exprima quelques remords pour la légèreté avec laquelle elle avait abandonné le jeune homme. A coup de billets doux, elle essaya même de renouer le fil, mais la blessure (l’humiliation) d’Armand était trop vive pour qu’il acceptât de reprendre leur relation. Chacun partit de son côté et poursuivit sa route, sans se revoir.
La « fille de la ville » entreprit des études et Armand prit en charge l’exploitation familiale jusqu’à ce que l’armée l’appelle et l’envoie sur le front de l’Algérie.
Mais le hasard les réunit à nouveau, à Avignon, place de l’Horloge. Elle tenait sa petite sœur à la main, elle avait passé avec succès un concours administratif et attendait sa nomination à un poste. Lui, de retour du djebel, moralement meurtri par deux années de « vacances au soleil » offertes par l’armée avait retrouvé le travail des champs. Ils firent quelques pas, côte à côte, jusqu’au Rocher des Doms. Elle se montra curieuse, lui posa beaucoup de questions sur sa vie depuis leur rupture. Il se montra peu loquace, il n’avait pas envie de raconter sa vie de bidasse ou de jeune paysan. En fait, il avait la gorge nouée, se rendant compte qu’il l’aimait encore. La jeune femme, soudain très émue, lui dit : « Si je te demande comment c’est là-bas, c’est que mon fiancé s’y trouve ». Au moins, avait-elle l’honnêteté de dire les choses. Mais l’intensité des regards échangés révélait la confusion de leurs sentiments l’un envers l’autre. Chaperonnée par sa petite sœur, la jeune femme hésitait à se livrer. Quant à Armand, il avait un rival qui endurait ce qu’il avait connu et attendait sans doute la prochaine lettre de sa fiancée. Il refusait de lui faire subir ce dont il avait souffert. Leur histoire était décidément impossible. Transi de regrets, il salua la « fille de la ville » et s’éloigna.
Le temps passant, Armand, toujours aussi peu loquace, vivait seul et s’épuisait à faire fructifier les biens hérités de son père. Le corps fourbu, le cheveu blanchi, il mit ses terres en fermage, s’aménagea un petit coin dans son mas et troqua la bêche contre une canne à pêche. Ce qui convenait parfaitement à son désir de tranquillité.
Quand il se rendait en Avignon, il lui arrivait de s’attarder dans la rue où demeurait la famille de son amour de sa jeunesse, d’observer les fenêtres et d’espérer une apparition ou des retrouvailles fortuites. Bien sûr, il avait été tenté de sonner à la porte. Bien sûr, il n’avait jamais osé. Un jour, il remarqua que tous les volets de la maison étaient clos. Il interpella une voisine et apprit qu’à la suite du décès du père, la mère avait rejoint sa fille aînée en Lorraine. Il osa demander l’adresse, l’obtint et prenant sa plus belle plume et son courage à deux mains, il la contacta. Elle répondit par téléphone :
« Alors, toujours dans tes terres ? demanda-t-elle.
- Oh non, tout ça, c’est du passé. Je tue le temps comme je peux.
- Tu as une famille ?
- Depuis le départ de mes parents, ça se résume à mon chien et moi. Et toi l’Avignonaise ? Tes études ? Ton fiancé soldat ?
- C’était bien la peine de me faire un sang d’encre pour lui. Là-bas, il a connu une fille et passé la guerre, je ne l’ai plus jamais revu.
- Mais pourquoi ne pas me l’avoir dit ?
- C’est pas l’envie qui manquait, mais tu étais attaché à tes terres et moi à mon travail, à ma vie de nomade, de poste en poste, à travers le pays… Tu sais, j’ai souvent repensé au Rocher des Doms… J’avais tellement de choses à te dire. Après la peine que je t’ai faite. Il faut qu’on se revoie ».
Armand le terrien, qui n’avait pas beaucoup bougé depuis son service militaire, surprit ses copains du village en leur annonçant son départ en vacances pour Nancy.
Quarante ans s’étaient écoulés. Certes, la « jeune fille de la ville » et Armand avaient changé, mais les battements de leurs cœurs étaient les mêmes. Ils furent plus qu’heureux de se retrouver et de vivre enfin ce qu’ils avaient si longtemps espéré.
La jeune femme révéla qu’elle était gravement souffrante. Pendant des mois, Armand se dévoua autant que possible pour l’aider, l’accompagner, la soutenir dans son combat contre le mal qui la rongeait. Il lui offrit tout son temps, toute sa vie. Il l’aima. Il l’épousa. Mais le mal eut le dernier mot.
Armand regagna son village, seul, avec une urne dans les bras. Au cimetière, il fit graver une plaque avec leurs deux prénoms : Odile et Armand. Aux copains qui s’en étonnaient, il répondait : « On a mis tellement de temps à se retrouver, comme ça on ne se quitte plus ». Il liquida les biens qu’il possédait encore et disparut. On ne le revit plus jamais. Sans doute a-t-il choisi de rejoindre Odile, pour toujours.
L’heure du Berger
L’ami Denis, un des doyens d’Aramon, m’a confié un de ses souvenirs d’enfance, à savoir la fête votive d’Aramon en 1938 (il avait onze ans).
Comme déjà évoquée dans les pages précédentes (Sacré Pierrot), chaque édition de la fête votive proposait des attractions et des compétitions bon-enfant auxquelles participait toute la population locale. Ces animations étaient l’occasion pour les notables locaux de soigner leur réputation en faisant un « geste », un don, au profit de l’organisation.
Cette année-là fut programmée une course de vélo très particulière et Monsieur Prat, grand patron de la maison Berger8 proposa « d’arroser » l’événement non pas en monnaie sonnante et trébuchante, mais en liquide. Certains se souviennent peut-être de cette publicité : « Midi, sept heures, c’est l’heure du Berger ».
La course était réservée aux « sportifs » aramonais et à eux seuls. Tous les partants devaient se présenter sur la ligne de départ, en tenue règlementaire. C’est-à-dire : une barboteuse, un bonnet à frange et pour se désaltérer, un biberon rempli de pastis Berger (délayé avec de l’eau, bien sûr).
Tous les joyeux drilles du pays étaient présents : Palmyre (le père de notre ami Denis), Noël, Paul, Georges, etc. Et même Félix Rosier qui, pour doper son poulain cycliste, lui fit un shampoing à l’anisette.
Monsieur Prat donna le signal du départ et tous les concurrents s’élancèrent à bord de leurs bicyclettes sur le circuit imposé à travers le village.
Ils accomplirent le premier tour avec toute la sportivité et l’énergie requise, sous les vivats et les éclats de rire de la foule.
Les tours suivants, il y eut – soyons aimables – un peu de relâchement au fur et à mesure que les biberons se vidaient. Un cycliste frappé de confusion se trompa de direction, un autre prit un virage en pleine ligne droite, un troisième perdit le sens de l’équilibre, un quatrième n’arrivait plus à caler ses pieds sur pédalier, etc.
Vous dire l’ordre d’arrivée ? Personne ne s’en souvient. Les grands vainqueurs furent la bonne humeur et la joie de vivre à laquelle s’adonna sans retenue (jusqu’à plus soif) toute la population. Bien lui en prit, car l’année suivante, la fête votive fut annulée à cause de la guerre.
Le tour de France
Ah, le Tour de France, la petite reine, le beau sujet populaire que voilà. Les anecdotes ne manquent pas, j’ai retenu celle-ci qui révèle bien le tempérament des dames du Midi.
Une année, des copains aramonais décident de monter à Paris pour assister à l’arrivée du Tour, à la mi-juillet. En bons méridionaux extravertis et joyeux, nantis d’un accent à couper au couteau et peu rompus aux manières réservées des gens de la grande ville, ils ne passaient pas inaperçus. Ils déambulèrent dans la capitale, puis histoire de tromper la soif et de meubler le temps en attendant l’arrivée au Parc des Princes (à l’époque), ils s’attablèrent à la terrasse d’une brasserie.
Bien sûr, il faisait chaud et il fallut plusieurs pastis pour les désaltérer. Ils se mirent à chanter, la bonne humeur et l’alcool aidant, ils se livrèrent à un véritable récital. Avec un tel succès que les Parigots clients de la brasserie se disputaient pour leur payer la tournée. Alors arriva ce qui risquait d’arriver : nos héros imbibés jusqu’à la moelle oublièrent pourquoi ils étaient venus et s’endormirent sur les lieux de leur « triomphe ». L’arrivée du Tour de France se déroula sans eux.
Avant de quitter la capitale pour regagner Aramon, ils consultèrent les journaux et apprirent par cœur tous les détails de l’événement, afin de ne pas décevoir les copains qui les attendaient avec curiosité et impatience. Il faut préciser qu’à l’époque, les postes de radio étaient rares, la télévision était encore dans les langes. Le passage du tour dans une commune était un événement inespéré, presque historique.
Pendant quelques mois, nos compères évitèrent de dire la vérité. Lequel a vendu la mèche ? Je ne m’en souviens pas. Mais quand le pot aux roses fut découvert, les épouses se concertèrent.
Un jour de juillet, en regagnant leur maison à midi pour déjeuner, en lieu et place du couvert et du repas, les compères trouvèrent une feuille de papier qui disait : « Va manger au bistrot, je suis partie à Paris pour voir l’arrivée du Tour de France. Pour de vrai ». Seul, Paul Monnet, célibataire endurci, ne souffrit pas de la chose.
. 7 .
Les temps modernes
C’est quoi « être moderne » ? Les philosophes et les politiques ont, paraît-il, un avis sur la question… En ma qualité de commun des mortels, il me semble qu’on a tendance à considérer comme moderne tout ce qui est nouveau. Et à considérer comme vieillot et bon à jeter, ce qui ne suit pas la marche forcée du progrès. En oubliant qu’en toute chose, il y a un passé, une tradition, une transmission.
Aramon 1885-1886
En 1885, Aramon était un village moderne. Oui, vous avez bien lu : moderne. Puisque la modernité en ce temps-là se nommait chemin de fer, télégraphe, projet de pont suspendu, cinéma, automobile, etc. Et que les débats politiques et autres étaient aussi vifs au sénat du Planet qu’au Sénat de Paris.
En ce temps-là, le brave Joseph Peyric, sacristain du curé Biau, notait chaque jour dans un carnet l’actualité dont il était témoin. Et tout bedeau qu’il fut, la « modernité » l’intéressait vu la précision horaire des trains (7 h 28, 15 h 31, etc.) empruntés par les uns et les autres, qu’il s’astreignait à noter. Le Chemin de fer impressionnait alors par sa rapidité et son efficacité. Sa puissance.
Le destin de ce carnet est troublant : il a échappé à une flambée de vieux papiers (grâce à mon oncle René), mais il a été emporté par l’inondation du Gardon en 2002. Heureusement, j’avais pris la précaution d’en dupliquer le contenu.
Peyric écrivait donc, jour après jour, tous les faits et gestes qui animaient Aramon : naissances, mariages, décès (beaucoup d’enfants en bas âge) et même un divorce – un événement à l’époque – qui fut prononcé en Mairie à onze heures du matin et attira pas moins de 300 badauds.
Au XIXe siècle, comme dans beaucoup de communes du Midi, la vie sociale se déroulait via des corporations, des compagnies et des sociétés d’intérêts divers : métiers, musique, politique, religion, traditions folkloriques, etc. Parmi elles, Les enfants d’Aramon, animée par Champetier.
Selon le carnet, le fait qui passionnait et divisait à la fois les Aramonais était la séparation de l’Eglise et de l’Etat : républicains d’un côté, paroissiens de l’autre. Il y eut une élection municipale où une liste républicaine et une liste procléricale se disputèrent 4 sièges. Le jour de l’élection, un dimanche bien sûr, l’abbé en chaire profita de son sermon pour exprimer sa préférence et inciter ses fidèles à la partager. Cependant, au dépouillement, les républicains raflèrent la mise de 15 voix, mais l’affaire ne s’arrêta pas là. Pensez donc : un serviteur de l’Etat rétribué par le ministre du Culte, donc avec de l’argent public, qui se permet de faire acte politique dans son sermon ! C’en était trop et la répartie fut publiée dans le journal Le Petit Méridional (24 mai 1886, n° 3002) en ces termes : « Le judicieux discours de Monsieur Gobbet à l’encontre de certains membres du clergé aurait dû faire réfléchir le bon Frocard. Il aurait pu alors se contenter d’exploiter la bêtise humaine, vendre ses huiles et ses onguents ainsi que ses messes et ses eaux bénites. » Voilà les gentillesses que l’on s’échangeait et qui n’ont rien à envier aux propos de certains de nos contemporains.
Dans le même registre, notre sacristain décidément curieux de tout, mentionne dans son carnet le résultat d’un vote de l’Assemblée nationale, auquel participe le ministre des Affaires étrangères, Monsieur Fraissinet, l’article 1, « l’interdiction de territoire aux chefs de famille ayant régné sur la France et à leurs héritiers directs », est adopté par 324 voix pour et 232 voix contre. Il s’intéressait à la vie des monarchies européennes et rapporte par le détail (comme s’il y était) le mariage du duc de Bragance avec la fille du Comte de Paris.
La coutume locale exigeait de se rendre au château, pour présenter ses hommages au « monarque » des lieux, pour chaque mariage, baptême ou petit événement. Le marquis d’Aramon gratifiait les uns et les autres de dons en numéraires, il offrait également un crédit repas à consommer dans l’un des trois
cafés du village ou bien payait généreusement toutes les consommations (une somme de 350 francs, est-il précisé).
Concernant le quotidien proprement dit des Aramonais, le carnet de Peyric révèle une tradition qui perdure et qui devrait faire la joie d’un chercheur en linguistique : les surnoms en patois local (provençal). La majorité des patronymes consignés y est associée (si vous n’en comprenez pas la signification, demandez à un ancien) : Camille Brunel, Lou fratchéou ; César Sévérac, Cazaou ; Alexandre Emieux, Manjamoure, Emieux l’ainé, Lou preti, Emieux le jeune, Lou grélé ; Joseph Rosier, Romgnon ; Léon Durand, Qui cou grontchien ; Martin dit Mousquou, Martin dit Plaplaou, Martin Alfred dit Favard ; Guillermet, Lacou laïgou, Guillermet fils, Beou langou ; Hyppolite, Mourelette ; Toustin, Gnole ; Vincent, Lou roussignaou, Lou prouvençaou ; Adèle Bonjean, Mongeou ; Lafond, Djidjive, faï décane ; Gilbert Guillaume, Pistoulé ; fille Brunel, Fratchou ; Denis Bernard, Momatchou ; Thomas Dupont, Didon ; Claudius Fabre, Bondin ; César Chapus, Triangle ; Menjaud, Caraï… Et Feraud, dit patebagnade, parce qu’il avait l’habitude de tremper son mouchoir dans l’eau et de s’en couvrir la tête avec son chapeau par dessus.
Le mode de recrutement des conscrits se faisait alors par tirage au sort. Si l’on tirait le « bon » numéro, on devenait troufion. Sinon, on restait à la maison.
Plus surprenant, pour l’époque : une fille pouvait enlever un garçon, un garçon pouvait enlever une fille. Ainsi, Suzanne Crouzet a « kidnappé » Dunanné, fils de Dunand et a passé la nuit avec lui dans le mas des demoiselles Jouve… Auguste Merle est parti avec la domestique de la veuve Gibert…
Pour se distraire, on lançait des paris. Tel celui qui opposa Edouard Brun, cafetier et Edouard Labirard, ouvrier chaisier. Le défi consistait à faire le trajet Aramon-Montfrin-Aramon, Brun avec son cheval et Labirard à pied. Le premier arrivé gagnant cinq francs. C’est le cheval qui emporta la course, mais avec 50 m d’avance seulement.
Et ainsi de suite, au fil des mois et des saisons, le brave sacristain faisait œuvre de mémorialiste dans laquelle les amateurs d’histoire ont plaisir et intérêt à piocher, même dans les comptes-rendus laconiques, incomplets :
- Foire du 10 mai, marchands nombreux.
- 8/02, un cirque bordelais s’est installé à Saute Rousseau.
- 10/05, de 9 heures du matin à 4 heures de l’après-midi ; Emprunt National de 500 millions, couvert en un jour.
- Le fils du « grêlé » Rieux s’est laissé choir en allant tremper ses osiers en bas des grands escaliers, les secours l’ont tiré de ce mauvais pas.
- La femme de Condorcet, épicier, a accouché d’une fille, « qu’elle meurt en même temps »9.
- Jeudi 19 avril, dispute très vive entre les dénommées Fifi et la fille du Fratchou, boucher. Par suite d’une violente prise, Fifi tombe d’une attaque qui se renouvellera toutes les 4 heures, elle reste idiote une huitaine de jours !
- Départ de l’abbé Brunel pour Paris. Il prend le train de 6 h 28 pour arriver le lendemain à 9 heures et demie du matin (note de l’auteur : soit environ 15 heures de voyage).
- 16/02/1886, la jeunesse d’Aramon représentée par le délégué de chaque société a rendu les honneurs à Monsieur et Madame Bertrand, notaire à Aramon, à l’occasion de leur mariage. Une pièce de 100 francs a été donnée par ces derniers.
Chaque extrait nous renseigne sur le quotidien de ceux qui nous ont précédés, sur leurs activités et leurs modes de vie. On y constate que l’espérance de vie était moindre que de nos jours. Les maladies infantiles faisaient des ravages. On observe également combien étaient nombreux les vanniers, chaisiers, perruquiers, les commerces de bouche. Le travail de la terre concernait tout le monde (boulot, chevaux, dodo). Aramon n’était pas du tout un village replié sur lui même. Au contraire, sans cesse des gens « d’ailleurs » venaient y travailler ou s’y établir en important des façons de vivre ou de penser différentes. Les Aramonais acceptaient ces nouveaux venus, avec une certaine ouverture d’esprit, parce que rompus aux « visiteurs » de tout acabit grâce au port et aux mariniers de toutes nationalités qui sillonnaient le Rhône.
Mais sur le fond, quel que soit l’enjeu de la « modernité » de telle ou telle époque, hier comme aujourd’hui, les aspirations sont les mêmes.
La copie des textes du sacristain Peyric est lisible au Cercle généalogique d’Aramon.
Les traces d’une vie
On dit que le XXe siècle fut un des plus meurtriers de l’histoire de l’humanité (ce fut aussi un des plus dynamiques en inventions et progrès matériels).
J’appartiens à cette génération dont l’enfance fut marquée par l’Occupation et l’adolescence perturbée par les guerres
de décolonisation. A peine avais-je eu le temps de vivre l’insouciance et les ambitions de jeune homme que je franchis brutalement un pas décisif dans la compréhension de mes semblables et du monde dans lequel je vis.
Appelé fin 1955, me voilà chasseur alpin (et non de lapin comme mon père). J’ai passé l’hiver dans la Vallée de l’Ubaye
(-25 à -32°), ce qui est déjà une épreuve pour un Méridional. Au programme : maniement d’armes, corvées de toutes natures et surtout l’apprentissage de la discipline en toutes circonstances, au mépris de la conscience et du libre arbitre de chacun.
On nous envoya faire quelques exercices en Prusse, pendant deux semaines, puis direction Alger la blanche et le bled.
Là, le temps me parut interminable. Je ne m’étendrai pas sur les « événements d’Algérie », si ce n’est que longtemps (très longtemps) après notre démobilisation, le 18 octobre 1999,
on nous apprit que nous avions fait une « guerre » (ça nous fait une belle jambe). Dans ce genre de situation, l’esprit est dominé par une obsession : sauve qui peut la vie, en commençant par la sienne. Hélas, nombre de mes camarades n’eurent pas cette chance et laissèrent leurs vingt ans quelque part dans le djebel. Nous n’avions pas choisi d’être là, nous n’étions pas des professionnels. On nous ordonnait : « il faut pacifier ». Les plus aguerris disaient : « il faut pas s’y fier ».
A la veille d’une quille, j’eus un différend avec un de mes supérieurs. Résultat : trois semaines au mitard et le plaisir de dormir sur la paille un soir de Noël, comme l’Enfant Jésus. Les adjudants Occello et Deniau complétant le tableau dans les rôles de l’âne et du bœuf.
Mon retour à la vie civile fut particulier. A bord d’un train plein de soldats permissionnaires « tchimis » qui, pour la plupart, allaient se reposer et se ressourcer, avant de reprendre le crapahutage de mechta en mechta. Arrivé en gare d’Avignon au milieu de la nuit, je fus le seul à descendre sur le quai désert – hormis le chef de gare agitant son drapeau. La locomotive a lourdement, lentement, redémarré. Et soudain, tous les soldats penchés par les fenêtres et les portières du train, entonnèrent ce vieux chant des adieux : « Ce n’est qu’un au revoir mes frères, ce n’est qu’un au revoir, oui nous nous reverrons mes frères… ». Je me suis effondré en larmes et j’ai ressenti en même temps une émotion profonde, le bonheur de faire partie de la fraternité des hommes.
On gagne sa vie à la perdre, on perd sa vie à la gagner. L’âge de la retraite venu, je décidais de m’activer autant que possible, de me reposer un peu, de profiter des belles choses, mais en mémoire demeurait, toujours aussi vif, ce « nous nous reverrons mes frères ».
Il y a quelques années, alors que je randonnais dans le brouillard de la Rhûne (point culminant du Pays Basque), je perçus le son d’une voix familière. Et je reconnus, parmi un groupe de marcheurs, mon frère d’armes, André. Il était en compagnie de quelques camarades du 2e régiment de Dragons : Zizi, Titin, Gaston le nissart, Gérard la fleur, Guy le Londonien Guy le Savoyard, Henri, Jo le Conteur, Jean l’apiculteur, Maurice le bouchonnier, Maurice de Lapalud, André et Fernand les musiciens et le petit Gonzalès. Depuis, de temps en temps, on se retrouve pour évoquer les bons souvenirs en évitant d’aborder ceux qui fâchent.
« La guerre, c’était notre jeunesse », disaient nos grands-parents, nos parents... Une rengaine des temps modernes.
Le Bavarois
Les protagonistes de cette histoire vraie sont les dignes descendants de tous les personnages évoqués dans les pages précédentes.
Tout commence à Saint-Marcellin, charmante petite cité de montagne, située au pied du Vercors (région où se déroulèrent des épisodes décisifs du conflit 1939-1945). Cette commune a pour particularité d’avoir, à cause de la guerre, abrité deux petites filles aux destins exceptionnels : Françoise Quoirez, alias Françoise Sagan, et Monique Serf alias Barbara. Selon les experts en écriture, chacune se serait souvenue de ces lieux de jeunesse tourmentée : l’écrivaine avec Château en Suède et l’auteur-musicienne-interprète, avec la bouleversante chanson Mon enfance qui évoque le « coteau » son lieu de rêverie, d’évasion et de réconfort.
Saint-Marcellin compte nombre d’artistes et c’est là que tout commence. Ces artistes furent invités à accrocher leurs œuvres aux cimaises des Halles d’Aramon en juillet 1988. Rien que de très banal, si ce n’est que le maire dauphinois se déplaça dans le Midi, pour honorer ses artistes, accompagné par Jean Sorel, historien de sa ville.
Vint l’heure du vernissage de l’exposition où les vins d’Aramon et les fromages du Saint-Marcelin firent alliance. Verres en main, les convives conversaient chaleureusement. Soudain, le maire-visiteur présenta son comparse en disant : « Voici notre historien qui, plus tard, aura une rue à son nom dans notre village ».
Alors, Simon, cuisinier à l’EDF et sans complexe, répliqua : « Vous êtes aussi couillon que les autres, s’il mérite sa rue, autant la lui donner de son vivant, qu’il en profite un peu… Té, si vous le faites, je monte par chez vous et je vous fais un Bavarois pour 200 personnes !
- 200 parts de gâteau pour 8 000 habitants ? Tu es ridicule, lui souffla son collègue Jean-Marie, de la Cuisine centrale.
- Qu’à cela ne tienne, renchérit Simon, ajoutons un zéro de plus, ce sera pour 2 000 personnes ! »
Le maire de Saint-Marcellin, flairant la bonne affaire, accepta aussitôt : « D’accord, ce sera le 7 février 1989 » (à un mois des élections municipales !)
Durant les préparatifs, comme des champions, Simon et Jean-Marie furent choyés, accompagnés, soutenus. L’EDF dressa une tente au Champ de Mars de Saint-Marcellin où ils s’activèrent malgré le brouillard et le froid. Quelques Aramonais se rendirent sur place avant le jour dit pour les encourager. C’est que le projet risquait de figurer dans le Guinness des records… On vit Roland, dit le Bati déserter son café et la cave viticole éditer une Cuvée spéciale de Côte du Rhône Aimé Espérandieu. Le pari avait provoqué une telle frénésie dans la population qu’on dut affréter quatre cars et des dizaines de voitures.
Et c’est ainsi que, par un froid glacial, des centaines d’Aramonais, élus, curieux, anciens combattants, commerçants, enseignants, footeux, farandoleurs, envahirent Saint-Marcellin, officiellement pour inaugurer la place de l’historien Jean Sorel, mais surtout pour animer la ville et rendre hommage au
1 400 kilos de gâteau. Il y eut quelques joutes sportives intercommunales entre vétérans du ballon sur la pelouse gelée du stade. Les cafetiers du coin apprirent que quand un Aramonais attablé avec des amis demande un Ricard, ça veut dire « un litre ». Ils furent vite en rupture de stock. La place Jean Sorel fut inaugurée dignement. Le maire de Saint-Marcellin vanta ses propres mérites. Celui d’Aramon, Pierrot Ramel, fut plus discret.
Arriva l’heure du gâteau. La foule se dirigea vers le Champs de Mars sous la tente abritant l’exploit. Et là, ce fut gargantuesque. On vit même des convives remplir des seaux… Nos deux pâtissiers héros du jour furent félicités et honorés comme il se doit pour leur performance.
Le retour fut éprouvant, car après ces agapes, dans les cars, tout le monde dormait à l’exception du chauffeur (et encore !), ce fut un miracle si les voitures regagnèrent Aramon sans s’égarer.
Alors, si un jour le cœur vous en dit, voici les ingrédients nécessaires à la confection d’un Bavarois pour 2 000 personnes :
- 290 litres de crème fraîche
- 86 litres d’eau
- 30 kilos de farine
- 8 litres d’extrait de framboise
- 60 kilos de poudre de Bavarois
- 960 œufs
- 150 kilos de sucre semoule
- 4 litres de vanille
Si vous êtes moins nombreux, c’est facile : il vous suffit de diviser chaque ingrédient par 2 000 et de multiplier le résultat obtenu par le nombre de convives.
Bref, ce fut une journée particulière, comme on aimerait en voir plus souvent.
La Saint-Martin
Tous les ans, le 11 novembre, se déroule la foire de la Saint-Martin, des milliers de promeneurs envahissent Aramon pour admirer le défilé et toutes les animations qui l’entourent.
Cette foire remonte à la nuit des temps. Elle fut officialisée par Charles IX en 1565 et connut bien des aléas, des mises en sommeil à cause des conflits qui ont marqué l’histoire du pays, ou des « guéguerres » de voisinage, c’est-à-dire de petites villes proches, jalouses de son succès, qui en prirent ombrage.
En 1995, quelques intrépides, passionnés de traditions, relancèrent cette foire et le succès fut immédiat. Il y eut une année où la météo exécrable ne permit pas son déroulement normal.
En 2002, elle fut compromise par les inondations du 7 septembre. Mais les organisateurs ne se résignèrent pas et les Aramonais relevèrent magnifiquement le défi : 72 jours après, ils nous offrirent sans doute la plus belle et la plus émouvante foire de la Saint-Martin, comme une résurrection, comme un pied de nez à la fatalité.
Derrière ce rendez-vous annuel, que de pugnacité, que d’heures de travail bénévole, offertes tout au long de l’année pour le plaisir des habitants, petits et grands. La ville leur doit un grand « merci ». Chapeau bas, Messieurs Dames !
. 8 .
Epilogue
Dans le Midi, tout commence et tout finit en chantant. Alors avant de clore ce recueil d’historiettes, faisons un rêve.
C’est un soir d’hiver comme autrefois : dans les rues du village, la neige crisse sous les pas, des flocons brassés par le mistral tourbillonnent à la lueur des réverbères, et les fumées qui s’échappent des cheminées des maisons sont rabattues par le vent sur les toits blancs. Tous les fantômes d’Aramon ont été invités à nous rejoindre à Saint-Pancrace pour la veillée d’un 24 décembre surréaliste. Y aura-t-il assez de place pour les accueillir ? C’est qu’ils sont des milliers.
Certains prétendent qu’une âme pèse 21 grammes10.
Ce n’est pas lourd et ça ne prend pas beaucoup de place, en faisant des couches superposées jusqu’à la voûte, on devrait pouvoir caser tout le monde.
Que de retrouvailles ! Voici qu’apparaissent tous les marquis de l’histoire du village en costumes d’époque, ils ont naturellement retrouvé leur place à gauche de l’autel et se congratulent à qui mieux-mieux.
Les sœurs Tolèle s’affolent à l’idée de faire la quête avec tout ce monde : « Tu as vu, dit l’ainée, le curé Vialat est bien entouré. Il paraît que la messe sera dite par l’abbé Domergue.
- En voilà un qui doit regretter d’avoir écrit la « Marche des Rois » trop tôt, en un temps où il n’y avait pas de droits d’auteur, réplique sa cadette. Aujourd’hui, il serait millionnaire.
- Et qui c'est le vieux tout en blanc ?
- Le père Gaucher, qui arrive à pied de l’abbaye de Frigolet.
- Boudiou, il a le nez tout rouge, il a dû prendre froid !
- Et ces âmes toutes de bleu vêtues ?
- C’est les poilus de 14-18 pardi !
- Et tous ces enfants qui agitent leur ailes ?
- Té, c’est les pauvres petits qui sont montés au ciel sans avoir le temps de connaître le goût du pastis.
- Et celle-la, la fiérote, on dirait Diane de Poitiers, ah la la, ces histoires qu’elle a pu nous faire ! »
Un coup de sonnette retentit, tout le monde se tait et se recueille en inclinant la tête. Doucement, les ânes et les agneaux remontent l’allée centrale jusqu’à l’autel, précédant les figurants de la Crèche. Chacun se place comme il faut pour reconstituer la scène de la Nativité.
Le pére Domergue peut alors entonner ses litanies. Puis c’est au tour de la chorale de se faire entendre, d’animer les « interludes » de la cérémonie.
Les trois messes rituelles se déroulent selon la tradition. C’est long, mais difficile d’y échapper. Toutes les chaises ne se valent pas et certains se balancent d’une fesse sur l’autre pour se soulager de l’inconfort. Des enfants baillent, d’autres piquent du nez. Le père Gaucher se met à ronfloter.
Arrive le « Minuit Chrétien », la voix du ténor italien, Edmoundo Béridoto, fait sursauter l’assistance et envahit l’espace comme par magie.
« Que c’est beau, mon Dieu que c’est beau » murmure la cadette des sœurs Tolèle.
A l’issue de ce rituel méridional, religieux et populaire, l’assemblée se retrouve dans la rue pour participer au banquet communal de Noël.
Miracle, le mistral est parti voir ailleurs, la température s’est adoucie et si l’on s’en donne la peine, on peut apercevoir quelques étoiles dans le ciel. Sur le Planet, se déroule une animation que beaucoup auraient aimé voir un jour : les vivants se mêlent aux âmes et forment une farandole entrainée par Sorbier et Decugis… Familiers et inconnus, amis ou ennemis d’hier et d’aujourd’hui, tous les Aramonais se donnent la main. Les anciens tombent dans les bras les uns des autres. Difficile de tous les citer, ils sont si nombreux qu’une chaîne ininterrompue se déploie jusqu’au Moulin de Bassot, passe par la Croix de Corté, se faufile sous le pont du château, saluée par un marquis perché sur son balcon en compagnie de la famille Toselli.
On entend chanter dans les cafés, on reconnait tous les proches disparus, heureux de se retrouver et de trinquer en entonnant une couplet qui n’est guère de circonstance : « Ah viens dans les grands bois, chérie, comme autrefois et tu t’endormiras entre mes bras ». Mais le ciel nous pardonne.
Un immense table a été dressée, généreusement décorée par la mère Buyas et ses filles :
« Oh madame Buyas, je ne vous avais pas vue, c’est bien votre mètre de drapier qui vous sert de canne ? Ca vous aide à marcher ! Dites, en passant devant votre bazar, il y avait de la lumière dans la vitrine et de plus, votre porte est entrouverte.
- Je sais, c’est fait exprès, pour la petite fille chétive qui va chercher son lait chez Guillon, j'ai laissé un petit mot qui dit « Petite, n’aie pas peur de rentrer dans le magasin et prend ce qui te plait – mais attention, c’est bien parce que c’est TOI. »
Voilà que passe Romain à bicyclette avec Aglaë, assise en amazone, sur le porte-bagage :
« Oh romain, d’où tu viens comme ça ? D’Avignon ?
- De bien plus loin, mon pôvre, figure-toi qu’on a acheté le chalet Reynard. Eh oui, le Ventoux nous manquait ».
« Hé, Gabrielle, vous semblez bien joyeuse ce soir ?
- Bah, il faut bien que jeunesse se passe, je resterai l’œil ouvert jusqu’au lever du jour, des fois que les garnements voudraient murer mes fenêtres.
- A propos, il est passé où le monument aux morts devant le Casino ?
- C’est que tout ca n’existe plus. Pareil pour le cimetière, ils en ont fait un terrain de pétanque parce que celui des Arènes était devenu trop petit.
- Oh Cappeau, où tu vas ? Tu restes pas avec nous ?
- Eh bien tout à coup, j’ai eu le mal du pays, la nostalgie de Roquemaure, alors je vous quitte.
- Comment ça tu nous quittes ? Avec ce temps à la neige ? Et comment tu vas faire pour y aller ?
- Comme autrefois, par le Rhône. J’ai bricolé mon vieux vélo pour en faire un pédalo. Je profite que le fleuve est au bas du quai, avant que la prochaine crue arrive et chamboule tout. J’ai racheté ma terre et je vais y planter des cerisiers ».
Du coté des tables, toute le monde s’affaire. Le banquet fait honneur aux traditions… « Où sont les cardons ? » Voici que Marie-jeanne fend la foule avec sa brouette chargée de cardes d’une blancheur éclatante : « Allez les petits, aidez-moi à décharger, je dois y retourner et suivez-moi, j’en ai encore et en plus, un tas d’ail violet. »
A propos de Violet, le roi des chasseurs se présente les bras chargés de gibier : « J’apporte aussi un tas de conserves et de patés… Il y en aura pour tout le monde. Qui m’accompagne pour les porter ?
- Je viens avec toi, dit Ancelin, en passant je prendrais mes pots de jujubes séchés, vous verrez, c’est meilleur que des dattes ».
Apparaît le père Faune avec sa grosse bonbonne d'huile d’olive : « Elle est encore bonne, faut la filtrer un peu, il y a quelques impuretés ».
Depuis la rue Pitôt, on entend le bruit d’une barrique qu'on roule, ce sont les deux filles de Fifine Brunel « Voilà des anchois des tropiques, ce sont les dernières à la vente, on va chercher les roqueforts et on revient. »
Prosper et son frère Zé rappliquent avec des chapelets de saucisses à n’en plus finir ; Gilette et Annette, des Bourgades et du Planet se chargent des 13 desserts ; Sorbier, Sardou et Joachim ont mis leur cave à disposition, on ne risque pas de mourir de soif !
« Allez, tout le monde à table ! ». Les convives prennent place sur les bancs et les chaises rempaillées, la mine enjouée de se retrouver autour d’un bon gueuleton. C'est le moment que choisit Martin Robinet (plombier de son état, suivi par son chien et encore équipé de son vélo, sa caisse à outils et son fusil de chasse, un 16 Harmerlès) pour passer les tables en revue et déclarer : « Et la bûche ? Vous y avez pensé à la bûche ? »
Echanges de regards et consternation ! On a bel et bien oublié.
« C’est bon, je m’en occupe. Le pâtissier m’attend depuis l’ouverture de la chasse pour réparer une fuite d’eau. Je sais, je sais, c’est long, mais j’ai pas eu le temps… Jusqu’à ce soir. »
Martin Robinet enfourche son vélo et se rend chez Jarrié le boulanger-pâtissier : « Oh Marcel, dit-il, je répare tout de suite toutes les fuites que tu veux, mais au lieu de me payer en liquide, tu me fournis quelques mètres de bûche ».
Sitôt dit, sitôt fait, Marcel le maître-pâtissier et Josef l’Autrichien se mettent à l’ouvrage.
C’est ainsi que les convives du banquet de Noël applaudirent l’arrivée de 7 petits lutins à la queue leu leu portant sur la tête des planches à pain chargées d’une bûche si longue qu’on n’en voyait pas la fin.
« Mais, ce sont les petits de Jeannette et de Marie-Louise ! Mon Dieu qu’ils sont beaux ! Remarque Fifine Brunel.
- T’as vu cette bûche, réplique la fille Buyas, je suis sûre qu’elle pèse plus que le bavarois ! »
Ramel et Lamouroux assis face à face se racontent des histoires de Maires. Tiens, le Vénézuélien est revenu, il est en compagnie de son ennemi le notable et trinque à la santé du nouveau « nez ». Dudule et son chien Kiki se déplacent de table en table, histoire de s’assurer que tout va bien.
C’est une festival de mandibules animées par la dégustation, la conversation et les éclats de rires.
Martin Robinet qui avait suivi le cortèrge de la bûche à vélo,
avec sa boite à outils et son chien, soudain épaule son 16 Hamerlès, vise le ciel et « Pan ! ». Alors, dans la nuit étoilée, éclate un somptueux feu d’artifice multicolore.
Puis les musiciens s’affairent : Mademoiselle Vidal s’installe au piano, Champetier sort son saxo, Violet ajuste sa batterie, Hubert Rosier accorde son violon et place à la musique.
Des couples se forment et s’élancent pour la danse. Maurice et sa marseillaise, Romain toujours aussi maladroit, mais guidé par Aglaë, il y a même Poutoun et Poutoune qui se bécotent encore, Prosper malgré sa corpulence fait preuve d’une belle agilité… Tiens, voilà le Papé du trou de l’île qui se dandine en tenant son petit-fils par la main… Profitant de l’affluence, la petite Lucie entraîne un gros timide vers le passage du Bon Lait, pressée qu’elle est d’échanger son premier baiser.
Pour ceux qui n’aiment pas danser, Savoyan a ouvert son cinéma du Planet, on y joue « Quand passent les cigognes », un film russe. Ah, les beaux yeux de l’héroïne, Tatiana. Aux actualités, on entend encore et toujours la même rengaine : « Français, Françaises, retroussons les manches et ça ira mieux ».
Le film est fini, l’orchestre fatigue, le temps s’étire. Les danseurs se sont dispersés. Se produit alors un petit miracle : Antoine Bussi l’Avignonnais, clarinette en mains, égrène les premières notes de « Petite Fleur ». Un couple demeure sur la piste, tendrement enlacé, Armand et son amour de jeunesse. Ils tanguent seuls au monde, pour l’éternité.
Mais tout a une fin. Même le songe d’une nuit d’hiver. Aramon entame son troisième millénaire. Là comme ailleurs, la convivialité, le partage, la fantaisie, la liberté… Evaporés.
Où sont passés les conteurs, me direz-vous ? Je vous laisse la réponse.
Remerciements
La réalisation de ce livre n’aurait pas été possible sans la complicité et le soutien de quelques-uns.
Merci à Jacqueline, mon épouse, qui m’a supporté et accompagné pendant les semaines de recherches, de doutes et de travail exigés par l’écriture (c’était elle, la petite fille au pot au lait qui badait les jouets dans la vitrine du Bazar Buyas).
Merci à mes enfants et mes neveux.
Merci à la famille Rosier.
Merci à Michèle Arlhac, Marie-Claire Lambert, Roselyne Boyer, Marie-Thé, Maryse, Monique Lamouroux-Petit, Josy, Georgette Salvador, Gérard, Jacques, Joël, Jean, Zé, Denis Coulomb dit « la mémoire », Dominique Lurcel et son équipe, et tant d’autres (qu’ils me pardonnent de ne pas tous les citer) qui m’ont incité à tenter cette aventure.
Merci à Martine (petite nièce de Marcel le boulanger, mon père) pour son talent et son savoir-faire éditorial.
Michel Jarrié, dit Titoye
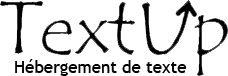
Commentaires
#5
de OpiedesmOts
le 07/08/2019
Bravo. Beau moment de lecture. Un plaisir à lire.
John
#4
de Haruko-San
le 30/07/2019
Oh mais que c'est beau, joliment raconté émouvant, et quel beau pays que le nôtre!!! Notre région est superbe, vous la décrivez avec vos souvenirs ce qui la rend vivante et chantante. L'impression de vous suivre pas à pas au fur et mesure! Superbe. Merci Michel.
#3
de Mariemula
le 12/10/2018
Un beau moment de lecture, j'ai plongé dans cet univers et me suis sentie transportée à Aramon. Je n'ai pas résisté à l'envie d'aller voir sur Internet ce bel endroit si riche en histoire (embelli par votre récit). Merci à vous, l'histoire, la mémoire est vivante grâce à des personnes telles que vous car vous contez avec les mots justes, de belles phrases et c'est un plaisir de vous lire.
Merci à vous. Marie
#2
de Nadine
le 17/12/2017
Extraordinaire , ce que vous avez écrit . J'ai pris un immense plaisir à lire vos souvenirs . Tristes parfous , facétieux souvent mais tellement d'amour , de respect , d' humanité .
Vraiment merci . Nadine
#1
de nicora
le 07/10/2017
souvenirs partagés
Poster un commentaire