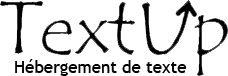MATTHEW B. CRAWFORD
Essai sur le sens
et la valeur du travail
Traduit de l’anglais (États-Unis)
par Marc Saint-Upéry
Introduction
Si vous cherchez une bonne machine-outil, adressez-vous
à Noel Dempsey, qui tient boutique à Richmond, en Virginie.
Le magasin bien achalandé de Noel est plein de
tours, de fraiseuses et de scies circulaires ; il se trouve
que la plupart de ces outils proviennent d’établissements
scolaires. On trouve également en abondance ce genre
d’équipement sur eBay et, là aussi, il s’agit généralement
d’objets en provenance de high schools ou de collèges. Cela
fait près de quinze ans qu’ils circulent sur le marché de
l’occasion. C’est en effet dans les années 1990 que les cours
de technologie ont commencé à disparaître dans l’enseignement
secondaire américain, quand les enseignants ont
commencé à vouloir préparer leurs élèves à devenir des
«travailleurs de la connaissance» (knowledge workers).
La disparition des outils de notre horizon éducatif est
le premier pas sur la voie de l’ignorance totale du monde
d’artefacts que nous habitons. De fait, il s’est développé
depuis quelques années dans le monde de l’ingénierie une
nouvelle culture technique dont l’objectif essentiel est de
dissimuler autant que possible l’intérieur des machines. Le
résultat, c’est que nombre des appareils que nous utilisons
dans la vie de tous les jours sont devenus parfaitement
indéchiffrables. Soulevez le capot de certaines voitures
(surtout si elles sont de marque allemande) et, en lieu et
place du moteur, vous verrez apparaître quelque chose
qui ressemble à l’espèce d’obélisque lisse et brillant qui
fascine tellement les anthropoïdes au début du film de
Stanley Kubrick 2001: L’Odyssée de l’espace. Bref, ce que vous
découvrez, c’est un autre capot sous le capot. Cet art de la
dissimulation a bien d’autres exemples. De nos jours, pour
défaire les vis qui maintiennent ensemble les différentes
parties des appareils de petite taille, il faut souvent utiliser
des tournevis ultraspéciaux qui sont très difficiles à trouver
dans le commerce, comme pour dissuader les curieux ou
les insatisfaits de mettre leur nez dans les entrailles de ces
objets. Inversement, mes lecteurs d’âge mûr se souviendront
sans doute que, il n’y a pas si longtemps, le catalogue
Sears incluait des graphiques et des schémas décrivant les
parties et le fonctionnement de tous les appareils domestiques
ainsi que de nombreux autres engins mécaniques.
L’intérêt du consommateur pour ce genre d’information
passait alors pour une évidence.
Ce déclin de l’usage des outils semble présager un
changement de notre relation avec le monde matériel,
débouchant sur une attitude plus passive et plus
dépendante. Et, de fait, nous avons de moins en moins
d’occasions de vivre ces moments de ferveur créative où
nous nous saisissons des objets matériels et les faisons
nôtres,qu’il s’agisse de les fabriquer ou de les réparer.
Ce que lesgens ordinaires fabriquaient hier, aujourd’hui
ils l’achètent; et ce qu’ils réparaient eux-mêmes, ils le
remplacent intégralement ou bien louent les services
d’un expert pour le remettre en état, opération qui implique
souvent le remplacement intégral d’un appareil en raison
du dysfonctionnement d’une toute petite pièce.
Cet ouvrage plaide pour un idéal qui s’enracine
dans la nuit des temps mais ne trouve plus guère d’écho
aujourd’hui: le savoir-faire manuel et le rapport qu’il crée
avec le monde matériel et les objets de l’art. Ce type de
savoir-faire est désormais rarement convoqué dans nos
activités quotidiennes de travailleurs et de consommateurs,
et quiconque se risquerait à suggérer qu’il vaut la
peine d’être cultivé se verrait probablement confronté
aux sarcasmes du plus endurci des réalistes: l’économiste
professionnel. Ce dernier ne manquera pas, en effet, de
souligner les «coûts d’opportunité» de perdre son temps à
fabriquer ce qui peut être acheté dans le commerce. Pour
sa part, l’enseignant réaliste vous expliquera qu’il est
irresponsable de préparer les jeunes aux professions artisanales
et manuelles, qui incarnent désormais un stade révolu de
l’activité économique. On peut toutefois se demander si
ces considérations sont aussi réalistes qu’elles le prétendent,
et si elles ne sont pas au contraire le produit d’une certaine
forme d’irréalisme qui oriente systématiquement les jeunes
vers les métiers les plus fantomatiques.
Aux environs de 1985, on a commencé à voir apparaître
dans les revues spécialisées en éducation des articles
intitulés « La révolution technologique en marche » ou
«Préparez vos enfants à un avenir high-tech mondialisé ».
Bien entendu, ce genre de futurisme n’est pas nouveau en
Amérique. Ce qui est nouveau, c’est le mariage du futurisme
et de ce qu’on pourrait appeler le « virtualisme »,
l’idée que, à partir d’un certain moment, nous finirons par
prendre congé de la réalité matérielle et par flotter librement
dans un univers économique d’information pure.
En fait, ce n’est pas si nouveau, cela fait bien cinquante
ans qu’on nous ressasse que nous sommes au seuil de la
«société postindustrielle». S’il est vrai que nombre d’emplois
industriels ont migré sous d’autres cieux, les métiers
manuels de type artisanal sont toujours là. Si vous avez
besoin de faire construire une terrasse ou de faire réparer
votre véhicule, les Chinois ne vous seront pas d’une grande
utilité. Rien d’étonnant à cela, ils habitent en Chine. Et
on constate l’existence d’une pénurie de main-d’œuvre
tant dans le secteur de la construction que dans celui de
la mécanique auto. Pourtant, les intellectuels ont trop souvent
eu tendance à mettre ces métiers manuels dans le même sac
que les autres formes de travail industriel: tout
ça, c’est des boulots de «cols bleus», et donc tous censés
appartenir à une espèce en voie de disparition. Mais,
depuis peu, ce consensus a commencé à se fissurer ; ainsi,
en 2006, le Wall Street Journal se demandait si « le travail
[manuel] qualifié n’était pas en train de devenir l’une des
voies privilégiées pour accéder à une vie confortable ».
Ce livre n’est pas vraiment un livre d’économie ; il
s’intéresse plutôt à l’expérience de ceux qui s’emploient à
fabriquer ou réparer des objets. Je cherche aussi à comprendre
ce qui est en jeu quand ce type d’expérience tend
à disparaître de l’horizon de nos vies. Quelles en sont les
conséquences du point de vue de la pleine réalisation de
l’être humain? L’usage des outils est-il une exigence
permanente de notre nature? Plaider en faveur d’un renouveau
du savoir-faire manuel va certainement à l’encontre de nombre
de clichés concernant le travail et la consommation; il s’agit donc
aussi d’une critique culturelle. Quelles sont donc les origines,
et donc la validité, des présupposés qui nous amènent à considérer
comme inévitable, voire désirable, notre croissant éloignement de
toute activité manuelle?
Je ferai souvent référence à ma propre expérience
de travail, la plus récente en particulier, celle de
mécanicien moto. Quand je vois une moto quitter mon atelier
en démarrant gaillardement, et ce, quelques jours après
y avoir été transportée à l’arrière d’un pick-up, toute ma
fatigue se dissipe, même si je viens de passer la journée
debout sur une dalle de béton. À travers la visière de son
casque, je devine le sourire de satisfaction du motocycliste
privé de véhicule depuis un bon bout de temps. Je le salue
d’un geste de la main. Une main sur la manette des gaz
et une autre sur l’embrayage, je sais qu’il ne peut pas me
rendre mon salut. Mais je déchiffre un message de gratitude
dans la joyeuse pétarade du moteur qu’il fait s’emballer pour le
plaisir. J’aime cette sonorité exubérante, et je sais que lui aussi.
Ce qui passe entre nous, c’est une conversation de ventriloques
au timbre mécanique, et le message en est tout simple:
«Ouaaaaaaaaais!»
La sensation de cette liasse de billets dans ma poche
n’a rien à voir avec les chèques que je recevais dans mon
précédent boulot. Parallèlement à mes études de doctorat
en philosophie politique à l’université de Chicago, je travaillais
comme directeur d’une fondation à Washington,
un think tank, comme on dit. J’étais constamment fatigué
et, sincèrement, je ne voyais pas très bien pourquoi j’étais
payé : quels bien tangibles, quels services utiles mon travail
fournissait-il à qui que ce soit? Ce sentiment d’inutilité était
passablement déprimant. J’étais bien payé, mais
c’était pratiquement comme recevoir une indemnité et, au
bout de cinq mois, j’ai laissé tomber pour ouvrir mon atelier
de réparation de motos. Peut-être que je ne suis pas
doué pour le travail de bureau. Mais, en réalité, je doute
fort que mon problème soit exceptionnel. Si je raconte ici
ma propre histoire, ce n’est pas parce que je crois qu’elle
sort de l’ordinaire, mais au contraire parce que je pense
qu’elle est assez banale. Je veux rendre justice à certaines
intuitions qui sont partagées par beaucoup de gens, mais
qui n’ont pas suffisamment de légitimité publique. Tel
est le sujet de ce livre: j’ai toujours éprouvé un sentiment
de créativité et de compétence beaucoup plus aigu dans
l’exercice d’une tâche manuelle que dans bien des emplois
officiellement définis comme « travail intellectuel ». Plus
étonnant encore, j’ai souvent eu la sensation que le travail
manuel était plus captivant d’un point de vue intellectuel. Cet
ouvrage est donc une tentative de comprendre pourquoi.
Je tire mes exemples de deux domaines essentiellement,
ceux des métiers de la réparation et de la construction.
Ce sont des professions avec lesquelles j’ai une
certaine familiarité (j’ai aussi travaillé comme électricien),
mais je pense que mon raisonnement peut aussi s’appliquer
à d’autres types de tâches. Il se trouve que la plupart
des individus qui apparaissent dans cet ouvrage sont des
hommes, mais je suis certain que les femmes, elles aussi,
savent reconnaître l’attrait de ce genre d’activité tangible
et directement utile.
Maintenant, quelques mots sur ce que ce livre n’est pas.
Je souhaite éviter le halo de mysticisme qui s’attache souvent
aux éloges du savoir-faire artisanal, car il s’agit pour moi
simplement de rendre justice aux satisfactions qu’il nous
offre. Vous ne trouverez donc pas ici de digressions sur
les fabricants de sabres japonais ou autres merveilles.
J’emploierai de préférence le terme de « métier » (trade)
plutôt que celui d’«art» (craft) pour souligner le caractère
prosaïque de mon sujet (mais je n’observerai pas cette
distinction avec une rigueur systématique). Comparés à ceux
d’un véritable artisan, mes maigres talents ne pèsent pas
grand-chose; par conséquent, je n’ai aucune compétence
pour parler de l’arôme de haute spiritualité qui est censé
se dégager d’un tenon parfaitement emmanché dans sa
mortaise, ou de quoi que ce soit dans le genre. Disons
que, grosso modo, le savoir-faire de l’artisan dé€nit une
norme idéale, mais que, dans un système marchand de
consommation de masse comme le nôtre, c’est l’activité de
l’homme de métier qui incarne un mode de vie économiquement
viable. Du moins s’agit-il d’un modèle largement accessible et
qui offre une série de satisfactions similaires à celles que nous
associons au savoir-faire artisanal. Nous tendons également à
imaginer l’artisan dans le confort de son atelier, tandis que
l’homme de métier travaille hors de chez lui et doit ramper sous
un évier ou grimper au sommet de poteaux électriques et,
en général, essayer de faire fonctionner des objets qui ne
lui appartiennent pas.
Par conséquent, j’essaie d’éviter les images enjolivées du
travail manuel dans lesquelles se complaisent parfois les
intellectuels. Je ne pense pas non plus qu’il soit intéressant
de nourrir la nostalgie d’une vie «plus simple» et soi-disant
plus authentique, ou bien dotée d’une aura démocratique
plus prestigieuse du fait d’être liée à la « classe ouvrière ».
Certes, mon intention est bien de réhabiliter l’honneur des
métiers manuels en tant qu’option professionnelle parfaitement
légitime, mais j’ai choisi de le faire à partir de ma propre
expérience, qui ne gagne rien à être
lue à la lumière de ces idéaux contestables. La plupart
des individus avec qui j’ai travaillé comme électricien ou
comme mécanicien ne correspondaient guère à l’image
traditionnelle du «col bleu». Nombre d’entre eux étaient
des excentriques, des réfugiés d’une existence antérieure
trop étriquée. Certains dérivaient entre travail et inactivité,
selon les circonstances.
Cet ouvrage propose une série d’arguments en faveur
d’une forme de travail dont on peut dire qu’elle a du sens
parce qu’il s’agit d’un travail vraiment utile. Il explore
également ce qu’on pourrait appeler l’éthique de l’entretien
et de la réparation. Ce faisant, j’espère qu’il aura
quelque chose à dire aux personnes qui, sans exercer
professionnellement ce genre d’activité, s’efforcent d’arriver
dans leur vie à un minimum d’indépendance (self-reliance)
matérielle à travers la connaissance pratique des objets
matériels qui nous entourent. Nous n’aimons pas que ce
que nous possédons nous dérange. Pourquoi certains des
nouveaux modèles de Mercedes n’ont-ils plus de jauge à
huile, par exemple? Qu’est-ce qui nous séduit dans l’idée
d’être débarrassés de toute interaction importune avec
les choses qui nous entourent ? Poser ces questions
fondamentales concernant notre culture de consommation,
c’est aussi poser des questions fondamentales sur le sens du
travail, parce que plus les objets utilitaires sont dociles et
discrets, plus ils sont compliqués. Et quels effets cette
complexité croissante des voitures et des motos, par exemple,
a-t-elle eus sur les tâches de ceux qui sont chargés de leur
entretien? On entend souvent dire qu’il faut «requalifier»
la main-d’œuvre pour qu’elle soit à la hauteur de l’évolution
technologique. À mon avis, la question est plutôt la suivante:
quel type de personnalité doit posséder un mécanicien du
XXIe siècle pour tolérer la couche de gadgets électroniques
inutiles qui parasite aujourd’hui le moindre appareil ?
Il s’agit donc d’une tentative de cartographier les
territoires imbriqués où se côtoient l’idée d’un « travail doté
de sens » et celle de l’« indépendance » (self-reliance). Ces
idéaux sont tous deux liés à la lutte pour l’expression active
de l’individu (individual agency) qui est au centre même de
la vie moderne. Quand nous contemplons notre existence
sous l’angle de cette lutte, certaines expériences acquièrent
une plus grande importance. Tant comme travailleurs que
comme consommateurs, nous sentons bien que nos vies
sont contraintes par de vastes forces impersonnelles qui
agissent sur nous à distance. Ne sommes-nous pas en train
de devenir chaque jour un peu plus stupides? Pour avoir
la moindre prise sur le monde, intellectuellement parlant,
ne nous faut-il pas aussi avoir un minimum de capacité
d’agir matériellement sur lui?
Pour certaines personnes, cela signifie cultiver son
propre potager. On dit même qu’il y a maintenant des
gens qui élèvent des poulets sur les toits des immeubles de
New York. Ces néo-agriculteurs expliquent qu’ils éprouvent
une profonde satisfaction dans le fait de récupérer une
relation plus directe avec ce qu’ils mangent. D’autres
décident de faire du tricot et sont tout fiers de porter des
vêtements qu’ils ont créés de leurs propres mains.
L’économie domestique de nos grands-mères redevient tout
d’un coup le dernier cri de la mode. Comment expliquer
ces phénomènes?
Quand les temps économiques sont durs, la frugalité
est à l’ordre du jour. Or, la frugalité requiert un certain
niveau d’autonomie, c’est-à-dire la capacité de prendre
soin de ses propres affaires. Mais ce nouveau goût pour
l’autonomie semble bien avoir émergé avant le début de
la crise, et la tendance à la frugalité n’est peut-être qu’une
justification économique superficielle d’un mouvement qui
répond en fait à un besoin plus profond: le désir de rendre
notre univers intelligible afin de pouvoir nous en sentir
responsables. Ce qui implique la possibilité de réduire la
distance entre l’individu et les objets qui l’entourent.
Nombreux sont ceux qui s’efforcent de restaurer une
vision des choses à échelle humaine et de se libérer au
moins partiellement des forces obscures de l’économie
mondialisée.
Cette poignante aspiration à la responsabilité, que nombre
de gens ressentent dans la sphère domestique, ne
serait-elle pas en fait (en partie) une réaction aux
bouleversements du monde du travail, au sein duquel
l’expérience de l’agir individuel tend de plus en plus à disparaître ?
Malgré toutes les pseudo-normes d’évaluation concoctées
par la hiérarchie managériale, les personnes qui travaillent
dans un bureau ont souvent l’impression que leur travail
ne répond pas au type de critère objectif que fournit, par
exemple, un niveau de menuisier et que, par conséquent,
la distribution du blâme et de l’éloge y est parfaitement
arbitraire. La mode du «travail en équipe» rend de plus en
plus dif€cile l’attribution de la responsabilité individuelle
et a ouvert la voie à des formes singulières et inédites de
manipulation managériale des salariés, lesquelles adoptent
le langage de la thérapie motivationnelle ou de la dynamique
de groupe. Les cadres supérieurs eux-mêmes vivent
dans une condition d’incertitude psychique déroutante
liée au caractère anxiogène des impératifs extrêmement
vagues auxquels ils doivent obéir. Quand un étudiant
tout juste sorti de l’université est convoqué à un entretien
d’embauche pour un poste de « travailleur intellectuel»,
il découvre que le chasseur de têtes qui l’interroge ne lui
pose jamais aucune question sur ses diplômes et ne s’inté-
resse absolument pas au contenu de sa formation. Il sent
bien que ce qu’on attend de lui, ce n’est pas un savoir, mais
plutôt un certain type de personnalité, un mélange d’affabilité
et de complaisance. Toutes ces années d’études ne
serviraient-elles donc qu’à impressionner la galerie? Ces
diplômes obtenus à dure peine ne seraient-ils qu’un billet
d’entrée dans un univers de fausse méritocratie? Ce qui
ressort de tout ça, c’est un hiatus croissant entre forme et
contenu, et l’impression de plus en plus nette que tout ce
qu’on nous raconte sur le sens du travail est complètement
à côté de la plaque.
Plutôt que d’essayer de nier ce malaise, il est peut-être
temps d’en tirer quelque chose de constructif. Au moment
où j’écris ces lignes, l’ampleur de la crise économique est
encore incertaine, mais elle semble s’approfondir. Les institutions
et les professions les plus prestigieuses sont en train
de traverser une véritable crise de confiance. Mais cette
crise est aussi une occasion de remettre en question nos
présupposés les plus élémentaires. Qu’est-ce qu’un «bon»
travail, qu’est-ce qu’un travail susceptible de nous apporter
tout à la fois sécurité et dignité? Voilà bien une question
qui n’avait pas été aussi pertinente depuis bien longtemps.
Destination privilégiée des jeunes cerveaux ambitieux,
Wall Street a perdu beaucoup de son lustre. Au milieu de
cette grande confusion des idéaux et du naufrage de bien
des aspirations professionnelles, peut-être verrons-nous
réémerger la certitude tranquille que le travail productif
est le véritable fondement de toute prospérité. Tout d’un
coup, il semble qu’on n’accorde plus autant de prestige
à toutes ces méta-activités qui consistent à spéculer sur
l’excédent créé par le travail des autres, et qu’il devient
de nouveau possible de nourrir une idée aussi simple que:
«Je voudrais faire quelque chose d’utile.»
Retour aux fondamentaux, donc. La caisse du moteur
est fêlée. Il est temps de la démonter et de mettre les mains
dans le cambouis.