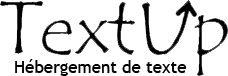INTRO (empty)
REVUE DE LITTERATURE
L’alliance thérapeutique
Définition
La définition de Bordin (1979) est souvent citée pour évoquer ce qu’est l’alliance thérapeutique. Selon lui, elle est constituée de 3 processus : la validation consensuelle des objectifs de la psychothérapie, la définition en commun des tâches à accomplir et l’établissement d’un lien affectif. Cette conception est une synthèse de notions déjà évoquées plus tôt. Sterba (1934), dans le cadre du travail thérapeutique, évoque l’alliance qui se tisse entre le « Moi » rationnel du patient et le thérapeute, soulignant ainsi la dimension coopérative de la relation. Dans cette même optique Menninger (1958), insiste sur l’importance du « contrat » thérapeutique régissant la relation. Le terme de « contrat » évoque les engagements réciproques envers chaque co-signataire. Par ailleurs, d’autres influences (Zetzel, 1956) viennent souligner l’importance de la relation réelle dans le travail thérapeutique. Par relation réelle, il faut entendre que « Le terme traduit alors l’idée qu’un lien premier doit se constituer afin de permettre l’amorce puis la poursuite du processus thérapeutique, s’opposant ainsi aux éléments signifiants qui peuvent faire échec à la rencontre thérapeutique, puis au processus lui-même. Ce lien est fondé sur le désir conscient du patient de coopérer avec l’analyste et sur une identification partielle à l’analyste analysant les résistances » (Gadeau, 2002). Greenson (1967) considère que certains aspects de la relation ne doivent pas être sujets à interprétation, car ils relèveraient de la relation réelle. L’ensemble de ces réflexions relatives à la relation entre patient et thérapeute amène Bordin à concevoir l'alliance thérapeutique selon ces 3 objets : les objectifs, les tâches, le lien.
Luborsky élabore la relation thérapeutique selon les mêmes mécanismes. Il conçoit cette alliance comme « ce point dans la relation thérapeutique où d’un côté le patient élève le thérapeute à sa position d’autorité, mais d’un autre croit que cette puissance et cette autorité sont partagées entre eux, qu’il y a un sens profond de collaboration et de participation dans le processus. De cette façon, un attachement positif se développe entre le client et le thérapeute » (Luborsky, 1976). Cette conception insiste sur l’importance de la collaboration entre chaque protagoniste, leur engagement opérationnel vers un objectif commun et l’instauration d’un lien affectif. Selon Luborsky, l’alliance thérapeutique peut-être de deux types qu’il désigne par « type 1 » et « type 2 ». Le type 1 est caractérisé par le fait que le patient utilise cette relation comme un soutient, dont il est le centre d’attention. Le thérapeute apparaît comme une figure aidante, et le patient, comme l’acteur principal de la démarche. Le type 2 se définit davantage par un travail collaboratif se concentrant sur le phénomène désigné comme problématique. Le sentiment de groupe (we-ness) met l’accent sur la répartition des responsabilités de chaque interlocuteur pour atteindre l’objectif thérapeutique. En 1984, Luborsky simplifie sa conception de l’alliance thérapeutique en indiquant qu’il s’agit d’un rapport collaboratif et affectif entre le patient et le thérapeute.
Cette vision de l’alliance thérapeutique est partagée par plusieurs chercheurs de l’époque. Dare et Hodler (1975), consolide cette définition en indiquant que « l’alliance de traitement repose sur le désir conscient ou inconscient de coopération de la part du patient et sur le fait qu’il est prêt à accepter que le thérapeute l’aide à surmonter ses difficultés internes. (…) Dans l’alliance de traitement, il y a une acceptation du besoin de s’occuper des problèmes internes et d’effectuer le travail analytique malgré des résistances du sujet et de son entourage ». Là encore, nous retrouvons l’idée de collaboration, basée sur le consentement réciproque d’effectuer un travail à visé thérapeutique.
En 1992, Lambert publie les résultats de ses recherches sur les facteurs communs. Il détermine que les facteurs de changement peuvent se répartissent en 4 classes et dont l’impact sur le processus thérapeutique varie : les facteurs extra-thérapeutique (40%), les facteurs communs (30%), les attentes (15%), les techniques thérapeutiques (15%). L’alliance thérapeutique se situe dans la catégorie des facteurs communs (Roten, 2006). L’alliance thérapeutique continue de susciter l’intérêt de la communauté scientifique dans le cadre de sa recherche de compréhension des mécanismes participant aux succès des psychothérapies. Vingt années plus tard, Roten (2011) nous dit que l’alliance thérapeutique n’est pas qu’une variable non spécifique, commune à toutes les psychothérapies, mais qu’au contraire, elle représente un facteur spécifique qui s’adapte aux modalités de la psychothérapie. Cependant, Roten tient à nuancer notre compréhension de son rôle et que, bien qu’elle ait une fonction importante dans le processus de changement, elle ne s’affranchit pas des autres facteurs tels que les caractéristiques du patient ou bien les techniques employées par les thérapeutes.
Les composants de l’alliance thérapeutique
Nous repartons de la définition de Bordin (1979) pour approfondir les trois éléments qui constituent l’alliance thérapeutique.
Commençons par la fixation des objectifs. Le patient peut s’engager dans un processus thérapeutique avec des attentes spécifiques vis-à-vis de celui-ci. Ces attentes se construisent au contact des premières interactions du patient avec d’autres figures aidantes, en amont de la démarche psychothérapeutique. Selon une perspective, psychanalytique, le patient auto-alimente ses souffrances : « Psychoanalytic (perhaps all psychodynamic) treatment rests on the mutual agreement that the patient's stresses, frustrations, and dissatisfactions are to a significant extent a function of his own ways of thinking, feeling and acting ». La thérapie est un moyen d’interrompre ces cercles vicieux. Cependant, les expériences de vie peuvent être un frein à cet objectif thérapeutique. Si un comportement a pu contribuer à contenir un patient lors d’évènements difficiles de sa vie, et si ce comportement devient lui-même la cause de souffrances (isolement, inhibition, agressivité, etc.), alors le patient peut se montrer rétif à l’idée de l’abandonner. Bordin esquisse la dimension cognitive de l’alliance thérapeutique en indiquant qu’il faut être attentif à la façon dont le sujet élabore son trouble, et particulièrement le locus de causalité (est-ce que le patient porte la responsabilité ou bien l’attribue-t-il à autre chose) « to call attention to ways in which the individual shares responsibility for his unsatisfactory experience ». La définition des objectifs est un sujet plus ou moins central en fonction du type de psychothérapie. Pour la psychanalyse, pensées et émotions déterminent le comportement et le ressenti de l’individu. Pour les comportementalistes, ces concepts ne sont pas pris en compte, car leur paradigme refuse toute théorie à leur sujet. Par conséquent, leurs objectifs n’intègrent pas la gestion des pensées et émotions. De nos jours, cette vision a évolué, et le corpus comportementaliste s’intègre dans une mouvance plus globale, dite cognitivo-comportementale qui intègre la gestion les pensées (volet cognitif) et les émotions (3e vague des TCC). Néanmoins la divergence du mode de définition des objectifs reste entière. Cette différence est particulièrement visible entre les TCC et la psychanalyse. Andreoli (2002) nous propose cette lecture de l’objectif thérapeutique de la psychanalyse « Concrètement, la psychothérapie analytique adopte (…) une démarche d’attribution de sens, dans le but supposé de développer des modes d’intervention qui soient à la fois cliniquement valables et plus pertinents aux buts et conditions d’exercice de la psychothérapie des troubles plus divers ». L’objectif est présenté comme devant permettre au patient d’intégrer un récit de vie ayant un sens. Pour ce qui relève des TCC, les objectifs sont définis en fonction d’un problème bien précis, puis, déclinés de façon très opérationnelle « Une fois le problème déterminé, patient et thérapeute se mettent d’accord sur des objectifs réalistes à atteindre et sur les moyens à mettre en œuvre, au moins approximativement (nombre de séances, étapes du traitement, types d’exercices probables, etc.) » (Bouvet, 2020). Pour résumer la spécificité de ces deux courants, Wildlöcher (2006) nous dit que « Les objectifs d’une psychothérapie ont souvent un caractère focal, en comparaison des objectifs de la psychanalyse (viser tel système défensif particulièrement gênant chez le patient, l’aider à se dégager d’affects et de fantasmes qui pèsent dans sa vie ou dans tels secteurs de celle-ci) ». Donc, du référentiel du thérapeute, en découlent les objectifs de la thérapie.
La tâche est un autre élément protéiforme de l’alliance thérapeutique. Selon Bordin, le type de tâche attribuée au thérapeute ou au patient découle directement des modalités de la psychothérapie. Dans le cadre de la psychanalyse, le thérapeute va faire usage de la libre association, utiliser la disposition originelle du patient dans le canapé, ou bien se maintenir en retrait pour ne pas avoir de contact visuel direct avec le patient. Dans le cadre de thérapie psychodynamique ou comportementaliste, le thérapeute ne va pas se concentrer sur le flux d’expérience interne, mais il va compter sur l’honnêteté de son patient pour mener sa thérapie. De même que les objets d’attention varient d’une psychothérapie à une autre. Les thérapies comportementales se concentrent sur l’observation des comportements, leur fréquence et contexte d’apparition, là où les thérapies Gestalt se concentrent sur la nature des actions et le contenu des pensées. Indépendamment de la nature des tâches attribuées au patient, un facteur clé de réussite consiste à tenir compte des capacités du patient à réaliser ces tâches afin d’augmenter les chances qu’il adhère à la thérapie. Bordin rappelle qu’il existe des thérapies pour lesquelles les tâches ne sont jamais indiquées telles que l’approche centrée sur la personne. Ces tâches apparaissent donc de façon spontanée et ambiguë. Concernant la nature des tâches et leur répartition au sein de la psychothérapie, elles sont, là encore, déterminées par le type de psychothérapie. Le paradigme propre à chaque approche amène à penser la souffrance selon leur propre conception. En effet, un symptôme est souvent vu comme le phénomène qui déclenche la psychothérapie, néanmoins, les façons de l’élaborer et d’y répondre varient d’un référentiel à l’autre. Boudoukha et al. (2021) nous propose un résumé de la façon dont les différents courants abordent la notion de symptômes. Il nous apparaît important de détailler ce sujet, car nous souhaitons montrer à quel point les conceptions du symptôme diffèrent, et par conséquent, à quel point les prises en charge qui en découlent sont fidèles à leurs présupposés. L’approche biologique (Kraeplin, Ey, Mayer) considère l’étiologie de la souffrance mentale comme provenant d’un dysfonctionnement cérébral dont la réponse doit intervenir sur le plan pharmacologique. Sur le plan psychanalytique (Freud), le symptôme est une émanation de l’inconscient dont l’expression est porteuse de sens. La prise en charge va consister à trouver le sens de ce symptôme. Pour les théories comportementalistes, le symptôme résulte d’un comportement inadapté qui a été appris par défaut. La prise en charge consiste donc à désapprendre ou substituer ce comportement. Il n’est pas nécessaire d’évoquer l’ensemble des courants pour illustre la multiplicité des conceptions de la souffrance. Par ailleurs, on peut en déduire que le psychothérapeute entend les symptômes du patient puis les resitue dans une dynamique explicative inhérente à son obédience. Il propose ensuite un mode d’intervention censé agir sur cette dynamique de façon à générer un changement d’état pour le patient. De ce fait cette compréhension de la douleur conditionne l’ensemble de la psychothérapie.
Le dernier pilier de l’alliance thérapeutique évoqué par Bordin est la question du lien entre le thérapeute et patient. Ce dernier élément agit comme la toile de fond des composants cités précédemment. Bordin nous indique qu’un patient est plus à même d’investir une relation sachant que celle-ci a vocation à durer dans le temps et que les occasions de rencontre sont fréquentes. Par ailleurs, pour espérer adresser des sujets complexes ou chargés émotionnellement, il est nécessaire que la relation soit forte, c’est-à-dire qu’elle soit empreinte de confiance et avec un attachement certain. Ce lien est également corrélé à la nature de l’intervention thérapeutique. Le modèle comportementaliste intervient directement dans la mise en place des solutions et par conséquent, instaure une relation différente d’une approche centrée sur la personne qui utilise un étayage par retour d’expérience personnelle. Cet exemple illustre une forme de polarité qui peut caractériser la nature du lien allant de la posture supportant (care-taker) à celle plus interventionniste d’une forme de coach (consultant).
Gaston (1990) nous propose une nouvelle définition de ce qu’est l’alliance thérapeutique. Elle se différentie des autres par la mise en lumière explicite du volet affectif de cette relation, et cela de façon réciproque « l’alliance thérapeutique, définie comme le lien affectif du patient au thérapeute », « la compréhension et l’engagement affectif du thérapeute pour le patient ». Cette dimension affective de la relation se concrétise par l’instauration de différents phénomènes tels que la confiance. Le rapport de confiance permet à l’individu de s’engager sans retenue dans la relation, ce qui renforce le lien affectif (Monié, 2018). De même que l’empathie contribue à la mise en place de l’alliance thérapeutique. Cette même empathie peut revêtir plusieurs formes. On parle d’empathie émotionnelle lorsque l’on est capable de ressentir les émotions de l’autre, sans se mettre à sa place. Mais il est également question d’empathie cognitive quand on est capable de comprendre le point de vue d’autrui (Blair, 2005). Cette empathie est génératrice d’affectivité dans la mesure où elle procure une sensation de réciprocité, de proximité et de similarité (Marc et Picard, 2020). Finalement, ce lien tel qu’évoqué par Bordin n’a pas tellement été abordé à travers le filtre des émotions. Peut-être que cela peut s’expliquer par le fait que les émotions deviennent un objet d’étude à part entière vraiment à partir de la 3e vague des TCC dans les années 1990 (Maurer et al, 2014). Dans le cadre des études sur la transe, les chercheurs se penchent sur la dimension émotionnelle en tant que facteur contribuant à l’alliance thérapeutique « C’est ainsi que les recherches (sur la transe) se sont orientées vers l’étude des liens thérapeutiques conceptualisés sous l’expression « d’alliance thérapeutique ». De la nature de cette alliance il nous faudra distinguer la part informative de la part affective. Un message thérapeutique ne saurait se borner à la simple énonciation. Il comporte, c’est évident, un contenu affectif, quoi qu’on fasse. Ainsi définie, cette alliance thérapeutique semble être, et pour cause, l’élément princeps, le dénominateur commun au centre de tout système thérapeutique. » (Collot, 2011). Cette division de l’alliance nous amène à la penser sous l’angle du contenu (le fond) et des affectes rattachés à chaque élément (la forme). Penser l’un sans l’autre serait passer à côté de la compréhension des besoins du patient.
Rapide historique
On attribue à Freud le fait d’avoir posé les bases de l’alliance thérapeutique. Dans son ouvrage « Etudes sur l’hystérie » (1895), il emploie l’expression « we make the patient into a collaborator ». Cependant, la généalogie du concept d’alliance thérapeutique pourrait nous faire remonter à l’avant Freud, au temps des hypnotiseurs. Le mesmérisme, appelé aussi le magnétisme animal, apparaît à la fin du XVIIIe siècle. Cette pratique évolue principalement dans la sphère de l’ésotérisme ou du divertissement. Bien que condamné par la faculté de médecine en 1784, la pratique continue d’intéresser des médecins (Braid, Liébeault) qui développent leur propre théorie autour de l’hypnose. Vers le milieu du XIXe siècle, leur théorie gagne le sol français et trouve un écho dans la personne de Charcot. En 1878, Charcot développe sa conception de l’hypnose en l’articulant avec l’hystérie. En 1885, Freud intègre l’hôpital de la Salpêtrière et suit les cours de Charcot. Ce dernier lui transmet, entre autres, le goût pour l’hypnose. L’hypnose nourrit les travaux de Freud dans la lignée de Charcot, c’est-à-dire en lien avec l’hystérie, ce qui lui permet de lancer la psychanalyse et de commencer à envisager la relation au patient comme une collaboration. Il appelle cette relation un « pacte analytique » dont Gaudriault et Joly (2013) résument ainsi la dynamique « Le pacte analytique reste donc jusqu’à la fin de la réflexion du fondateur de la psychanalyse un thème important, mais centré plutôt sur la compétence du patient que sur une attitude réciproque ».
En 1934, Sterba s’attache à élaborer cette dimension collaborative. Selon lui, le patient se scinde en deux objets, l’un rationnel, avec lequel le thérapeute peut s’associer pour le travail, et un autre, contenant la dimension pathologique de l’individu. C’est en collaborant avec la partie rationnelle, ou raisonnable du patient que le thérapeute peut intervenir sur le volet pathologique « Sterba focused on the patient’s capacity to form a nonpathological ego split which facilitates objective self-inquiry in a mutual endeavor between patient and analyst » (Friedman and Samber, 1994). Nous retrouvons les notions de collaborations et de travail en commun pour atteindre un objectif thérapeutique. Gaudriault et Joly (2013) voient, dans cette conception de la relation, un rapport asymétrique avec le psychanalyste en position de sachant et le patient dans le rôle du candide, créant davantage les conditions d’un rapport pédagogique que collaboratif.
Pour Roger, l’alliance thérapeutique est le fer de lance de la thérapie. Son approche centrée sur la personne est caractérisée par l’attitude que doit adopter le thérapeute lors des entretiens. Son intervention doit se caractériser par un regard positif inconditionnel, de l’empathie et la congruence. La relation est la toile de fond sur laquelle opère le changement « I am hypothesizing that significant positive personality change does not occur except in a relationship » (Roger, 1957).
Initialement, le courant psychanalytique est le point d’origine du concept. Son développement ne s’est pas fait sans diviser les psychanalystes (Bioy et al., 2012). Si l’alliance thérapeutique désigne la partie réelle de la relation, c’est alors que celle-ci ne doit pas faire l’objet d’interprétation comme l’indiquent Zetzel (1956) et Greenson (1967). Néanmoins, certains auteurs comme Brenner pensent que l’alliance thérapeutique relève du transfert, et par conséquent qu’il doit faire partie de l’analyse, « neither concept is justifiable. Both refer to aspects of the transference that neither deserve a special name nor require special treatment » (Brenner, 1979). Dans la même lignée, Curtis indique que considérer une partie de la relation comme ne devant pas être analysée représente un risque de passer à côté de l’analyse « It is suggested that, along with the gains achieved by making explicit the rational and irrational elements of the collaborative aspects of analysis, there is also the danger of a shift of focus away from the nuclear analytic concepts of unconscious intrapsychic conflict, free association, and interpretation of transference and resistance » (Curtis, 1979). Cette opposition se retrouve sur le plan géographique confrontant le vieux continent et le Nouveau Monde. La question de l’alliance thérapeutique anime davantage les réflexions du vieux continent ; la psychologie américaine ayant soit dilué ce concept dans d’autres existant, ou bien l’ayant tout simplement intégré dans de nouveaux courants de pensée, tels que les sciences cognitivo-comportementales. Cette intégration offre l’avantage de s’approprier une notion qui enrichit l’approche cognitivo-comportementale tout en s’affranchissant des fondements psychanalytiques (Bioy et al, 2012).
Le concept d’alliance continue sa course et traverse l’ensemble des courants de la psychologie. En 2000, Martin et al. lancent une méta-analyse visant à comparer la qualité de l’alliance thérapeutique et les résultats de différentes thérapies. Il en conclut, entre autres, que l’alliance thérapeutique n’est pas fonction du type des techniques d’intervention « In other words, if a proper alliance is established between a patient and therapist, the patient will experience the relationship as therapeutic, regardless of other psychological interventions » (Martin et al., 2000). L’alliance est donc un élément présent dans chaque thérapie, ce qui en fait un facteur commun à toutes, mais elle est également protéiforme et s’adapte aux influences de chaque modalité d’intervention.
Après avoir pris forme dans la psychanalyse, le concept d'alliance thérapeutique n'a eu de cesse que de susciter l'intérêt de la communauté scientifique. Celle-ci voit en elle, une variable intégrative et transcendante qui joue le rôle de modérateur, voire de médiateur du changement thérapeutique. De nos jours, les psychothérapeutes ne sauraient s'affranchir de cette dimension dans leur pratique.
Dynamique et caractéristiques de l'alliance thérapeutique
Au-delà de sa définition de l’alliance thérapeutique Bordin (1979) propose 4 notions phares définissant le cadre théorique de l’alliance thérapeutique. La première notion renvoie au fait que chaque psychothérapie intègre une alliance thérapeutique dont la forme dépend des modalités de la psychothérapie. Deuxièmement, chaque psychothérapie est tributaire de la qualité de l'alliance thérapeutique. Les résultats dépendent de cette alliance. Troisièmement, chaque psychothérapie détermine un rôle et un travail spécifiques pour le patient, et le thérapeute. Quatrièmement, la qualité de l'alliance thérapeutique est fonction de l'adéquation entre les besoins de l'alliance thérapeutique et les caractéristiques personnelles du patient et du thérapeute.
L'alliance thérapeutique peut-être vue, tantôt comme un facteur modérateur, tantôt médiateur. Dans l'expérience de Weck et al. (2015), l'objectif est d'identifier les facteurs responsables de l'échec de la psychothérapie. Les variables étudiées sont au nombre de 3 : l'alliance thérapeutique, l'adhérence à la thérapie et les compétences du thérapeute. Les résultats montrent que l'alliance est un modérateur significatif de l'adhérence à la psychothérapie. L’étude montre aussi un effet médiateur de l’alliance entre compétences du thérapeute et résultat de la psychothérapie. On peut en déduire que l’alliance thérapeutique n’a pas un effet homogène sur les facteurs de la psychothérapie, mais qu’elle influe parfois en tant que médiateur sur certains phénomènes et comme modérateur sur d’autres.
Dans la parution de Siev et al (2009) intitulée « The Dodo Bird, Treatment Technique, and Disseminating Empirically Supported Treatments », les auteurs cherchent à vérifier l’état de nos connaissances vis-à-vis de l’efficacité des psychothérapies et des facteurs responsables de leur efficacité. Les conclusions semblent confirmer le rôle médiateur de l’alliance thérapeutique « Overall, alliance may have the greatest relationship to outcome if the therapist makes it a central focus of treatment », « As others have noted (Beutler, 2002 ; Crits-Christoph et al., 2006), if one addresses alliance directly in treatment sessions, the very focus on alliance becomes a treatment technique ». Pour confirmer le rôle médiateur de l’alliance thérapeutique, Roten (2011), évoque la vision de Rogers quant à son impacte « Pour Rogers, les conditions relationnelles offertes par le thérapeute — en particulier empathie, congruence et regard positif inconditionnel — sont en et par elles-mêmes suffisantes pour soigner les clients ».
Si les avis ne sont pas encore tranchés sur la façon dont cette relation influe sur la réussite de la psychothérapie, il y a un consensus sur le fait que cette alliance soit nécessaire. Par conséquent, la question qui se pose est alors de sa voir comment disposer d’une bonne alliance thérapeutique. Initialement, dans la pratique freudienne, la qualité de l’alliance thérapeutique est de la responsabilité du patient. Cette alliance est envisagée sous la notion de transfert dont la projection se fait unilatéralement du patient vers le thérapeute. Cette projection peut être négative ou positive, mais elle constitue en soi les premières conceptions d’alliance (Gadeau, 2002). En 1977, Mitchell et al. redéfinit la responsabilité de chacun vis-à-vis de l’alliance thérapeutique et qu’il incombe autant au thérapeute qu’au patient d’y travailler.
En 1993, Henry et al. expérimente l’impact d’une formation aux techniques de développement de l’alliance thérapeutique sur le résultat des psychothérapies. Contre toute attente, les résultats montrent que pour une partie des patients, la relation thérapeutique s’est détériorée. Une partie du résultat s’explique par la modification du comportement du thérapeute jugé comme étant «  less approving and supportive, less optimistic, and
more authoritative and defensive. ». On peut en déduire que la qualité de la relation thérapeutique ne s’appréhende pas uniquement grâce à des connaissances. Quand bien même le thérapeute voudrait maîtriser de bout en bout cette alliance, les leviers à activer nous paraissent encore opaques.
C’est à partir de Bordin et Luborsky que l’on commence à considérer l’alliance thérapeutique comme un phénomène interactif. Dès lors, nous sortons des visions unilatérales de l’alliance comme envisagé par la psychanalyse, où le patient est l’unique responsable de la qualité de celle-ci. Roten (2011) résume l’idée ainsi « la responsabilité de créer et de maintenir une bonne alliance thérapeutique incombe au thérapeute, et non pas au client comme dans la perspective freudienne ». Avec le GRAAL, Yves de Roten explore l’alliance thérapeutique et en propose une dynamique qu’il explique en ces termes « ce n’est donc pas l’adaptation directe de ses interventions au niveau perçu de l’alliance, mais bien l’adéquation de ses interventions en fonction des caractéristiques dynamiques du client qui constitue un contexte favorable à l’établissement et le maintien d’une bonne alliance thérapeutique. Faire son travail d’analyste implique de se focaliser sur les conflits et les défenses du client, et dans ses interventions, de s’y ajuster ». Cette lecture incite à appréhender la relation de façon plus fine et dynamique. L’alliance thérapeutique n’a pas vocation à rester en surface afin d’agrémenter les entretiens. C’est surtout une attention particulière portée sur les dynamiques clés du rapport entre le patient et le thérapeute, c’est-à-dire, faire attention aux mouvements d’ouverture et de défense du patient tout le long du travail thérapeutique. C’est cette capacité à pouvoir adapter ses interventions à ces mouvements qui garantissent l’efficacité et la bonne qualité de la relation.
Loin d’être un phénomène clairement identifié, l’alliance thérapeutique se révèle sans pour autant qu’elle ne soit complètement cernée. Nous comprenons de mieux en mieux son influence sur le cours de la psychothérapie. Cependant, la manière dont celle-ci s’installe et les facteurs qui la contrôlent nous semblent encore obscurs. Voyons ce que nous savons actuellement des effets de l’alliance thérapeutique.
Les effets observés de l’alliance thérapeutique
Bordin nous remémore les éléments sur lesquelles il se base pour construire sa représentation des mécanismes de l’alliance thérapeutique. Les thèses doctorales de Ryan (1973) et Sarmat (1975) indiquent que l’alliance thérapeutique est corrélée au jugement de résultat de la psychothérapie. Horwitz (1974), dans une revue de lecture, avance qu’il n’y a pas de différence de résultat entre les différentes psychothérapies. Toujours selon Horwitz, l’alliance thérapeutique n’est pas qu’un prérequis. Elle est également un outil de changement. Dans son ouvrage « Therapist-patient expectancies in psychotherapy » de Goldstein (1962), l’auteur explique que le concept d’alliance thérapeutique permet davantage de se concentrer sur la notion de consensus entre le patient et le thérapeute que sur les attentes du patient à l’égard de la psychothérapie. Cette vision propose un cadre plus coopératif, octroyant une part plus importante au thérapeute dans la définition des objectifs. On peut supposer qu’il est plus facile d’atteindre des objectifs validés conjointement (le psychologue étant garant de la faisabilité des objectifs fixés) que de satisfaire des attentes que le patient mûrit seule, et donc sans autre avis pour pondérer ses ambitions. Cela veut dire que l’alliance thérapeutique aide à calibrer les attentes.
L’article de Strong (1968) nous amène un point de vue plus socio-cognitif dans l’élaboration de l’alliance thérapeutique. Il explore la thématique du changement d’opinion, partant du principe que « opinion-change research seem relevant to counseling since both areas emphasize communication and behavior change ». Pour Strong, il devient possible d’instiller le changement en se concentrant sur certains leviers : (a) les différences de point de vue, (b) la perception de l’expertise du thérapeute, (c) la perception de fiabilité du thérapeute, (d) la perception du caractère attractif du discours et (e) l’implication du patient dans la thérapie. Jusqu’a aujourd’hui, ses travaux constituent une référence pour les études visant à analyser l’impact de la crédibilité du thérapeute sur la qualité de la relation thérapeutique. Strong nous sensibilise aux effets des pensées que le patient peut avoir sur l’ensemble du dispositif thérapeutique. Jusqu’à cette date, aucune hypothèse de recherche ne semble intégrer cette dimension cognitive formalisée de la sorte.
Dans la même logique socio-cognitive, Orne et al. (1968) évoque un effet facilitateur de la psychoéducation1 dans la réussite de la psychothérapie « There is a strong positive relationship between a patient’s perception of psychotherapy and its ultimate success. Some patients who appear to lack motivation for treatment may be capable of profiting from psychotherapy if they are taught what to expect if they understand the “rules of the game.” ». L’effet dont parle Orne consiste à restructurer, voire structurer les cognitions propres aux attentes du patient afin de modifier son attitude envers la psychothérapie, et ainsi maximiser les chances de succès. Ce processus peut facilement s’entendre si on le conçoit comme un moyen de revoir à la baisse des attentes trop ambitieuses d’un patient.
Bordin (1979) pense également que la qualité de l’alliance thérapeutique est directement corrélée à la capacité de celle-ci à s’adapter aux besoins du patient, et plus particulièrement dans la forme que prend cette alliance. La capacité du patient à pouvoir s’engager dans une psychothérapie dépend de la compréhension qu’il peut avoir des objectifs. Si ces derniers lui semblent abstraits, alors le patient peut avoir plus de difficulté à se projeter dans leur réalisation. Selon Bordin, les populations modestes2 se sentent moins à l’aise avec une approche psychodynamique plutôt que comportementale dans la mesure où les axes de travail oscillent d’une vision conceptuelle pour l’une à un vison pragmatique pour l’autre. Cette variabilité des besoins de l’alliance thérapeutique doit également inciter le thérapeute à adapter la réparation des tâches en fonction des ressources du patient « The take-charge element in the therapist's part of the task arrangements may be a vital factor in the extremely frightened patient's entering into a particular therapeutic collaboration ». Par ailleurs, l’exercice d’allocation des tâches entre patient et thérapeute peut raviver des patterns réactionnels chez le patient en lien avec le sentiment de dépendance. Les personnes dépendantes peuvent se sentir plus à l’aise dans une thérapie directive ou interventionniste à l’image des thérapies comportementales. A contrario, les personnalités « contre-dépendantes »3 peuvent davantage apprécier les thérapies non directives comme l’approche centrée sur la personne. Bordin pense que, malgré l’apparente différence entre ces deux profiles patient, l’alliance thérapeutique reste nécessaire, mais selon une temporalité propre à chacun « I am convinced that the bonding aspects will be particularly important from the very beginning for the overtly dependent person but, while possibly interfering at first, will be necessary at later stages for the counter-dependent as well ».
Selon les travaux d’Horwitz (1974), la qualité de l’alliance thérapeutique est influencée par la capacité du patient à concevoir le thérapeute comme un « bon objet ». Ces résultats ne sont pas sans rappeler les travaux de Strong énoncés plus haut, quant à la capacité du patient à juger de la qualité et de la fiabilité du thérapeute.
L’intervention du psychothérapeute est guidée par son obédience. Cette intervention conditionne la forme de l’alliance thérapeutique. Cette alliance est façonnée par les caractéristiques inhérentes au patient au thérapeute et aux besoins de l’alliance elle-même. Selon Bordin, la qualité de la relation est plus à penser en termes d’adéquation de la réponse du thérapeute aux besoins du patient qu’en affinité de personnalités. Dit autrement, la capacité du cadre thérapeutique à s’adapter aux besoins du patient prime sur la question des affinités.
Les travaux du groupe de recherche de l’alliance aidante de Lausanne (GRAAL) dirigé par Roten nous montrent que les patients pour lesquels l’alliance thérapeutique évolue positivement dès les premiers entretiens sont ceux pour lesquels les résultats sont les meilleurs. Par ailleurs, Roten évoque une discussion avec Erickson ou celui-ci partage une intervention tout du moins particulière vis-à-vis de sa patiente. Celle-ci consulte Erickson pour perdre du poids grâce à l’hypnose. Il se met alors à décliner les différents éléments apparents de la patiente qui contribue à « ne pas la rendre séduisante ». Cette sincérité semble avoir renforcé l’alliance et a permis de continuer sa prise en charge. L’intention d’Erickson est, semble-t-il, d’afficher une attitude sincère à l’égard du patient, lui permettant de se projeter avec confiance dans la relation avec le thérapeute. Si cette vignette ne peut se généraliser à l’ensemble des thérapies, elle n’est pas sans rappeler l’approche de Ferenczi à l’égard ce qu’il nomme l’« hypocrisie professionnelle ». Cette question de la confiance à l’égard du thérapeute renvoie au sujet de la crédibilité évoquée par Strong (1968). Par ailleurs, ce passage de Bokanowski résume bien l’idée générale de Ferenczi « La confiance du patient dans l’analyste fait que ce dernier doit être ressenti comme « fiable » et non empreint d’ « hypocrisie professionnelle », cela impliquant une relation personnelle, authentique et privilégiée entre le patient et son analyste. La fiabilité de l’analyste, exigible en toutes circonstances, sa « bienveillance inébranlable » envers son patient, quelles que soient les extrémités auxquelles celui-ci se laisse aller dans ses mots, comme dans ses agirs, (…), faite de tolérance quasi illimitée (principe de permissivité) qui est un « encouragement pratiqué par l’analyste à sentir et penser jusqu’au bout des événements psychiques traumatiques marquants » (Bokanowski, 2006)
Pour conclure sur les effets perçus ou prouvés de l’alliance thérapeutique, Luborsky disait « The most potent explanatory factor is that the different forms of psychotherapy have major common elements—a helping relationship with a therapist is present in all of them, along with the other related, nonspecific effects such as suggestion and abreaction ». De nos jours, l’ensemble de la communauté scientifique s’accorde à dire que l’alliance thérapeutique est le facteur qui offre la variance la plus élevée vis-à-vis des résultats de la thérapie (Bioy et Bachelart, 2010). Le constat est partagé par plusieurs chercheurs (Horvath et Bedi, 2002 ; Martin et al., 2000). Après avoir vu les effets perçus de l’alliance thérapeutique, penchons-nous sur les différentes composantes de l’alliance thérapeutique.
Rapide tour d’horizon des dernières recherches sur l’alliance thérapeutique
L’alliance thérapeutique en visioconférence :
Avec l’avènement des technologies des communications, de nouveaux modes d’interactions apparaissent. La visioconférence fait son entrée dans le monde du travail, mais également dans celui dans la santé. Norwood et al. (2018) font une revue de lecture pour vérifier si l’alliance thérapeutique est moindre en visioconférence. Le résultat démontre une qualité inférieure de l’alliance thérapeutique, mais pas de dégradation concernant la réduction des symptômes.
Les pleurs en thérapie
Une étude de 2021 (Genova et al.) analyse l’effet des pleurs en psychothérapie et l’impact sur le style d’attachement du patient. Les résultats semblent montrer que pour le patient ayant un style d’attachement « dismissing », la survenue de pleurs était prédictive d’une réduction des affects négatifs et du succès de la thérapie.
Étude de cas de Drop-out
Cette étude de cas de Dolezal et al. (2019) étudie la dynamique de rupture d’une patiente spécifique. Cette revue explique les différents temps forts de l’alliance et ce qui caractérise son alliance. Celle-ci semble évoluer favorablement lorsque la patiente et le thérapeute amorcent la phase de « problem solving ». L’effort demandé pendant cette étape semble consommer les ressources de la patiente, conduisant la relation vers une succession de rupture et terminant par l’abandon de la psychothérapie.
Un algorithme prédictif de la qualité de l’alliance thérapeutique
En 2022, un groupe de chercheur (Ying et al.) a mis au point un algorithme dont le but est de prédire la qualité de l’alliance thérapeutique sur la base d’éléments collectés dès le premier entretien. En plus de prédire la nature de leur relation, l’outil peut proposer une modélisation du patient afin d’aider le psychothérapeute dans sa prise de décision.
Ce détour autour de quelques expériences plus récentes n’a pas vocation à être exhaustif. Nous souhaitons apporter une vision des recherches actuelles en lien avec l’alliance thérapeutique afin d’élargir nos considérations vis-à-vis du sujet. Dans le domaine de la recherche, les réponses sont rarement définitives, et par conséquent il est toujours possible d’approfondir les thématiques initiales. En revanche, la recherche tient compte des enjeux, des avancées et des contraintes de son époque pour orienter ses travaux. À l’heure du digital, cela fait du sens que la recherche se penche sur ces technologies, leurs impacts sur la pratique et les nouvelles opportunités qu’elle offre. Cependant, on constate que certains phénomènes nous semblent bien opaques comme les causes du Drop-out. La recherche est probablement vouée à garder un pied dans le passé pour résoudre les problèmes princeps, et l’autre dans le présent pour évoluer au rythme de nos sociétés.
L’attribution causale
Définition du concept d’attribution causale et du style explicatif
Selon Moscovici (1972), le mécanisme d’attribution « …consiste à émettre un jugement, à inférer “quelque chose”, une intuition, une qualité, un sentiment sur son état ou sur l’état d’un autre individu à partir d’un objet, d’une disposition spatiale, d’un geste, d’une humeur ». L’attribution causale est un processus d’inférence visant à déterminer les motivations d’autrui (hétéro-attribution) ou de soi-même (auto-attribution) (Delouvée, 2018).
Weiner (1979) décrit le phénomène d’attribution causale selon 3 dimensions. La première est le locus de causalité. Le sujet détermine si les causes du phénomène lui sont attribuables ou si elles lui sont extérieures. La seconde dimension est temporelle et définit la stabilité du phénomène. Celui-ci peut être jugé comme étant éphémère ou bien permanent. La dernière dimension est la contrôlabilité. Le patient estime l’emprise qu’il a sur le phénomène. Selon Weiner, ces 3 critères (Locus de causalité, stabilité, contrôlabilité) deviennent les dimensions caractéristiques de l’attribution causale, évaluables, et qui permettent de rendre compte d’un évènement, au-delà du perceptible.
Kelley (1973) modélise également le mécanisme d’attribution causale, mais selon une autre grille de lecture. Le premier principe sur lequel il se base est celui de la « covariance » des facteurs qui peut se résumer ainsi : le sujet identifie les causes d’un phénomène en se basant sur leurs présences ou absences réciproques. Plus le sujet observe cette proximité, et plus il en déduit un rapport de causalité. L’effet de covariance dans l’attribution causale est démontré à travers plusieurs expériences (Kelley et Stahelski, 1970 ; Vallins, 1966). Le second principe de son modèle indique que le locus de causalité d’un phénomène peut être positionné dans l’une des 3 classes suivantes : personnes, objets et temporalité. La causalité orientée personne signifie que l’individu concerné est responsable, par sa singularité, de l’effet observé (ex : tu aimes cette peinture par ce que tu es peintre). On peut parler d’auto-attribution lorsque la personne qui juge est face au phénomène observé. Quand la cause est portée au crédit de l’objet, cela signifie que l’individu reconnaît que ce sont les caractéristiques de l’objet qui sont la cause du phénomène (ex : tu aimes cette peinture par ce qu’elle est travaillée). Le cas échéant, on parle d’hétéro-attribution quand celui qui juge est le sujet du phénomène. Lorsque le sujet attribue la cause de l’effet à la temporalité, il identifie les facteurs situationnels comme étant responsables (ex : tu aimes la peinture par ce que ton père était peintre). En dépit de la catégorisation du locus de causalité, Kelley cherche à comprendre les processus qui conduisent à cette attribution. Il conceptualise un plan tridimensionnel dont les pôles sont : le consensus, la distinctivité et la consistance. Ces dimensions s’évaluent sur un continuum allant de spécifique à généralisable. Le consensuel est une mesure de la quantité de consensus qui existe autour d'un comportement particulier. Plus le consensuel est élevé, plus la personne sera susceptible d'attribuer un attribut interne à un comportement. La distinctivité est une mesure de la quantité de variation dans le comportement d'une personne. Plus le comportement est spécifique à une situation donnée, plus la personne sera susceptible d'attribuer un attribut externe à ce comportement. La consistance est une mesure de la quantité de cohérence dans le comportement d'une personne. Plus le comportement est cohérent, plus la personne sera susceptible d'attribuer un attribut interne à ce comportement (Delouvée, 2018).
Nous sommes en ligne avec la façon dont Kelley place les théories de l’attribution comme un phénomène transversal applicable à d’autres branches de la psychologie « But it will also be clear that attribution theory is relevant to other fields of psychology, particularly those in which self-concepts are regarded as important. And as a general conception of the way people think about and analyze cause-effect data, attribution theory might have emerged from any of the classical fields of psychology concerned with perception, judgment, and thinking. »
Le Foll et al. (2006) propose une définition de l’attribution causale qui met en lumière l’intérêt de ce mécanisme « (…) l’attribution causale est définie comme une inférence particulière par laquelle l’individu explique les situations (ou comportements) qu’il perçoit (ou exécute) afin de mieux contrôler et prédire de futurs événements similaires ». Cette définition nous invite à penser la dimension pragmatique du sujet qui, à travers cet exercice de projection de sens, tente d’appréhender son environnement de façon à pouvoir adopter un comportement adéquat. Les théories cherchant à expliquer les besoins princeps derrière cette recherche de sens sont multiples et beaucoup de théories proposent des modèles explicatifs (Freud, Maslow, Azjen, Skinner). Nous pensons que dans le cadre de ce mémoire, il n’est pas nécessaire d’aborder ce pan-là, qui néanmoins peut venir enrichir la réflexion dans un second temps.
Pour ce qui est du style explicatif, cette notion est conceptualisée par Seligman (1984). Peterson et Ulrey (1994) nous offre une définition synthétique qui le résume ainsi « Explanatory style is a cognitive personality variable reflecting the way people habitually explain bad events involving themselves ». Il s’agit donc d’un comportement de pensée qui amène l’individu concerné à inférer les causes d’un évènement, particulièrement lorsque celui-ci est jugé comme négatif et incontrôlable. Seligman (1991) distingue 2 modalités du style explicatif : le style optimiste et le style pessimiste. Chacun agit comme un filtre de perception, conditionnant la réaction comportementale du sujet (Trottier et al, 2007). Le style explicatif se mesure selon 3 critères sensiblement proches de ceux de Weiner ou Kelley. On retrouve le locus de causalité, la stabilité et le dernier critère qu’il nomme « globalité ». Si les deux dimensions précédentes ont déjà été décrites précédemment, la « globalité » désigne l’ampleur du phénomène, c’est-à-dire, sa capacité à influencer plusieurs aspects de la situation.
On peut constater que la question de l’attribution causale bénéficie d’une littérature riche et répartie sur près d’un demi-siècle. Si certains modèles peuvent interpeller par leur complexité ou encore leur façon de mesurer certaines dimensions, il n’en reste pas moins que certaines notions font consensus. Le locus de causalité est la dimension que l’on retrouve dans chaque modèle présenté. Par ailleurs, c’est la première dimension issue de travaux de Heider. La lignée historique du concept d’attribution causale trouve ses ramifications dans plusieurs théories que nous allons essayer de présenter de façon aussi synthétique que possible.
Les origines de l’attribution causale
Le situationnisme
Il s’agit d’un courant de pensée scientifique dont l’idée initiale réside dans le fait que le contexte situationnel joue un rôle dans les mécanismes d’influence du comportement. Delouvée (2018) place les fondations de la théorie attributionnelle à l’époque de Lewin en 1951. Les expériences les plus emblématiques de ce courant sont la soumission à l’autorité de Milgram (1963) et la prison de Stanford. Ces expériences ont vocation à révéler l’impact situationnel sur le mécanisme de prise de décision ou comportementale. Si l’expérience de Milgram a pu être reproduite et se montrer relativement consistante à travers le monde, celle de Zimbardo s’est fait lourdement critiquer au point de la reléguer au rang de mythologie de la psychologie (Dieguez, 2018).
La psychologie de sens commun ou « intuitive psychology »
Ross s’inscrit dans la tradition des chercheurs des théories attributionnelles. En 1977, il publie sa théorie de l’« intuitive psychology ». Selon sa théorie, il considère que l’homme raisonne sur la base d’hypothèses implicites sur le mode de fonctionnement du monde qui l’entoure et lui-même. Pour vérifier ses hypothèses, il se base sur des données telles que ses expériences passées ou bien des informations médiatisées à travers différentes interactions. Il traite ces données à la manière pseudo-scientifique pour obtenir des règles, formules ou schémas de penser lui permettant de réaliser des inférences. La capacité du sujet à faire des prévisions correctes dépend de la qualité de ses hypothèses. Ce mode de fonctionnement est particulièrement en proie aux biais et aux interprétations erronées dans la mesure où les actions du quotidien ne bénéficient ne permettent pas de bénéficier d’un cadre aussi rigoureux qu’en recherche scientifique. Lee Ross propose ainsi une explication pour les biais cognitifs et les erreurs de perception que nous faisons. Elle est basée sur l'idée que nous utilisons des raccourcis cognitifs et des préjugés pour interpréter le monde qui nous entoure, ce qui crée des biais dans notre jugement et nos décisions. Cette théorie s'applique aux domaines de la psychologie clinique, sociale et de la recherche en psychologie. Elle fournit un cadre pour comprendre comment les biais cognitifs et les préjugés peuvent influencer nos perceptions, nos pensées et nos comportements, ainsi que les interactions humaines.
La théorie de l’équilibre cognitif
« Les amis de mes amis sont mes amis » est une maxime qui résume assez simplement l’idée centrale de la théorie de l’équilibre d’Heider (1946). Selon lui, le sujet appréhende chaque item cognitif à travers une configuration cognitive. Chaque élément dispose d’une valeur positive ou négative. Les éléments de part et d’autre d’une relation doivent avoir la même valeur. En cas d’anomalies, c’est-à-dire quand une cognition positive est reliée à une cognition négative, le sujet va chercher à retrouver un état d’équilibre en modifiant la valeur d’une des deux cognitions. Cette modification peut se faire au niveau de l’attribution causale. En modifiant la perception de la cause d’un phénomène, on peut lui donner une valeur positive ou bien négative. Au-delà de cette correction, cette configuration cognitive permet d’inférer des relations entre les objets pour lesquels nous n’avons pas pu observer la qualité de la relation. « Ce type d’association d’idées « ils aiment la même chose donc ils sont faits pour s’entendre » nous permet, d’une part, d’expliquer des événements passés et, d’autre part, de prédire les événements futurs » (Delouvée, 2018). Cette théorie permet aux chercheurs et aux praticiens de mieux comprendre l'influence des dynamiques sociales sur les individus, ce qui peut servir à améliorer la qualité des relations interpersonnelles.
La résignation apprise
Seligman, dans son ouvrage « Helplessness : on depression, development, and death » (1975), explore les causes de la dépression et des troubles anxieux. Le livre examine comment le développement psychologique et psychosocial joue un rôle important dans la manière dont nous nous sentons et réagissons à l'adversité, notamment en ce qui concerne nos sentiments de désespoir et d'impuissance. Il nomme ce sentiment « helplessness » ou impuissance apprise. Ce phénomène est d’abord mis en lumière dans une expérience (1967) avec des chiens, pour ensuite être dupliqué avec plusieurs espèces d’animaux. Le protocole consiste à placer un animal dans un espace clos. Ceux-ci sont entraînés pour réagir au stimulus de façon à y mettre un terme. Le stimulus en question est une décharge électrique. Deux conditions sont mises en place : une condition avec un mécanisme d’arrêt opérant, et une seconde avec un mécanisme d’arrêt inactif. Les résultats de l’expérience montrent que dans la condition du mécanisme inactif, lors des décharges électriques, l’animal ne tente plus de l’activer. Il est pour ainsi dire, résigné. Seligman conclut son expérience en indiquant « Learned helplessness might well result from receiving aversive stimuli in a situation in which all instrumental responses or attempts to respond occur in the presence of the aversive stimuli and are of no avail in eliminating or reducing the severity of the trauma » (Overmier et Seligman, 1967). C’est en 1975 qu’Hiroto et Seligman transposent l’expérience aux humains, dans un cadre plus adapté. Les conclusions sont cohérentes avec les résultats obtenus dans les expériences avec les animaux. Par ailleurs, ils constatent que cet état d’impuissance apprise impacte négativement les sphères motivationnelles, cognitives et émotionnelles du sujet.
Les travaux sur la soumission apprise nous permettent d’appréhender le comportement humain et son rationnel à travers la façon dont le sujet interprète la situation. Nous pouvons aisément entrevoir les conséquences négatives d’un tel apprentissage dans une démarche thérapeutique, voire même dans le développement de pathologies anxio-dépressives.
L’Attribution interne ou externe
Les premières conceptions de l’attribution causale telles que la psychologie contemporaine s’en est emparée se développent auprès d’Heider. En 1944, il publie un article nommé « Social perception and phenomenal causality » dans lequel il pose les bases de l’auto-attribution, l’hétéro-attribution ou l’attribution circonstancielle « When we have a disagreeable experience, or a pleasant one, we may locate its origin in another person, in ourselves, or in fate ». Il construit son hypothèse sur la base d’une étude parue la même année, menée avec Simmel. L’étude consiste à montrer un film d’animation mettant en scène des formes géométriques évoluant selon des mouvements spécifiques. Il est demandé aux observateurs d’interpréter ce qu’ils observent. L’expérience prévoit 3 modalités : (1) les sujets disposent d’une simple directive, (2) même directive, mais en demandant d’interpréter les mouvements comme si elles étaient des actions humaines, (3) même condition que la modalité n°2 sauf que le film est passé à l’envers. Les résultats montrent que dans les conditions n°2 et 3, les sujets ont inféré une cause au mouvement. Heider et Simmel en concluent que lorsqu’un individu juge un phénomène il se base, en partie, sur ce qu’il pense savoir des origines du phénomène.
On peut transposer ce concept dans le champ clinique pour explorer les mécanismes de perception de la pathologie, de la thérapie ou bien de la relation avec son thérapeute. La modification des croyances sur l’origine du phénomène pourrait être un levier pour modifier la perception du sujet et son jugement.
La théorie de l’auto-perception
Bem (1966) nous propose une théorie de l’auto-perception qui se veut complémentaire à la théorie de la dissonance cognitive de Festinger. La théorie de Festinger et celle d’Heider peuvent être comparées aux deux faces d’une même pièce : Heider explore la motivation du sujet sur le plan de la recherche de l’équilibre, là où Festinger étudie plus spécifiquement les relations incohérentes. Selon Bem (1972), un sujet n’a pas accès aux processus cognitifs sous-jacents aux comportements complexes. Pour interpréter des perceptions ambiguës, le sujet s’appuie sur des stimuli externes porteurs de sens. Lorsque les stimuli intérieurs sont trop ambigus pour être interprétés, alors le sujet se trouve dans la même situation qu’un observateur extérieur.
La théorie de l'auto perception de Bem peut s'appliquer à l'alliance thérapeutique en ce sens que les clients qui sont en mesure de percevoir leur engagement personnel et leur investissement dans le changement sont plus susceptibles de maintenir et d'accroître leur niveau d'investissement dans le processus thérapeutique. Par conséquent, en encourageant les clients à observer et à percevoir leurs progrès et leur investissement, le thérapeute peut aider à renforcer l'alliance thérapeutique et à soutenir le changement.
Les répercussions de l’attribution causale et du style explicatif
L’estime de soi
Les théories de l’attribution se basent sur les premiers travaux de Heider pour ensuite explorer des axes qui leur sont propres. Néanmoins elles ont en commun ce facteur de locus de causalité. Selon Weiner (1986), un mode d’attribution interne d’un évènement positif augmenterait le sentiment d’estime de soi. Dans une revue de lectures de 1983, Stipek explore le développement du sentiment de fierté et de honte chez les jeunes enfants. Elle arrive à la conclusion que la honte se produit lorsque l’enfant s’attribue la cause d’un évènement négatif. Elle indique également que « preschoole-aged children’s tendency to overestimate their responsibility for events may cause them to feel pride or shame for outcomes for which they were not really responsible ».
L'estime de soi peut apparaître comme un facteur que le patient souhaite stabiliser à un certain niveau, et cela même dans les situations thérapeutiques. Safran et al. (1990) nous explique comment les patients peuvent être amenés à agir et verbaliser certains propos de manière et maintenir une image d’eux-mêmes confiante et assumée « Other examples of self-esteem-enhancing operations include clients' attempts to boost their self-esteem by presenting positive images of themselves to their therapist ». Les auteurs émettent ainsi l’hypothèse que l’estime de soi est un facteur modérateur de la relation thérapeutique, et que lorsque cette estime se dégrade, elle augmente le niveau d’anxiété du patient. Par ailleurs, l’estime de soi est un facteur visé de façon plus ou moins intense par différentes pathologies et souvent responsable d’une détresse morale (O’brien et al., 2006).
La dépression
Nous avons vu précédemment, avec Seligman (1991) que le style attributionnel est une version évoluée de son premier concept de résignation apprise. Rappelons que le style explicatif est le comportement cognitif habituel avec lequel le sujet détermine la genèse des phénomènes et qu’il peut, soit tendre vers l’optimise, soit vers le pessimisme. Le style explicatif d’orientation pessimiste est étudié par plusieurs chercheurs. Dans l’ouvrage « The explanatory style » (1995) , Robin et Hayes expliquent que les sujets ayant tendance à faire des attributions internes et stables développent plus de dépression que les individus aux patterns explicatifs plus nuancés. En 1982, Raps et al. réalisent une étude visant à démontrer le lien entre style explicatif et la dépression. Les résultats montrent que « (…) in a sample of depressed unipolar patients, the association between attributional style and depressive symptoms predicted by the learned helplessness reformulation. Depressive patients made much more internal, stable, and global attributions for bad events (…) »
Étant convaincu des répercussions du style explicatif sur l’état global des individus, en 1995, Seligman et al. développe le programme « POP » (Penn Optimism Program) dont l’objectif est de développer l’optimisme chez les enfants ayant des prédispositions à la dépression (Trottier, 2007). Aujourd’hui, ce programme porte le nom de « Penn Resilience Program » et continue d’être dispensé par l’université de Pennsylvanie.
Les émotions
Dans une parution de 1980, Weiner explique la manière avec laquelle les attributions causales sont corrélées aux émotions. Il identifie 3 zones d’influences. Premièrement, l’attribution causale influe sur notre propre perception et celle des autres. La valence positive ou négative de la cause d’un phénomène va influencer la valence du dit-phénomène observé. Deuxièmement, les émotions sont des motivations du comportement « This suggests that there is a sequential organization between the tripartate division within psychology of thought, feeling, and action - we feel the way we think and act on the basis of these feelings ». Le dernier champ d’observation de l’expérience semble révéler que les émotions peuvent être utilisées comme des indices pour comprendre notre environnement et plus particulièrement l’état interne d’autrui à l’instar de l’empathie. D’après Weiner, cela prend particulièrement du sens lorsque les raisons d’un échec ou d’une réussite ne peuvent pas être publiquement partagées pour différentes raisons (conflit d’intérêts, honte, convention sociale, etc.).
En conséquence, nous comprenons que l’attribution causale peut être un levier qui intervient sur le volet cognitif d’un sujet aussi bien sur la genèse du sens que des émotions en lien avec le phénomène observé. Nous entendons également que par le biais de l’émotion, l’attribution causale peut-être génératrice de motivation et de comportements. Les différents champs impactés par les processus d’attributions, tels que le sens, les émotions et l’empathie.
Phobie sociale
Les études des théories de l’attribution explorent également le champ des biais. Le biais d’auto-complaisance « self-serving bias » est une tendance à attribuer une causalité interne à nos succès et une causalité externe à nos échecs. La paternité du concept est accordée à Heider (Miler et al., 1975). En 1987, Zelen propose une inversion du biais d’autocomplaisance qu’elle nomme la « névrose de performance » et qu’elle remarque chez les sujets souffrant d’anxiété sociale. Par ailleurs, il semble que les sujets souffrant d’anxiété sociale tendent à avoir des ruminations anxieuses sur eux-mêmes (Sarason, 1975). Cette focalisation sur soi pousse le sujet à faire des attributions internes lorsqu’il est confronté à des évènements négatifs (Fenigstein, 1984). Cependant, cet effet n’a pas pu être démontré lors de l’expérience d’Ellis et Holmes (1982). Pour Hope et al. (1989), la focalisation sur soi tend à faire des attributions internes. Quand cette focalisation prend la forme d’une rumination anxieuse, le sujet bascule dans un cercle vicieux dans lequel il endosse la responsabilité des évènements négatifs. Cette sur-responsabilisation vis-à-vis des échecs contribue alors à alimenter les craintes propres à l’anxiété sociale : l’échec, la déception et le jugement des autres.
Le processus attributionnel pourrait être utilisé pour lutter contre l'anxiété sociale en aidant les personnes anxieuses à identifier les causes de leurs maux et à prendre des mesures pour les surmonter. Le but est d'inciter la personne à se concentrer sur des causes internes (par exemple, un manque de confiance en soi ou des comportements anxieux) plutôt que des causes externes (par exemple, le regard des autres sur eux). Cette approche peut aider les personnes anxieuses à réduire leur niveau d'anxiété et à construire leur confiance en eux.
Conclusion (empty)
PROTOCOLE EXPÉRIMENTAL
Objectifs de la recherche
Aux vues de la bibliographie, nous pensons que l’alliance thérapeutique constitue le fer de lance de la thérapie, et cela, peu importe le type de pris en charge, quelle soit médicale, psychologique ou autres. Nous pensons que tous les axes de travaux qui peuvent renforcer la qualité de l’alliance doivent être partagés auprès de l’ensemble du personnel soignant afin de maximiser les chances de rétablissement des patients d’une part, et d’autre part, que le patient puisse s’engager en pleine confiance dans sa relation thérapeutique. Cette recherche s’inscrit dans cette ambition en voulant tester la corrélation entre le style explicatif du patient et sa perception de la qualité de la relation. Nous espérons découvrir un lien entre ces deux facteurs et ainsi encourager la recherche à explorer différentes manières d’intervenir de façon pragmatique au profit de l’alliance thérapeutique et de ses protagonistes.
Hypothèses
L’hypothèse théorique principale est que le style explicatif du patient et la qualité de l’alliance thérapeutique sont corrélés. À ce stade, nous n’avons pas la prétention de vérifier si l’un des deux facteurs est la cause de l’autre. Opérationnellement nous souhaitons comparer les scores de mesure de l’alliance thérapeutique avec les scores obtenus sur l’évaluation des dimensions de l’évaluation causale.
Pour vérifier mathématiquement cette hypothèse, nous calculons le r de Pearson afin d’identifier une corrélation entre ses variables, et corrélation il y a, alors mesurer également la force de cette relation. 
Si :
WAI=score de l′alliance thérapeutique
ATT=score de l′attribution causale
Alors,
rWAI−ATT≥0.4 ; p<0.5
L’hypothèse théorique secondaire est que la dimension de locus de causalité soit plus prédictive d’une influence sur l’alliance thérapeutique que les autres dimensions évaluées
Si :
ATT – int/ext = score de la dimension « Locus de causalité – interne/externe »
Alors,
rWAI−ATT−int/ext≥0.4 ; p<0.5
Méthodes
Échantillon
Recherche quantitative