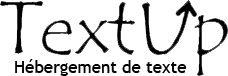Fondateur sur le tard de la Fabrique, maison où étaient publiés les principaux penseurs d’extrême gauche allant du marxisme à l’anarchisme, et notamment le Comité invisible, l’éditeur controversé, mort ce jeudi 6 juin à 88 ans, était aussi un arpenteur érudit de Paris, sur lequel il avait écrit de nombreux livres.
Eric Hazan, à Gargas (Vaucluse), en avril 2018. (Olivier Metzger/Libération)
par Quentin Girard
Eric Hazan est mort. L’a-t-il joué Balzac ? A arpenter jusqu’au bout les rues de Paris, pour entendre leur tumulte ? Stendhal ? «Puisque la mort est inévitable, oublions-la.» Ou alors, en bon amoureux du Comité invisible, il a choisi de semer le doute, de ne rien dire jusqu’au bout, pour être toujours là, même dans la disparition. Avec le décès de l’éditeur de 88 ans, fondateur de la maison la Fabrique et ancien chirurgien, l’extrême gauche perd l’un de ses plus importants et controversés passeurs d’idées de ces deux dernières décennies et la capitale française l’un de ses plus fervents défenseurs.
Alain Badiou, Antonin Bernanos, Judith Butler, Julien Coupat, David Dufresne, Eric Fassin, Raphaël Kempf, Frédéric Lordon, Andreas Malm, Nathalie Quintane, Jacques Rancière, Edward Saïd, André Shiffrin, Françoise Vergès, Sophie Wahnich, Slavoj Žižek ou encore les polémiques Norman Finkeltsein et Houria Bouteldja… Eric Hazan, tout puissant en sa maison d’édition, où il ne publiait «que des amis», a publié la plupart des principaux penseurs et activistes de la gauche hors les murs française et aussi internationale. Sur les sujets les plus polémiques : d’Israël et la Palestine aux violences policières, en passant par le décolonialisme, le féminisme, la place du livre, la politique en général, etc.
Ultrareconnaissable, avec ses livres aux titres en police Rockwell sur fonds unis colorés, la Fabrique s’est imposée dans les rayons en mettant aussi en avant des textes de révolutionnaires historiques, comme Robespierre, Lénine ou Blanqui. Avec des titres qui sentaient bon la poudre sur une barricade de la rue Saint-Antoine : Pour le bonheur ou la liberté ; Maintenant, il faut des armes.
Les écrits de son fondateur sont également en bonne place dans le catalogue. Eric Hazan n’avait jamais rien publié avant ses 66 ans, et la Chronique de la guerre civile, en 2004. Il ne s’est plus arrêté ensuite avec quatorze ouvrages (dont certains collectifs). Le dernier, le Tumulte de Paris, publié en 2021, faisait suite au très salué l’Invention de Paris et défendait, dans une balade érudite (et un peu datée), la vivacité de la ville, des insurrections du XIXe siècle aux vieux juifs de Belleville. Il écrivait ainsi, espérant la chute du capitalisme et le retour des exclus dans le centre-ville : «Il faut garder une main sur la ville, en connaître l’histoire et les détours, pour que le moment venu elle puisse reprendre ses couleurs et sa gloire.»
Accusations d’antisémitisme
Dans ses ouvrages, l’éditeur alternait entre ses principales préoccupations : la révolution et son désir de mettre à bas le système (système qui devait s’effondrer prochainement à chacune de ses interviews aussi loin qu’on soit remonté), son rapport amoureux à la capitale, à la littérature et aux livres, et le questionnement de son identité juive en lien avec celui de l’existence d’Israël et de la Palestine. Ses passions lui donnaient une personnalité multiple, parfois insaisissable. Avec sa bouille d’enfant un peu crapule, il n’aimait rien tant qu’emporter les interrogations sur ses potentielles contradictions par un sourire enjôleur. Hazan avait la révolution charmante, en chef de bande volontiers moqueur des autres bandes, amusé de la comédie humaine, pas dupe des autres, et, on l’espère, de lui-même. «On trouve une grande variété d’opinions et de positions politiques dans la Fabrique», se réjouissait-il dans Pour aboutir à un livre, du «marxisme traditionnel» aux «tendances anarchistes». Lui-même se considérait «depuis longtemps sans iste, plutôt benjaminien peut-être».
Outre ses femmes et ses enfants, nombreux, l’homme a eu plusieurs vies. Il est né à Paris en 1936, dans une famille «juive, bourgeoise et intégrée». Le père est d’origine égyptienne, éditeur d’art qui a aussi fondé une fabrique de sucreries au miel de Guinée. La mère, d’origine roumaine née en Palestine, travaille avec lui. Pendant la guerre, ils se réfugient en zone libre, puis à Antibes, contrôlé par les Italiens. «Avec la guerre, j’ai eu une enfance plutôt agréable, racontait-il à Libé en 2018. J’allais pas à l’école, j’ai jamais manqué de rien. J’étais caché, oui. Mais pour un gamin, c’était rigolo. Je jouais aux gendarmes et aux voleurs. Mes parents n’ont pas été mal cette fois-là. Je n’ai pas le souvenir d’avoir eu peur.»
A son retour à Paris, il passe dans des lycées prestigieux, et lit beaucoup, notamment l’auteur de la Chartreuse de Parme. «Je suis resté stendahlien. C’est un mauvais Français : il n’aime pas la France, il n’aime pas Paris, il trouve que les gens sont arrogants et au fond si coincés qu’ils n’arrivent pas à libérer leur cœur. Il est vraiment sympathique, le gars.»
Pour faire plaisir à son père, il fait médecine et devient chirurgien, spécialisé dans la chirurgie infantile. «C’est un beau métier mais, en même temps, c’est un métier qui crétinise. Le patient de la veille, le patient du lendemain… Le vélo ne s’arrête jamais dans la tête. Je n’ai pas profité de mon époque. J’aurais pu aller aux cours de Deleuze, j’aurais pu rencontrer Foucault – son frère faisait l’internat avec moi. Je suis complètement passé à côté de tout ça.» S’il met alors de côté ses envies littéraires, il commence à militer, défendant le droit à l’avortement, aidant le FLN pendant la guerre d’Algérie et s’impliquant dans la cause palestinienne. Partisan, comme Edward Saïd, de la solution à un Etat et adepte du BDS, le «boycott, désinvestissement et sanctions» contre Israël, ses positions lui valurent de nombreuses accusations d’antisémitisme. Il les balayait toujours d’un haussement d’épaules, n’hésitant pas à en rajouter dans la provocation, affirmant ne se soucier guère de la montée en France des violences antijuifs, comme au moment de l’assassinat de Mireille Knoll.
«Si on n’est parfois pas d’accord sur sa vision robespierriste de la Révolution ou sur un rapport un peu autoritaire à la politique, le vrai point de friction idéologique porte clairement sur la question des Indigènes de la République.»
— Nicolas Norrito, fondateur de la maison d'édition Libertalia
Cherchant un sens à sa vie, malheureux dans son travail, il reprend en 1983, à 47 ans, la maison d’édition de son père. Il la revend quatorze ans plus tard à Hachette pour fonder la Fabrique. «Le projet était à la fois clair et ouvert : pas de frontières politiques, encore moins partisanes», se souvenait en 2018 l’historien Enzo Traverso, compagnon de route des premières années, avant de s’éloigner : «A la fin des années 1990, après la chute du mur de Berlin et la profonde crise idéologique de la gauche, un espace s’ouvrait, que les maisons d’édition avaient depuis longtemps déserté. Il s’agissait d’apporter de nouvelles idées à la jeune génération à la gauche de la gauche.»
«Le rôle de ma génération, c’est le travail de sape»
Certains ouvrages entraînent des ruptures nettes. Outre la question israélienne, les positions décolonialistes voire indigénistes de la maison d’édition sont des marqueurs. Les Blancs, les Juifs et nous : vers une politique de l’amour révolutionnaire de Houria Bouteldja suscite nombre de critiques, accusé de racisme et d’homophobie. «Si on n’est parfois pas d’accord sur sa vision robespierriste de la Révolution ou sur un rapport un peu autoritaire à la politique, le vrai point de friction idéologique porte clairement sur la question des Indigènes de la République, témoignait Nicolas Norrito, fondateur de Libertalia, une des maisons d’édition d’extrême gauche qui se sont fondées dans le sillage de la Fabrique. Pour rien au monde on n’aurait publié le texte de Houria Bouteldja qui a provoqué énormément de fâcheries dans ce milieu.»
Hazan, lui, n’en avait cure. Tout comme il fit fi de la pression dingue du gouvernement Sarkozy et des services de police qui montèrent un dossier contre L’insurrection qui vient, le pamphlet poético-révolutionnaire du Comité invisible. Le titre de 2007 reste encore aujourd’hui le principal succès de la Fabrique et a donné plusieurs suites lues et commentées, A nos amis puis Maintenant, passées de la rubrique faits divers aux pages idées des journaux les plus chics.
«C’est à la jeunesse de préparer l’avenir. Le rôle de ma génération, c’est le travail de sape», expliquait-il, regrettant souvent de ne pas être pris au sérieux, comme si la Fabrique jouait un rôle d’amuseur public, qui ne croirait pas vraiment elle-même aux idées défendues. Evoquant un ouvrage sur la fin de l’Europe, il notait un jour que toute la salle où il donnait une conférence avait éclaté de rire, sur le mode : «Vraiment, quels farceurs, quels provocateurs que ces gens de la Fabrique.»
Non, Hazan croyait au grand changement, et potentiellement violent. Lui-même s’était essayé à la dialectique insurrectionnelle, dans Premières mesures révolutionnaires (écrit avec l’anonyme Kamo), en 2013. «Chacun peut voir autour de lui des groupes de – de salariés et de chômeurs, d’abonnés à la soupe populaire, de prisonniers, de mères de famille – qui ne supportent plus la vie qu’on les contraint à mener. Chacun peut entendre la colère dans les usines, les banlieues et les ports, chez les caissières des grandes surfaces et les employés d’Orange», écrivait-il, dans ce qui ressemble à une description parfaite du futur mouvement des gilets jaunes. «La révolution qui vient n’aura pas d’avant-garde, seulement des agents de liaison qui travaillent à faire éveiller et faire circuler les devenirs révolutionnaires», continuait-il. Si la révolution a commencé, position qui, face à tous les soubresauts du monde, peut se défendre, Eric Hazan, en tout cas, n’en verra pas son achèvement